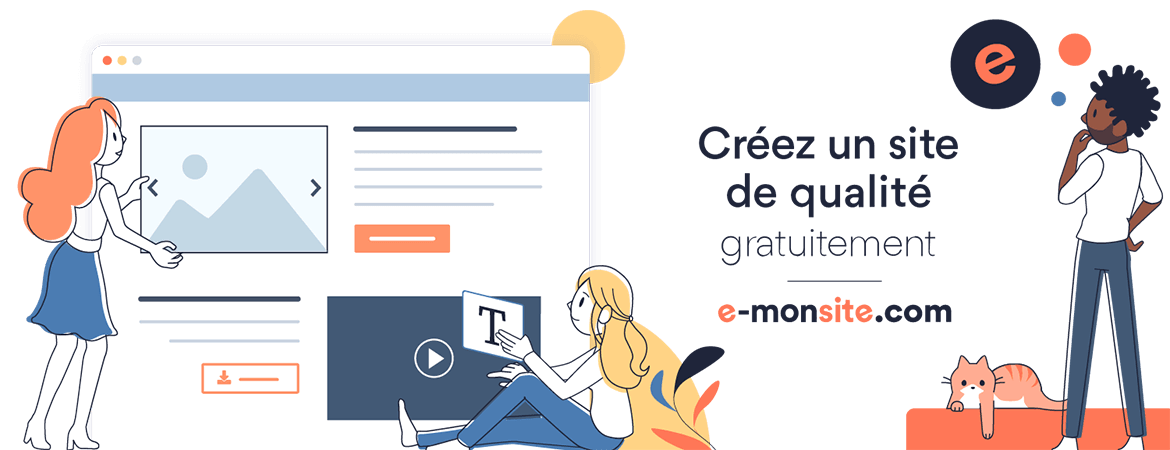Quelle est la différence entre besoin, désir et envie
Le 03/09/2017

Le désir et l’envie
Définition du terme Désir
Un bon moyen pour définir un terme, c’est de procéder par distinctions, c’est-à-dire l’opposer à des termes dont le sens est proche.
On distinguera ainsi Désir de Besoin d’abord, puis Désir d’Envie.
Désir et Besoin
On dit couramment que les besoins sont naturels quand les désirs sont artificiels.
Le problème est que pour l’homme, la notion de « besoin naturel » est très floue pour l’homme, dans la mesure où la plupart de nos besoins sont immédiatement repris dans des pratiques culturelles, et relèvent aussi de l’artifice, de la convention, de l’institution. Par exemple : manger est un besoin certes, mais quelle quantité est strictement nécessaire ? Pour quelle activité ? Que manger ? Comment le manger ? Tout cela prend immédiatement une dimension culturelle. Idem pour le besoin sexuel.
Ou dit aussi que les besoins seraient nécessaires quand les désirs seraient superflus.
Et les mêmes critiques à peu près se posent. De plus, on n’a guère (ce qui est d’ailleurs un problème en soi dans notre époque consumériste marquée par un schéma de « l’illimité » : consommation illimitée, jouissance illimitée, progrès illimité… Cf le livre de JP Lebrun Un monde sans limites) de critère qui distingue nettement le nécessaire du superflu.
On dit que les besoins sont limités, alors que les désirs seraient illimités, et donc un perpétuel esclavage dans la mesure où ils ne pourraient jamais être satisfaits.
Mais les besoins, s’ils peuvent être ponctuellement satisfaits, reviennent toujours en un cycle tout aussi infini, et on peut considérer qu’ils sont largement aussi asservissants.
Bref, une distinction qui semble au premier abord assez facile, mais finalement critiquable.
Désir et Envie
A l’inverse, l’autre distinction, entre Désir et Envie semble plus difficile à faire, mais sera peut-être plus éclairante quand à la nature propre du besoin.
Il semble que les envies soient plus passagères, alors que les désirs auraient plus de constance en nous. Cela parce que l’envie semble davantage suscitée par une tentation extérieure, qui me « fait envie », comme un stimulus, alors que le désir, relevant davantage d’une élaboration personnelle, d’une construction mentale, me suit partout, puisqu’il m’est propre et intime.
Si on applique ce principe au terme « Désir », qu’on se pose la question : quand emploie-t-on réellement ce terme? Qui l’emploie? etc. on remarque d’abord que ce terme est d’un registre châtié, et solennel. On ne dira pas tellement « je désire ce gâteau » mais « je veux ce gâteau », ou « j’ai envie de ce gâteau ». Pas « je désire » avoir le bac mais « je veux » ou « j’aimerais bien »…
Alors, qui dit « désir »?
Il y a les commerçants, les serveurs dans les restaurants, qui abordent le client par un « Vous désirez?… »
Sinon, on n’emploie guère le mot désir pour les objets de consommation (parlant plutôt d’envie), mais on l’emploie (encore) pour le désir sexuel. On dira qu’on désire quelqu’un, on pourra encore dire « je te désire » – même si on entend aussi un « j’ai envie de toi », ce qui ne semble pas impliquer la même approche. Différence qu’on pourra essayer d’expliciter.
Ne trouvant pas d’autres occurrences de l’emploi du mot « désir » dans la vie quotidienne, essayons de trouver ce qu’elles ont en commun.
Partant du désir sexuel, on voit qu’à la différence du « j’ai envie de toi » qui laisse entendre une pulsion de « consommation » du corps de l’autre, c’est-à-dire une saisie directe et sensuelle de la réalité de l’objet-corps de l’autre, il semble que l’objet du désir ne soit pas le corps réel de l’autre. Mais ça n’est pas non plus son esprit… sauf à suivre la théorie sartrienne du désir selon laquelle la saisie du corps de l’autre et le fait de l’acculer à la jouissance permet de capturer l’esprit de l’autre, de « l’hypnotiser » comme sujet, et ainsi de me faire le sujet de ce sujet, lequel me menaçait par sa puissance d’objectivation. (en me regardant, il faisait de moi un objet, et pour sortir de cette objectivation, je dois l’objectiver à mon tour, ce que le désir sexuel passant par le corps permet).
Donc le corps de l’autre n’est pas l’objet réel du désir, mais on pourrait dire qu’il le figure, qu’il est ce par quoi on espère accéder à l’objet réel de notre désir. L’objet réel du désir, c’est le fantasme. Et on espère pouvoir accomplir ce fantasme avec ce partenaire qu’on dit désirer.
Qu’est-ce qu’un fantasme? Remarquons qu’un fantasme semble principalement langagier, ou du moins « scénique », c’est une scène, un scénario. Et dans la réalité, on n’assouvit donc pas ses désirs (parce que nos désirs ne se situent pas dans la réalité, où il n’y a que des besoins et des envies) mais on les joue.
Nous sommes donc des êtres désirants parce que nous avons des fantasmes (ou SI nous avons des fantasmes – et je remarque ici, du point de vue de notre philosophie du langage ordinaire, qu’il y a une autre occurrence où on entend réellement l’usage du terme « désir », c’est quand on dit de quelqu’un qui est apathique, « déprimé » qu’il n’a « pas de désirs » (on peut dire aussi « il n’a envie de rien », mais là, c’est plus conjoncturel, c’est « aujourd’hui, je n’ai envie de rien », alors que dire (avec cette sorte de solennité) qu’on n’a « pas de désir », cela veut dire que notre vie n’est plus menée par un idéal, une transcendance qui la porterait de l’avant.
Résumons :
Avec le désir, il y a l’idée comme nécessaire d’une mise en scène, d’une représentation – alors que l’envie se tourne vers l’objet réel. On a envie de quelque chose, d’un objet, alors que quand on dit désirer un objet, on désire plutôt la situation, la scène, l’histoire, bref, la représentation qui s’attache à cet objet.
(ce que les publicitaire savent très bien, puisque tout leur travail consiste à toucher le consommateur dans ses désirs, et pour cela, il ne montre pas simplement l’objet qu’il s’agit de vendre, mais son « concept », c’est-à-dire tout un monde, des images, et même un mode de vie, qu’il rattache à cet objet comme le représenté s’attache au représentant.
Bref, on désire un objet en tant qu’il représente, qu’il symbolise. L’objet en tant que chose est en soi relativement indifférent, et ce n’est pas cela qui est désiré.
Thèse : Le désir, en tant que manque, n’est pas une aliénation mais est constitutif de la subjectivité
Avec ces remarques, nous déplaçons un peu les problématiques classiques que nous avons déjà rencontrées à propos du désir.
Le problématique classique avait été posée dans le dialogue entre Socrate et Calliclès à propos de la Sagesse et de la passion. Socrate défendait l’idée selon laquelle le désir était le signe d’un manque, que le manque était une souffrance, car il empêchait la plénitude, la satisfaction, et mettait dans un état de dépendance continuelle avec ce qui était désiré, et qui était susceptible de nous « remplir » (vainement, puisque le tonneau du désirant est troué). Ce qu’on appelle couramment aujourd’hui l’état d’addiction.
A l’inverse, Calliclès soutenait que le désir était un signe de force, qu’il était le moteur de nos actions, qu’il nous donnait les motivations pour vivre et agir. Bref, que le désir n’était pas signe de manque, mais au contraire de puissance d’exister. Et il considérait que les pourfendeurs du désir étaient les impuissants qui, par ressentiment, réduisaient la force désirante à être une addiction, un « esclavage des passions ».
Ce que nous pouvons dire, à partir de nos remarques antérieures, c’est que le Désir est certes un manque (comme le dit Socrate), mais qu’il ne met pas dans un état d’esclavage, d’aliénation à quelque chose d’extérieur à nous (addictions – cela, nous l’avons plutôt appelé les envies), mais que ce manque nous est constitutif. Que notre être de sujet naît de ce manque.
On devient soi-même à partir d’un manque, constitutif de notre identité (laquelle n’est pas nécessairement consciente). Ce manque constitue l’idéal à partir duquel le sujet se définit.
Ces idées sont développées par les psychanalystes, qui, à la suite de Freud, considèrent que notre rapport au monde et à nous-mêmes est mis en place non par un objet, mais par le manque d’un objet, et un objet d’élection, un objet essentiel, un objet chéri.
Cet objet, qui assurait pour nous la plénitude de la fusion, c’est la matrice originelle, le sein de la mère, dont nous avons vu, dans le cours sur la psychanalyse que nous étions sevrés par éducation, qu’il devenait interdit. Cet « objet a » tel que les lacaniens l’appellent est donc perdu définitivement, et tous les autres objets dorénavant ne pourront que symboliser cette plénitude, cet Eden perdu.
Cela est la structure « normale » de l’éducation, cet interdit de la plénitude, de la fusion avec l’objet réel, qu’on peut aussi appeler la jouissance – et c’est cela, l’interdit qui rend la jouissance impossible, barrée, qui permet de Désirer (desiderare en latin, c’est avoir une étoile (sidérale) perdue (de-), et d’être sujet de et par ce désir.
Car dans la jouissance, précisément, il n’y a plus de sujet, la jouissance est une « désubjectivation ». Parce qu’elle est fusion dans l’objet et perte de soi (jouissance sexuelle, toxicomanie) et état d’addiction, où c’est l’objet qui mène la danse.
(il faut à ce propos nettement distinguer la jouissance du plaisir, ce dernier étant une manière hédoniste que le sujet aurait de gérer ses propres tensions et détentes, alors que l’addiction est une dépossession radicale. Cf la distinction entre le gourmet et le boulimique, l’amateur de vins et l’alcoolique, etc.).
C’est ainsi qu’une thèse, soutenue par une certaine école psychanalytique, soutient que, si à son époque, Freud a eu raison d’indiquer que la frustration des désirs (entendus comme pulsions) jetait les populations d’Europe dans la névrose (les désirs refoulés revenant sous forme de symptômes pathogènes, handicapants pour bien vivre), il faut cependant prendre acte à notre époque d’un certain renversement qui se serait effectuer : en effet, on ne frustrerait plus guère les pulsions, leur permettant un assouvissement dans le réel, mais on jetterait par là les populations dans une addiction à la jouissance, car il n’auraient pas eu à affronter la frustration de l’objet qui permet la constitution du fantasme idéal, névrotique. Et par là, de populations écrasées par un Désir impossible, névrosée, on serait passé à une population sans Désir, et qu’ils appellent « perverse » dans la mesure où elle n’a pas intériorisé l’interdit, et s’amuse à le dénigrer.
Ils rattachent cette thèse de la « société perverse » à celle d’une société dominée par la figure maternelle (et donc la destitution de la figure de l’autorité incarnée par la fonction paternelle).
La fonction maternelle, c’est celle qui assure la plénitude, la jouissance (le bien-être, l’affection, etc.), tandis que la fonction paternelle assure la loi, l’interdit. Pour le dire simplement, son rôle est d’arracher l’enfant à la plénitude jouissive, afin de lui permettre de désirer. Le père, comme fonction (cette fonction peut peut-être être remplie par une femme, et inversement, la fonction maternelle par un homme, sur cela, il y a débat…) met l’enfant dehors, en disant qu’ici, près de la mère, c’est sa place.
Nos sociétés sont donc moins structurées par la figure paternelle, parce que :
1/ De fait, beaucoup de familles sont monoparentales, ou reconstituées, et la distribution des rôles est plus délicate, doit être redécidée à chaque fois par chacun, ce qui rend leur fonctionnement plus aléatoire.
2/ Le discours social actuel dominant, jouissif (à cause de l’impératif consumériste) tend à rejeter le père comme figure autoritaire frustrante, valorisant le vécu, les émotions, plutôt que la Loi, les principes édictés dans le langage
3/ A propos du langage : le discrédit jeté sur le langage par les formes audio-visuelles permises par la puissance technologique a un impact direct sur la difficulté à désirer. Les images, les sons, donnent la chose elle-même, alors que les mots la symbolisent et permettent le fantasme.
philo.licorne.org
 Je veux abbonner cette page!
Je veux abbonner cette page!