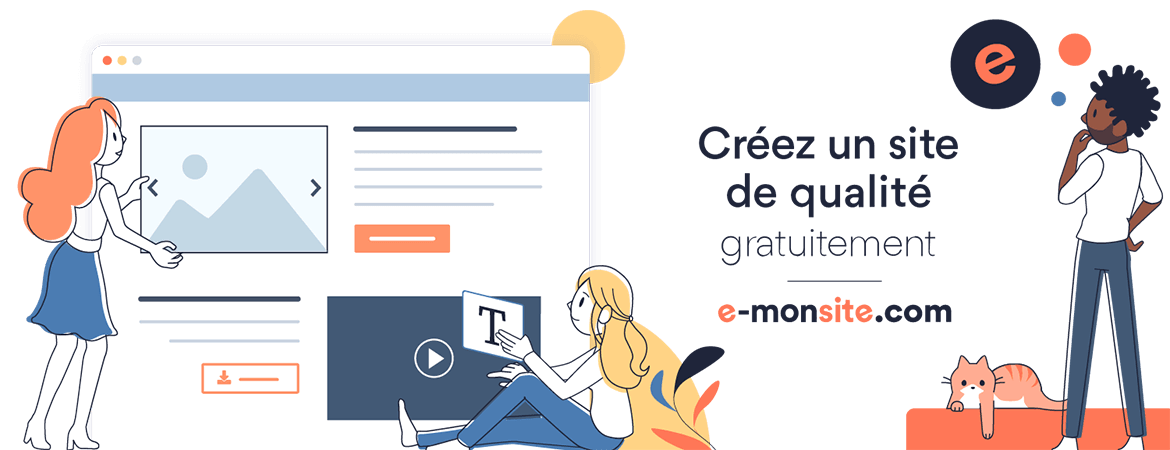|
Pour le chercheur et anthropologue congolais, la thèse selon laquelle les Bantu, principalement les esclaves en provenance du royaume Kongo, était la population la plus nombreuse, a été soutenue par l’historien haïtien Gabriel Debien, dans Y. Farraudière (2005 ; p.106). Il a affirmé que plus du tiers des esclaves africains à Saint Domingue étaient d’origine Kongo, suivis par les Aradas du Dahomey, les Ibos du Nigeria… L’historien belge Hein Van Hee, cité par Linda Heywood de la Howard University (USA), est allé dans le même sens dans son Heywood 1998, (p.246). « Au milieu du 18è siècle, écrit-il, les Français ont acheté beaucoup d’esclaves au royaume Kongo, pour l’Ile de Saint Domingue, entre 1720 et 1780, soit 64% du nombre total des esclaves concentrés au nord de l’Ile qui est aujourd’hui Haïti », a-t-il soutenu. Un registre du compte des nègres en fuite et du décompte des esclaves fugitifs arrêtés - J. Fouchard 1988 - fait ressortir que les Kongo occupaient toujours le sommet de la liste des esclaves fugitifs. Le plus grand fugitif de la période pré révolutionnaire, véritable bouc-émissaire de l’idéologie révolutionnaire, sera un esclave fugitif kongo du nom de François Makanda, dit Makandal L. Heywood 1998, (p.250). Il est le premier à avoir uni les communautés fugitives des montagnes du nord d’Haïti pendant les années 1750, où il visait de tuer tous les Blancs de la colonie par le poison et de libérer tous les nègres. C’était un grand féticheur, tel qu’écrit dans Pierre de Vaissière 1909, (p.236-237). Il avait fanatisé les esclaves de la colonie et on disait de lui qu’il était immortel. On prétendait qu’il se dédoublait et pouvait être vu d’un endroit à l’autre au même moment. Il organisait des raids la nuit pour incendier les habitations des maîtres d’esclaves. Il avait réussi même à empoisonner l’eau courante des habitations des colons, causant près de 6.000 décès.
La fin d’une aventureMakanda fut capturé et brûlé vif à Cap Haïtien, le 10 janvier 1758. Des témoignages rapportent qu’il s’était transformé en oiseau et s’était envolé des flammes. Cette transformation en oiseau ramène au père Van Wing, Études Bakongo (p.37), où il dit que, chez les Kongo, les hommes se transforment en bêtes, les sorciers se changent en animaux minuscules. Ainsi trouve-t-on d’après la croyance Bakongo des personnes qui peuvent se métamorphoser en animal de grande taille à partir d’un fétiche Kitu di ngo, Kitu di ngandu. David Geggus a considéré François Makanda comme étant un sorcier, un bokor en créole haïtien. Le personnage de Makanda en Haïti est resté la figure emblématique du sorcier. Il a passé plus de 10 ans à combattre l’esclavage avec un succès éclatant. Il a engendré des bandes, matrice indispensable pour la liberté et l’indépendance. Dans les cérémonies vaudou de Baron Samedi, le tout puissant maître des morts Makanda, est considéré comme Papaloa. En 1792-1793, une bande d’esclaves révolutionnaires dirigés par un Kongo, du nom de Macaya, se proclamant comme étant un descendant d’un roi du Kongo, contrôle la région de Limbe. Après Makanda, d’origine kongo ; Don Pedro, d’origine kongo ; Macaya fut le plus influent des esclaves insurgés du nord d’Haïti. La révolution haïtienne est une insurrection des esclaves du nord d’Haïti, peuplé majoritairement des esclaves kongo. On peut citer d’autres rebelles tels que Mavoungou, Télémaque Canga, Racine Jean Zenga, Jérôme Poteau, Lamour Derance, Romaine Rivière… Pour le chercheur et anthropologue congolais, la lecture unilatérale de l’histoire de Saint Domingue a fait que le vodou haïtien a été pendant longtemps abordé comme un culte d’origine dahoméenne. Ses sources kongo ont été inexplorées, si ce n’est à peine qu’on a commencé à découvrir toute leur importance. Alfred Metraux, pour sa part, parle d’une rencontre des traditions du Dahomey et du Kongo. Les esclaves du Dahomey, dit-il, étaient arrivés des décennies avant les Kongo ; voilà pourquoi le mot vodou était le mot utilisé au départ. L. Desquiron, dans son ouvrage Les Racines du Vodou (p.193), est clair à ce sujet : « Les Dahoméens ont présidé à l’élaboration du culte radas et les Bantous à la formation du culte pétro-lemba à caractère magique dans le vodou haïtien. » C’est le pétro-lemba qui a fourni les stimulants à l’esprit révolutionnaire chez les esclaves de Saint Domingue. Le panthéon des esprits de tradition kongo dans le vodou haïtien est très long ; on note, entre autres le rite pétro-lemba, rite Congo et rite spécial Macaya : Lemba Zaou ; Simbi-y-an Kitha ; Marassah Congo bord de Mer ; Laoca ; Simba Maza ; Brise Macaya ; Kanga pétro ; Zilah Moyo ; Ganga doki. Les Kongo ont dirigé la lutte contre l’oppression coloniale, le roi du Kongo était le roi de tous les Noirs ! Cette prétention a fait la peinture de la suprématie pour les sujets de ce roi à Saint Domingue. Quand Napoléon Bonaparte envoie le général Leclerc, le 1er février 1802 pour rétablir l’esclavage à la suite de l’auto proclamation de Toussaint Louverture, comme gouverneur à vie de Saint Domingue, la défense héroïque des indigènes sera surtout illustrée par Jean Baptiste Sans Souci et Henry Christophe, ce dernier qui était un créole dont le côté africain n’est pas connu, alors que Sans Souci était un kong (lire Laurent Dubois et John Garrigus, 2006, p.104). Il est donc l’un des plus grands leaders militaires talentueux de Saint Domingue, et était actif dans le nord, près de la ville de Limonade, en septembre 1802, au cours d’une attaque française contre Sans Souci. Quelque 400 Français furent tués.
Jean Jacques Dessalines déclare l’indépendance de la colonie de Saint DomingueC’est le 1er Janvier 1804, que Jean Jacques Dessalines déclare l’indépendance de la colonie de Saint Domingue, qui devient Haïti (ayiti : la terre des montagnes), le nom indien de l’île d’avant l’arrivée des Européens. Il déchire la partie blanche du drapeau français, pour former le drapeau haïtien, bleu et rouge. Timolean Brutus, dans Haïti History And The God, Berkeley University of California Press 1995 (p.52), asserte que Dessalines avait chanté en kikongo en étant en transe. Après s’être autoproclamé gouverneur à vie d’Haïti, Dessalines rejette l’autorité de Rome sur l’Église catholique d’Haïti et se proclame chef de l’Église catholique haïtienne. C’est le grand schisme qui a duré 56 ans. On parle même d’un catholicisme populaire à la Dessalines, qui aura comme culte important la dévotion à la vierge Marie et le culte de la saint Jacques. Notons enfin que le Congolais Arsène Francoeur Nganga, chercheur en histoire et anthropologie socioculturelle des Noirs des Amériques, s’est référé sur les documents suivants : I’m the subject of the King of Kongo, African political Ideology and the Haitian revolution, de John K. Thornton ; Journal of world history, Vol 4, N°2 (1993) pp.181-214 ; et African Soldiers in the Haitian Revolution, Journal of Caribbean History N°25 (1993), toujours de John K. Thornton.
Bruno Okokana Le chercheur et anthropologue Arsène Francoeur Nganga.
|
- Accueil
- Pages
- DIASPORA
- Nos frères et sœurs kongo d'outre-mer (Antilles, les Caraïbes et Amérique du sud)
Nos frères et sœurs kongo d'outre-mer (Antilles, les Caraïbes et Amérique du sud)
Les descendants Kongo installés aux quatre coins de le terre: Brésil, Cuba, Chili, Guadeloupe, Guyanne, Haïti, Martinique, etc...
Sans le savoir beaucoup d'antillais et des peuples d'Amériques du sud sont de descendances des Bena Kongo, les filles et fils du Kongo. Déportés lors de la traite negriere organisée par les differents pays européens des le 14 eme siecle(Portugal,Espagne, la France,Angleterre, les pays Germains etc...
Dans ces circonstances, il existe des traces de la culture, la religion et la langue Kongo dans les Amériques. Ainsi, on retrouve en Haiti,Cuba,Martinique et le Brésil des preuves irrefutables de la présences des Bakongo. Les Bakongo ont légués le kikongo qui est caché dans la langue Kréole qui est parlé en haiti, Martinique,Guadeloupe,Gyuane Francaise. Ils ont légués des danses rituels, des secrets de plantes medicinaux, le ryhtme musical du son du tambour, et des rituels sacrés dans la religion vodou.
Par exemple, en haiti, on retrouve beaucoup de mots issus de la langue Kikongo se trouvant dans le créole parlée egalement sur divers territoires des antilles.
Les Kongo d'outre-mer
Le 15/03/2019
Présence Kongo dans les Amériques
Les preuves de la présence kongo dans les Amériques sont nombreuses et sont identifiables au moindre détails par une riche terminologie et des pratiques sociales (langue, culture, spiritualité, alimentation, musique, moeurs, économie, etc.).
Présence linguistique
La langue commence par les noms de Dieu et de l'homme ou des hommes, par le verbe être et avoir. Lorsque les Africains ont été déportés, ils ont entretenu leurs langues d'origines tant les termes que dans l'esprit, l'âme et la conscience qui s'expriment dans chaque mot. Le terme le plus répandu concerne le nom de l'homme, qui est NTU en Afrique, MUNTU prononcé MUN. le pronom personne MONO, moi, est celui que les Afrodescendants d'Amériques ont maintenu par le terme MWEN.
Présence spirituelle
Une distraction historique est faite au sujet du VODU, qui serait la preuve de l'origine béninoise, dahoméenne du Vodu en général et celui d'Haïti en particulier. Nous savons que le Vodu d'Haïti est d'origine kongo. Nous voulons donner quelques pistes de lecture à ceux qui ne savent pas ou douteraient de cet argument. On ne peut pas donner des noms des saints étrangers à une institution religieuse authentique. Les cultes KANDOMBE et UMBANDA sont kongo. Le KANDOMBE, spiritualité noire, en kikongo est appelé CANDOMBLE en créole. La liturgie kongo qui se déroule dans les ZUMBU et le MILONGO est le SAMBA, prière. Ce qui éclaire la conscience historique est les noms des prêtres vodu : LOA et MAMBO. LOA est le nom du prêtre vodu qui, en kikongo et en spiritualité kongo veut dire ASTRE. En ce qui concerne la prêtresse, elle se nomme MAMBO, maîtresse des situations et des cérémonies (cultes).
Présence culturelle
Prenons par exemples le carnaval et la musique. Dans un enseignement que j'ai fait à l'université Paris 8 en 2014, sur "L'influence de la musique africaine sur les musiques du monde, j'ai évoqué les termes et mouvements culturels TANGO, SAMBA et KOMPA. Ces activités culturelles massives sont liées : TANGO, au soleil et au temps, au culte solaire et à la chronologie. SAMBA, expression publique de la foi par les chants car chanter c'est prier deux fois. Le chant est la maîtrise de la parole et le signe de l'avoir écoutée et retenue. La KOMPA, c'est la RUMBA, la N'KUMBA, danse du ventre. Enfin, la SALSA, de SASA, éduquer, c'est la RUMBA de Cuba. Nous pouvons élargir cette argumentation sur plusieurs domaines.
Présence militaire
Les militaires qui ont libéré les esclaves sont de descendance kongo. ZUMBU, MAKANDALA et tant d'autres.
Présence Kongo aux Antilles française
Festival culturel de Fort-de-France
À la suite de la deuxième abolition de l’esclavage , qui fut définitive,en 1848, il y eu un déficit de main d’oeuvre dans les plantations de canne à sucre aux Antilles françaises et en Guyane. En effet, de nombreux affranchis ont refusé de reprendre le travail dans les plantations car ils assimilaient celui-ci à leur ancien état d’esclaves. Mais pas seulement, il y a aussi une raison structurelle. Le travail de la canne à sucre était un travail très pénible. Les conditions de travail et de vie étaient mauvaise d’où la mortalité importante des esclaves. Ce fort taux de mortalité était une des raisons pour laquelle les négriers capturaient quotidiennement des africains.
“Les esclaves [des champs de canne] ne dépassaient pas 50 ans et leur espérance de vie, établie sur une moyenne, était beaucoup plus faible. “
Le travail de la canne à sucre tuait autant , voir plus, que les conditions de voyage qu’avait les africains mise en esclavage.
Pour réorganiser le travail colonial en 1848 , les administrationscoloniales en collaboration avec les planteurs, prônèrent le recours à l’immigration de travailleurs extérieurs. Face à cette crise de main d’oeuvre les demandes d’immigrants se sont élevés entre 15 et 18 000. Le ministère de la Marine et des colonies (l’État français) d’accord avec leurs suggestions a mis en place un système ,subventionné par l’État,la création de travailleurs extérieurs sous contrat d’engagement de travail.
Par conséquent, de 1854 à 1862, plus de 21 000 hommes, femme et enfant des côtes africaines ; du Sénégal, en pays krou (Liberia et Côte d’Ivoire) et surtout en Afrique centrale (Gabon et Congo) ont été emmenés pour aller travailler aux Antilles et en Guyane par les autorités et firmes françaises.
Il y eut deux flux migratoires distincts:
- Un premier, entre 1854 et 1856, les «engagés» les recrutements s’effectuaient au sein de populations africaines jouissants d’un statut de libre, acceptant volontairement le contrat proposé.
- Un second, entre 1857 et 1862,les «recrutés» les recrutements s’opéraient au sein de populations de condition captive avec la méthode dite du « rachat préalable ». Par ce procédé, les recruteurs français achetaient des captifs, puis les « affranchissaient » en leur imposant un engagement de travail de dix années à effectuer outre-atlantique. 93% de ces immigrants furent ainsi recrutés et engagés. Ils étaient donc des esclaves, «rachetés» en échange d’un engagement comme salariés.
Tout d’abord, il y eut 10 552 Africains qui arrivèrent en Martinique, 6 140 en Guadeloupe et 1 826 en Guyane.
“Ensuite, dans la seconde moitié du XIXe siècle, la Martinique fut concernée par de nouvelles immigrations. La plantocratie locale, soucieuse de renouveler la main d’oeuvre après l’abolition de l’esclavage, suscita l’arrivée dans l’île de 37’008 engagés sous contrat : 25’509 Indiens, 10’521 BaKongo (Congolais du royaume Kongo) et 978 Chinois).” (Gerry L’Etang )
La majorité de ces bakongo sont concentrés dans le sud de l’île.
Les BaKongo étant majoritaire parmis les immigrants africains, ils ont laissé plus de trace que leurs confrères d’Afrique de l’Ouest.
L’appellation Bakongo désigne des populations issues de vastes régions de part et d’autre du fleuve Congo. Sur les 10’521 BaKongo: 9’925, soit 94% engagés, arrivèrent du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa; 254, soit 2%, du Sierra-Leone; 159, soit 1,5% du Gabon; et183, soit près de 2%, sont d’origine non identifiée.
“Sur 10’521 BaKongo, il n’y eut en effet que deux à retourner en Afrique, dont un certainTom Tobie, expulsé en 1858 pour “s’être livré à des voies de fait sur son employeur, M. Brafin, à Sainte-Anne, et qui avait mauvaise influence sur son atelier, qui avait tenté de s’évader de la colonie ” .
De plus,à l’arrivée des Bakongo, se trouvaient aux Antilles et en Guyane, d’autres Africains,derniers débarqués des traites esclavagistes. Beaucoup venaient du même monde Bantu qu’eux.
Dans une société antillaise qui,” pour des raisons politiques et sociales (classification des couleurs, stratégie du blanchiment), était particulièrement sensible au signe corporel, la singularité phénotypique des Indiens et des Chinois fonctionna comme un facteur d’accentuation de leur différence. Toutefois, et paradoxalement, en cohérence avec la hiérarchisation des caractères somatiques dans la société d’accueil, la peau blanche des Chinois ou les cheveux raides des Indiens ont pu jouer comme des éléments d’inclusion, là où la peau noire des BaKongo pouvait représenter un facteur d’exclusion.”
“L’intégration des Africains au reste de la population n’a pas été chose facile au début , le préjugé de couleur lié au statut social de l’individu marquant fortement les esprits , y compris au sein de la population noire créole . Mépris , moqueries , isolement persistaient , la population créole considérant les immigrants de fraîche date comme des êtres de condition servile , hommes de main du béké.”
C’est aussi pour cela que l’histoire de ces africains arrivés après l’esclavage est peu connu.
- Le positionnement des engagés “Bakongos” vis à vis du pouvoir colonial et ses incidences culturelles
Rappelons le contexte politique et social, les planteurs étaient menacés dans leur profit et leur hégémonie par l’abolition de l’esclavage, c’est pourquoi ils ont eu besoin de travailleurs immigrés.Cela était aussi tactique puisqu’en saturant la demande de travail, l’immigration leur permettait de contenir les revendications d’augmentation salariale qui sont apparus à la libération. Le but était de casser toutes revendications , de briser tout espoir révolutionnaire d’égalité , de redistribution du pouvoir et des biens après l’esclavage en introduisant massivement des immigrants venant de pays colonisés. Il pensait qu’ils étaient soumis à l’ordre colonial et manipulables.
-
Héritage culturel
De cette immigration Bakongos il reste des traces. Celles-ci linguistiques, magico-religieux, culinaire (la soupe Kongo), toponymique (noms de lieux) (Morne l’Afrique au Diamant…) ou patronymique ( noms de famille) (N’guéla, Condé, Simba…). Mais aussi l’événement culturel Grap a kongo.
Il y a aussi des expressions datant de cette immigration: “Nwè kongo” : ce dit d’une personne foncé de peau, ‘Neg’ kongo” : un noir travailleur ,“ Kongo ka palé wani wana ” :le Kongo parle n’importe comment.
Les noms de familles
Contrairement aux esclaves qui ont reçu un nom et un prénom qu’à leur affranchissement ou qu’à l’abolition. Les engagés et leurs enfants ont conservés leurs prénoms , ils ont légèrement été francisé. Peu d’antillo- guyanais savent qu’ils portent ou que certains de leurs aïeux ont des noms africains.
les noms Bakongo en Martinique:
Makessa, Mayulika, M’Bassé, Matha , Zoumba , Simba , Ouemba , M’Basse , Condy , Condé , Foutou , Maloungila , Aribo , Thésée , Batta , Dambo , N’Guela , Moanda…
Ces mêmes familles ont essaimé sur les Anses d’Arlets , Trois Ilets , Rivières Salée , Sainte-Luce , Marin ( La Duprey ) .
La famille Thésée est bien connue aux Trois Ilets , possédant de redoutables combattants de danmyé. On trouve quelques fammiles au Gros Morne Yokessa , Womba) , à Trinité ( Louisia , Couta , N’Goala ).
L'immigration Kongo en Martinique
Le 14 mars 1857, le gouvernement français signa un traité avec la maison Régis de Marseille pour le recrutement d’individus libres africains à la destination de la Guadeloupe et de la Martinique. C’est ainsi que commence il y a plus de 150 ans l’immigration de travailleurs congos dans notre pays.
La maison Régis possédait, au temps de la traite, une dizaine de factoreries entre la Côte d’or et le delta du Niger, puis elle s’installe à M’Boma, à l’embouchure du fleuve Congo. Le marché de M’Boma vendait jusqu’à 200 esclaves par jour au XVIII° siècle. Les immigrants Congos venus après l’abolition sont originaires, pour la plupart, des rives du fleuve, issus du monde bantou.
L’immigration était nécessaire au lendemain de 1848 : la main d’œuvre manquait sur les habitations et les grands propriétaires envisageaient une modernisation et une augmentation de la production sucrière.
On fit appel à des populations venues d’Asie (Indiens et Chinois) mais aussi à des populations africaines appelées nègres congos. Cette immigration est moins connue que l’immigration de travailleurs indiens car elle a été de courte durée (1857-1862), en conséquence elle a porté sur un nombre relativement faible (10 500 Congos arrivés en Martinique), car elle rappelait trop les conditions de la traite négrière. Les Kongos se sont fondus peu à peu dans la population martiniquaise, mais il nous semble important de marquer ce cent-cinquantenaire car ils nous ont laissé quelques acquis culturels.
Le décret du 13 février 1852 fixe les conditions de l’immigration aux colonies, les engagements de travail, les obligations des travailleurs et de ceux qui les emploient ; des dispositions de police et de sûreté portent sur la répression du «vagabondage», c’est-à-dire des déplacements de travailleurs qui ont rompu leur engagement.
Les Kongos signent un engagement de dix ans. On a noté seulement deux rapatriements. L’immigration congo se caractérise par son extrême jeunesse (93% ont entre 10 et 24 ans) ce qui peut expliquer le manque d’acquis culturels et le faible apport au sein de la population créole. La jeunesse de cette immigration est compréhensible, car il s’agit d’avoir des travailleurs en pleine force utile. Les deux tiers étaient des hommes.
Comme les Indiens, une fois arrivés en Martinique, ils effectuaient un court séjour dans un dépôt, avant d’être répartis par groupes sur les habitations, selon les demandes des propriétaires. L’engagiste fournit le logement, les vêtements, la ration alimentaire (morue, poisson ou viande salée, riz, farine de manioc). L’immigré bénéficie aussi d’un petit jardin pour les légumes. La journée de travail est de douze heures, entrecoupée d’un ou de deux moments de repos.
Les Européens expliquaient avec force préjugés ce nouveau recours au réservoir africain : « l’Africain ne semble t-il pas être l’homme que la nature a façonné pour le travail de la terre sous le soleil du tropique ? En le faisant naître dans les régions brûlantes, elle l’a rendu insensible à la chaleur de nos climats… L’Afrique seule pouvait fournir des femmes en nombre suffisant et travaillant à l’égal des hommes, à la différence des femmes indiennes de complexion délicate et aux formes exiguës. Il était important que les femmes viennent, car plus dociles, elles pouvaient se plier facilement aux exigences d’une position nouvelles ».
Pourtant la mortalité était forte en dépit de la jeunesse de la population. Deux ans après l’arrêt de l’immigration, il y avait 7.000 Congos sur les 10.000 introduits. Une épidémie de fièvre jaune avait frappé l’ensemble de la population martiniquaise.
L’intégration des Africains au reste de la population n’a pas été chose facile au début, le préjugé de couleur lié au statut social de l’individu marquant fortement les esprits, y compris au sein de la population noire créole. Mépris, moqueries, isolement persistaient, la population créole considérant les immigrants de fraîche date comme des êtres de condition servile, hommes de main du béké. Mais les Kongos ont participé aux nombreuses luttes sociales, en particulier dans le sud. Ils n’étaient pas totalement dépaysés, retrouvant d’anciens esclaves nés en Afrique et déportés en Martinique au temps de la traite.
Lors de l’insurrection du Sud, des milliers d’hommes et de femmes sont engagés dans la lutte. Parmi eux, des travailleurs immigrants, surtout des congos. Le commandant Mourat écrit au gouverneur : « La classe noire était tout entière dans le mouvement. Eugène Lacaille a soulevé les Congos en leur promettant leur libération des engagements contractés ». Dans une adresse au gouverneur, les propriétaires du Vauclin précisent que dans cette commune «les incendies à déplorer sont l’œuvre d’Indiens et d’Africains appartenant aux propres habitations incendiées».
Lors de la grève de 1900, par ceux qui tombèrent, trois portaient des noms congo : la liste au François porte deux Africains. L’un d’eux, surnommé Ti Paul Pierre, est âgé de 60 ans. Son vrai nom est QUINQUELA. Il fut atteint mortellement, alors qu’il cheminait à proximité de l’usine avec un paquet d’herbes sur la tête. L’autre, c’est M’VONDO Paul. La liste du Robert compte un fils d’Africaine : MOUBOUNDO Jean Dominique. Est-ce l’Africain que le lieutenant Kahn affirme avoir abattu alors qu’il l’attaquait du coutelas ?
Les Congos ont conservé leur patronyme. On les trouve plus nombreux dans le sud. Le Diamant est la commune la plus caractéristique. Les familles occupent le morne l’Afrique, un quartier reculé, boisé, escarpé, donné aux affranchis par le comte de Dizac ; les nouveaux arrivants s’y installent. Il s’agit aujourd’hui de terres arides et rocailleuses, mais le Diamant était un important centre cannier comptant huit sucreries au milieu du XIX° siècle.
Les descendants de ces familles sont encore là : Makessa, Matha, Zoumba, Simba, Ouemba, M’Bassé, Condy et Condé, Foutou, Maloungila, Aribo, Thésée, Batta, Dambo, N’Guela, Moanda… Ces mêmes familles ont essaimé surles Anses- d’Arlets, Trois-Ilets, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Marin (La Duprey). La famille Thésée est bien connue aux Trois-Ilets, possédant de redoutables combattants de danmyé. On trouve quelques familles au Gros-Morne (Yokessa, Wemba), à Trinité (Louisia, Couta, N’Goala).
Les Congos nous ont laissé des noms d’animaux (djenmbo, matoutou, mabouya, gongolo, jenga), des noms de plantes (gonbo, kankanbou, malanga, makanja), d’autres termes (banboula, agoulou, ti bangyo, djouboum). Ils n’ont pas laissé beaucoup de traces en termes de rites ou de symboles. Ils étaient éparpillés un peu partout en Martinique, même si on observe une certaine concentration au Sud.
La situation est un peu différente de celle de la Guadeloupe où la famille Massembo occupe le quartier Cambrefort à Capesterre Belle-Eau. Mais les Congos ont conservé une solide réputation de gros travailleurs, manœuvres à tout faire, meneurs infatigables lors des grandes luttes sociales.
Les Kongos en Guadeloupe
Mas Maten 2019 Kongo Karayib
Affirmation identitaire dans une famille Congo de Cambrefort-Moravie (Guadeloupe, Antilles françaises)
Après l’abolition de l’esclavage aux Antilles françaises, entre 1848 et 1861 - des milliers de Kongos arrivèrent en Guadeloupe avec le statut d’immigrés pour relancer la production sucrière. Méprisés, ils eurent beaucoup de mal à s'intégrer dans la société créole et ne le firent qu'au prix d'un abandon progressif de leurs traditions, de leur langue, de leur culture et de leur identité. La famille Massembo, malgré un coût social et psychologique, avait conservé et perpétué ses traditions culturelles kongos à travers la cérémonie du « grapp a kongo ». Aujourd’hui, elle est quasiment sortie des ténèbres et son identité affirmée et reconnue.
Introduction
- 1. De nombreux observateurs ont pu noter que les populations noires transplantées dans l’ensemble de la Caraïbe par la traite négrière avaient, à des degrés divers, fait l’objet du processus de déculturation. Celles issues de l’immigration post-abolitionniste vivant en Guadeloupe et en Martinique n’avaient pas échappé à ce processus. Mais la famille Massembo dont les descendants des quatrième et cinquième générations vivent encore sur les hauteurs de Moravie (lieu-dit de la section de Cambrefort à Capesterre Belle-Eau), en Guadeloupe, semble faire exception à la règle générale. Cette famille, à l’instar d’autres de la Guadeloupe et de la Martinique, était issue du grand groupe ethnique kongo qui appartenait à l’ancien royaume de Kongo (en Afrique centrale, au XVIe siècle).
- 2. La famille Massembo avait conservé et perpétué ses traditions culturelles kongos parmi lesquelles, le culte des morts, des ancêtres. Ce culte s’était concrétisé en terre guadeloupéenne - eu égard aux éléments de contexte - et dénommé « grapp a kongo » ; un rituel annuel précis qui avait toujours lieu le soir du 1er novembre, au cours duquel la famille Massembo rendait hommage - dans tous les sens du terme - aux ancêtres. En dépit des humiliations subies par ses protagonistes, pour l’avoir préservé et perpétué, ce rituel est toujours - pour l’essentiel - d’actualité, plus de cent cinquante ans plus tard. À cet effet, il convient de rappeler que, depuis l’arrivée en Guadeloupe des premiers Massembo, en 1857, jusqu’à nos jours, il y a eu cinq générations. C’est aux deux dernières générations que nous nous sommes intéressés.
- 3. La problématique de la préservation et la construction identitaire a toujours été au centre des préoccupations des populations antillaises, eu égard à leur histoire. Les Massembo avaient semble-t-il trouvé les voies et les moyens d’y répondre. Cela ne s’est pas fait à moindre coût social et psychologique, comme nous allons le voir dans les lignes suivantes.
- 4. Après avoir brièvement planté le décor socio-historique des Kongos, en Guadeloupe, et évoqué le « grapp a kongo », comme manifestation identitaire des Massembo, nous verrons comment ce choix identitaire vécu et assumé a été préjudiciable pour cette famille.
1. Identité vécue et assumée
Mas Kongo Karayib (mas maten) 10 février 2018 (KARATA)
- 5. Les Massembo de la première génération étaient arrivés en Guadeloupe avec le statut d’ « engagés volontaires » ou d’immigrés. Cela ne les avait pas - en réalité - placés socialement au-dessus des « affranchis ». Perçus par ces derniers comme des esclaves « déguisés », dans la mesure où ils venaient faire, à moindre coût, le travail laissé par eux, ces immigrés devenaient méprisables et étaient stigmatisés. Nous y reviendrons dans les prochains paragraphes.
- 6. En outre, ils étaient non seulement noirs mais aussi Kongos. Bref, tout y était pour les distinguer des Guadeloupéens - affranchis compris - et les maintenir dans une situation de quasi-parias de la société guadeloupéenne.
- 7. Par ailleurs, l’entreprise d’identification culturelle des Guadeloupéens, commencée dès les premiers temps coloniaux et dont les instruments essentiels furent l’église puis l’école, intéressa au même titre les descendants de différents groupes d’immigrants. Ils furent tous christianisés et fréquentèrent partiellement une école publique qui leur déniait tout particularisme. Chez les immigrés récemment débarqués, les insupportables railleries tous azimuts avaient, semble-t-il, du accélérer le processus d’acculturation.
- 8. Durant une première période, les Massembo avaient perpétué les traits culturels qui les distinguent, parce qu’ils ne pouvaient et ne savaient pas faire autrement : ils sont comme ils sont, ils n’avaient pas le choix ; c’est seulement dans une seconde période, c'est-à-dire récemment, qu’ils ont revendiqué ces traits distinctifs, qu’ils les ont affirmés comme volonté de résistance ethnique, en bref qu’ils ont faite d’une ancienne nécessité (subie) une nouvelle vertu (assumée, voire militante). Alors que nombre d’autres Kongos de la Guadeloupe avaient pris leur distance avec eux, seule la communauté « Rasta » de la Guadeloupe semblait leur manifester ouvertement son soutien. Bref, les lignes suivantes montrent bien comment la famille Massembo est enracinée dans la culture kongo.
1.1. Conserver et perpétuer les traditions culturelles
- 9. La famille Massembo avait toujours eu une haute idée de ses origines. Elle n’avait jamais voulu céder aux dénigrements. Ainsi, pouvons-nous rappeler, qu’au lieu de se fondre immédiatement dans la masse, d’abandonner ses traditions, ses us et coutumes comme l’avaient fait d’autres groupes d’immigrés soumis aux pressions psychologiques et aux conditions d’existence identiques, bien au contraire, elle avait, semble-t-il, préféré lutter envers et contre tout, pour défendre et conserver ce à quoi - d’une génération à l’autre - elle tenait fermement.
- 10. Les Massembo - tout au moins la première génération - avaient, par exemple, continué à s’exprimer en langue kongo. Cette langue que leurs détracteurs ne déchiffraient pas et qui faisait l’objet de moqueries : « Kongo ka palé wani wana ». Ils n’avaient pas abandonné le port des pagnes africains, la coiffure, les mets comme cela se faisait au pays Kongo ou proches des Kongos qui a été dénommé « soupe a kongo » ; c’est aussi le cas du cochon, de l’agouti, et du « gyembo, etc. ». Conformément à la description que les écrivains de l’époque avaient faite d’eux - les Kongos étaient travailleurs, gais, aimant danser, etc. Ainsi, semble-t-il, les Massembo profitaient de la moindre occasion, notamment du week-end, après un dur labeur, de se retrouver en famille ou avec d’autres Kongos derrière leur case pour chanter et danser, se raconter des histoires, des contes et légendes en langue kongo comme cela se faisait au pays kongo, sous un abri, parfois même à ciel ouvert au coin du feu, à l’image même de ce que les Kongos appellent communément « mbongi7 ». Mais, le phénomène le plus marquant, dans cette volonté de conserver les traditions, concerne l’émergence et l’institution du « grapp a kongo ».
- 11. C’est justement dans ce « grapp a kongo » que l’on trouve l’expression la plus significative et la plus symbolique de ce que les Massembo ont conservé et continue de perpétuer, comme traditions culturelles ancestrales kongos.
1.2. L’émergence du « grapp a kongo »
- 12. Rappelons de suite que le peuple kongo qui croyait déjà en un être suprême - Nzambi a mpungu - avait connu une double situation de contact avec les Européens. D’abord avec les Portugais qui entretenaient d’étroites relations avec l’ancien royaume de Kongo, avant l’instauration du régime colonial, ensuite avec les différents colonisateurs européens. Dans cette situation particulière, nombre de Kongos avaient été christianisés et même « catholicisés ». Par conséquent, la date du 1er novembre – fête de la Toussaint – ne leur était pas inconnue.
-13. Contrairement aux affranchis qui avaient déjà connu des décès de parents en Guadeloupe et par conséquent y avaient des sépultures, les Massembo nouvellement arrivés n’avaient pas encore enregistré des pertes dans la famille. Ainsi, en Guadeloupe comme ailleurs dans les Caraïbes, tous les 1ernovembre - c’était aussi la Toussaint - les Massembo voyaient des Guadeloupéens se rendre au cimetière, aller se recueillir et déposer des fleurs sur les tombes de leurs défunts. Eux, n’avaient donc pas de raisons d’y aller. Mais l’attachement à leur terre natale et aux traditions kongos ne leur permettait pas de sombrer dans l’indifférence. Ils devaient, me semble-t-il, eux aussi penser aux défunts dont les sépultures étaient restées au pays kongo. Pour eux, penser aux morts, c’était aussi croire que leurs esprits étaient là, vivants avec eux, et qu’ils avaient l’obligation de leur rendre hommage. Le moment était tout indiqué - la Toussaint.
- 14. D’autres amis Kongos, ayant les mêmes préoccupations pouvaient se joindre à la famille Massembo Ainsi, devaient-ils se regrouper à la manière d’une grappe de raisins pour célébrer, comme cela se faisait au pays kongo, le souvenir et la mémoire de leurs défunts. Il s’agissait, à la tombée de la nuit, en réunion (grappe), sur fond de battements de tam-tam (ngoma en langue kongo) ici« ka » accompagnés de chants en langue kongo, de danser, en ayant évidemment une pensée profonde pour les défunts, pour les ancêtres. Il semble que tout un ensemble de rites, étroitement liés aux traditions et symboles du pays kongo, avaient fini par se mettre en place à partir du moment où les Massembo commençaient à connaître des décès dans la famille et donc des inhumations. Rites qu’il fallait dorénavant observer.
- 15. Cette façon particulièrement ritualisée de célébrer la mémoire des défunts à la « kongo » que les Massembo avaient désigné par l’expression « grapp a kongo » n’était pas évidemment commune à tous les immigrés. C’était, me semble-t-il aussi, une façon de souligner leur attachement aux traditions culturelles du pays d’origine qu’ils entendaient perpétuer. Cette pensée pour les morts n’étaient donc pas dans le même esprit que chez les catholiques de la Guadeloupe même si, au fil du temps les membres de la famille Massembo devaient finir par s’intégrer10 dans la société guadeloupéenne et se convertir au christianisme - la plupart étaient devenus catholiques. Nonobstant cette démarche, ils n’avaient pas cessé de revendiquer leurs origines et les traditions culturelles qui allaient avec. D’ailleurs la conversion au christianisme n’a jamais empêché bon nombre d’Africains de continuer leurs pratiques animistes ou simplement ancestrales. Mais, dans cet environnement et ce contexte particuliers marqués par l’assimilation des normes et valeurs nouvelles (guadeloupéennes), il n’était pas toujours facile d’afficher ses particularismes. C’est dans un cadre strictement privé que le « grapp a kongo » devait avoir lieu, à l’abri des regards indiscrets, c'est-à-dire dans ou derrière la case, sur l’habitation.
- 16. Les Massembo des générations successives avaient perpétué cette tradition culturelle. R. À., âgée de 85 ans, doyenne de la famille et Violette sa cousine complice (décédée en 2002, à 73 ans) n’avaient pas failli à leur tâche. Elles s’étaient employées à transmettre, aux dernières générations (quatrième et cinquième) un héritage que malheureusement d’autres Guadeloupéens d’origine kongo n’avaient, semble-t-il, pas pu, pas su, pas voulu conserver. C’est à Cambrefort, précisément à la cour, loin de l’habitation que les deux cousines et leurs descendances respectives allaient poursuivre la célébration du « grapp a kongo ». Selon l’historien J.C. Blanche (1994), le « grapp a kongo » serait le seul témoignage connu de type dans toute la Caraïbe, différent des pratiques collectives religieuses du rituel « Palomonte » cubain, du « Kumina » jamaïcain ou du « Petro » dans le vaudou haïtien, tous pourtant d’essence kongo.
1.3. Le « grapp a kongo » : une cérémonie unique
- 17. Juste avant vingt heures, dans une nuit bien confirmée par les chants des grillons et des cigales, la mise en place de tout le dispositif matériel nécessaire au bon déroulement du « grapp a kongo » est terminée. C’est-à-dire que les lampes sont allumées pour éclairer la scène, les batteurs de ka et gwo ka ont installé leurs instruments et le sonorisateur a fini de faire sa balance. Autour de vingt heures, les premières personnes qui viennent assister à la cérémonie commencent à affluer tandis que les participants à la cérémonie commencent à occuper la scène.
- 18. C’est R. A., la maîtresse de cérémonie qui dès qu’elle juge le moment favorable - souvent dès 20h30 parfois même 21 heures - « jette le grapp ».Elle entonne la première chanson comme le faisaient ses ancêtres au pays kongo et tel qu’elle l’a appris auprès de sa grand’mère, se targue-t-elle souvent de dire : « eh yayê, sola ya me sola » ; « zebi sola »), répond le chœur. Ainsi, le ton est donné et les batteurs de « ka » et « gwo ka » s’exécutent. Aussitôt, les participants flambeau à la main, à la file indienne, précédés du corniste, J., sortent de l’espace « sacré » pour emprunter le petit chemin qui monte jusqu’à la hauteur du bosquet situé derrière les cases. R. A., le linge blanc suspendu au bras gauche et l’assiette blanche contenant du rhum portée par la main gauche, tient dans la main droite une branche de « mukuénia » qu’elle trempe de temps en temps dans le rhum avant d’en asperger les participants et l’assistance nombreuse. Celle-ci forme une haie pour laisser passer la procession. Une fois rendue à la hauteur du bosquet où les ancêtres sont sensés reposer, la personne qui porte le fusil se détache de quelques mètres, le canon pointé en l’air en direction du bosquet et le coup est parti. L’invitation est faite aux ancêtres Massembo qui doivent venir prendre part à la cérémonie qui a lieu en leur honneur.
-19. Une fois posé ce premier acte, révérencieux à l’endroit des ancêtres, sur fond de « sola ya me sola », la procession regagne la scène et termine ce premier chant par une dernière aspersion de rhum. S’ensuit un enchaînement de chants et danses à un rythme régulier grâce à un répertoire soigneusement mémorisé - tradition orale oblige - par la maîtresse de cérémonie R. A. et V. Massembo sa complice. Ce sont elles ont, l’une ou l’autre, qui ont ce privilège de lancer les chants, et aux autres d’assurer le chœur, non seulement parce qu’elles sont toutes deux doyennes de la famille mais aussi elles ont exclusivement gardé en mémoire tout le répertoire. Côté rythmique des « ka » et « gwo ka », R. A. et Violette peuvent compter sur des batteurs qui sont eux-mêmes de la famille et connaissent bien les différents tons des chants qu’ils ont l’habitude d’accompagner depuis longtemps. Il n’empêche que, à l’instar des chefs d’orchestre chevronnés, dès qu’il y a le moindre relâchement ou emballement du rythme, l’une ou l’autre des doyennes, d’un simple regard ou d’un mouvement de la main suggère de ralentir ou d’intensifier le rythme. Il convient de bien noter que c’est sur les chants et la danse que repose le « grapp a kongo ». D’où l’intérêt qu’y accordent les participants qui doivent s’appliquer. Comme cela se fait souvent dans les fêtes africaines où chants et danses sont naturellement mêlés, il est toujours un moment où un participant se détache pour montrer son savoir-faire en matière de danse.
- 20. À minuit, l’ensemble des participants quittent la scène pour aller se changer. Quelques minutes plus tard, ils réapparaissent sur la scène, tous de blancs vêtus. Après avoir réédité quelques chants et danses, ils entonnent de nouveau le « sola ya me sola, zébi sola…» - qui a servi d’ouverture de la cérémonie et d’appel aux ancêtres, quelques heures plus tôt. Puis derechef, scénario à l’identique, à la file indienne on va raccompagner les ancêtres là-haut, un coup de fusil est tiré en l’air avant de regagner la scène. Sur la scène, deux ou trois chansons sont entonnées, c’est là-dessus que R. A. va mettre fin à la cérémonie, et rendez-vous pour l’année suivante. Mais cette prise de rendez-vous ne signifie pas que la soirée est terminée puisque le « grapp » - couramment dit - fait immédiatement place au léwoz. L’espace sacré se mue en espace ouvert à tous ceux qui veulent faire la fête jusqu’au petit matin.
-21. La coutume est que le lendemain, aux alentours de midi, tous les membres de la famille et ceux des amis qui ont pris part au « grapp » se retrouvent chez Violette pour un repas ritualisé composé de « poyos » (bananes vertes) d’ignames et de morue ou de queue de cochon. En même temps s’ouvre une séance d’autocritique au sujet de la cérémonie de la veille. On se raconte des histoires, on se congratule, se taquine, se moque des uns et des autres et on en rit. Pendant ce temps, les amateurs de rhum ne se font pas prier, ils « décollent » avec « le feu », disent-ils. On est heureux ensemble, n’est-ce pas ? L’esprit de famille ne fait que se renforcer : « nous sommes des Kongo »se plaît-on à répéter.
-22. Ainsi a-t-on pu comprendre que, comme c’est le cas du carnaval chez d’autres Guadeloupéens, la cérémonie du grapp a kongo reste un moment unique et hautement symbolique sur le plan identitaire chez les Massembo. Une cérémonie enracinée sur un territoire également riche en symboles. C’est un rendez-vous que chaque membre de la famille attend impatiemment et auquel il se prépare aussitôt la cérémonie terminée pour l’année suivante. Tout se passe comme si cette rencontre avec les ancêtres était vitale, une façon de renouer avec les morts, les ancêtres Massembo. Chacun semble y puiser les ressources nécessaires pour affronter les « roches grondantes » de la vie quotidienne et surtout l’élan nécessaire pour continuer à perpétuer la tradition kongo.
-23. Si de façon générale les éléments d’origine kongo mobilisés dans le « grapp »ont, à quelque détail près, conservé leur authenticité, on peut repérer quelques changements. Il est tellement rare de ne pas en observer - quelle que soit leur importance - notamment lorsqu’il s’agit des catégories qui ont trait à la culture.
-24. Mais dans ce contexte particulier de la société guadeloupéenne, affirmer son identité comme l’a fait la famille Massembo a un coût psychologique.
2. Assumer son identité Kongo : le prix à payer
2.1. « Kongo Nwè » ou « Nèg Kongo » : être Noir Kongo en Guadeloupe
- 25. La base actuelle de peuplement guadeloupéen résulte de l’époque coloniale. Elle est composée des descendants des colons blancs et des esclaves noirs. La population noire qui représente environ 28% de la population globale comprend évidemment les descendants des esclaves noirs, déjà socialisés dans le cadre de la société locale, mais également des « nègres kongos » venus suppléer à la pénurie de main-d’œuvre, après l’abolition de l’esclavage (1848) et qui se sont installés en Guadeloupe au terme de leur contrat de 10 ans. Nous l’avons également notée, ces « Nèg Kongo » qui arboraient une culture différente et n’étaient pas métissés, étaient donc considérés comme de véritables sauvages de la brousse et faisaient l’objet des pires railleries. Ils avaient aussi, semble-t-il, inspiré le « mass a kongo » (masque kongo), expressément noirci à la suie, reproduisant la figure de l’homme primitif, agressif, etc. Ce masque était présent dans les carnavals. D’ailleurs « Dans l’inconscient collectif guadeloupéen, le Kongo est le nègre noir très foncé, sauvage. Cette image négative de l’Africain est un vestige du colonialisme qui s’est toujours efforcé de nous présenter l’Africain comme différent de nous… Les Kongos s’arrangeaient pour être vraiment effrayants et hirsutes et terrorisaient ainsi les enfants. Surprenant que dans un pays où 90% de la population est négro-africaine, l’on s’amuse à se faire peur »(Belair, 1982).
- 26. Ceci montre, comme l’a souligné Jean Benoist (1972), la difficulté à consolider les identités sociales immensément apparues en rapport avec les violences symboliques héritées de l’institution esclavagiste. L’intériorisation du préjugé de couleur où se mêlent attributs sociaux et caractères somatiques, est à la base du reniement de ses appartenances culturelles et produit des retentissements graves sur la psychologie et sur la construction de l’image de soi. Il s’agit pour l’Antillais d’un « préjugé contre lui-même » (Lirus, 2000 : 31). Être Noir mais Noir ébène ou « nèg nwè » (Nègre noir) n’a pas été et n’est certainement pas encore une chose facile à assumer pour nombre d’Antillais.
-27. D’ailleurs, « Dans la littérature de l’époque esclavagiste parlant de la traite, on rencontre le terme de Bois d’ébène, objectivant au plus haut point la marchandise humaine africaine. Sur la plantation, on appelait les derniers arrivés par bateaux négriers congos par opposition aux créoles, nés sur la plantation. Congo est aujourd’hui une insulte raciste dans le français régional martiniquais » (Michelot, 2007). Il semble que cela vaut également pour la Guadeloupe.
-28. Chacun sait donc que pour le commun de l’Antillais, être Noir était synonyme d’esclavage et de misère et être Blanc, synonyme de liberté et de richesse. Et que pendant l’esclavage, la promotion sociale était quasiment impossible puisque la fonction sociale d’un individu était fonction de sa couleur de peau. Restait chez nombre d’Antillais, l’espoir d’avoir des enfants à la peau claire. L’on aura donc compris qu’être à la fois Noir et Kongo représentait la pire des positions sociales dans une société où l’ordre ethnique a pendant longtemps fixé l’ordre social. Le Noir Kongo est donc enfermé dans les stéréotypes, « au sens de représentation, image ou perception des attributs d’un groupe. Ces stéréotypes ont été appréhendés de manière purement négative, comme un mode de pensée irrationnel et primitif » (Rauzduel, 1998). Le Noir kongo fait l’objet d’un préjugé défavorable. Le préjugé étant défini, selon Roger Bastide (1967) cité par Rosan Rauzduel comme : « un ensemble de sentiments, de jugement et naturellement d’attitudes individuelles qui provoquent ou, tout au moins favorisent, et même parfois simplement justifient, des mesures de discrimination ».
-29. L’appellation Kongo était tellement chargée - et sans doute encore aujourd’hui - que nombre de Kongo, toutes catégories sociales confondues, préféraient taire leurs origines. Même si de par leurs patronymes, ils demeurent identifiables.
2.2 Une famille stigmatisée et marginalisée : les Massembo de Cambrefort-Moravie
Alphonse et Marie-France Massenbo
-30. Le choix des Massembo de ne pas laisser s’effilocher toute leur culture d’origine les avait placés dans une situation dont les conséquences, au plan social et psychologique ne sont pas négligeables. Stigmatisés, ils l’étaient dans cette Guadeloupe qui ne regardait pas d’un bon œil, les « Nèg Kongo ».
-31. Le « grapp a kongo », patrimoine familial légué par les ancêtres était le principal symbole de leur identité kongo. Cela ne fait pas de doute, les Massembo avaient compris très tôt l’importance de l’affirmation identitaire mettant en avant ce que l’être humain pouvait avoir de plus cher, en l’occurrence la culture, dans une société dont la tendance était à l’assimilation. Rose-Aimée, rapporte ceci : « grand’mère nous disait souvent que le grapp devra continuer, c’est notre culture. Alors elle nous apprenait comment faire ». Mais affirmer son identité, pour les Massembo, impliquait quotidiennement de faire face à des situations humainement et socialement désobligeantes comme la marginalisation. C’est, semble-t-il, dans la forte conviction d’exister pour eux-mêmes et dans la haute idée qu’ils se faisaient de leur culture qu’ils puisaient les ressources nécessaires pour continuer ce que certains ont appelé la « résistance », nous dirons la contre acculturation.
-32. De cette culture, c’est surtout la cérémonie du « grapp a kongo » et toutes ses composantes - rituels et autres chansons kongos devenues indéchiffrables par les Massembo et par d’autres Kongos - qui a survécu. Il convient donc de préciser que les générations successives des Massembo avaient fini par s’acculturer à l’environnement créole, assumer cette culture créole que nombre de Guadeloupéens avaient, à un moment donné, mis sur la balance. Elles n’avaient gardé du parler kongo que quelques mots ou expressions dont elles ignoraient parfois le sens. La cérémonie du « grapp a kongo » dont nous parlons avait, semble-t-il, souvent suscité moult interrogations chez de nombreux Guadeloupéens qui faute d’être suffisamment renseignés s’étaient laissés aller dans les préjugés et les affabulations. Si en plus de parler le créole, les Massembo devaient vivre leurs traditions culturelles ancestrales non comprises, ils avaient donc réuni toutes les conditions pour faire l’objet d’une stigmatisation et d’une marginalisation.
- 33. Même certains Kongos qui avaient perdu tout ou partie de leur culture d’origine n’osaient pas s’approcher de cette famille, car il fallait une dose suffisante de courage pour devenir ami d’un stigmatisé, n’est-ce pas ? Sans digression avec le propos que nous venons de tenir, nous pouvons faire une analogie avec la stigmatisation dont les populations pygmées font l’objet au Congo et ailleurs en Afrique centrale. Les Bantous considèrent les Babongos comme des sous-humains, des personnes de seconde zone. « Les Bantous disent que nous sommes malpropres, que nous sentons mauvais, que nous ne nous lavons pas et que nous sommes des vauriens et ils nous tiennent à l’écart ». Cette assertion plaintive d’une femme pygmée traduit une profonde souffrance morale, identique à celle qu’expriment les Massembo.
- 34. Il semble que cette stigmatisation à outrance avait pu générer un ostracisme dont les Massembo avaient souffert en silence, comme en témoigne de manière anecdotique M.-F. Massembo : « je disais que là où on est à Cambrefort, cela ne fait même pas 30 ans depuis qu’il y a de l’eau courante. Avant nous allions chercher l’eau à un endroit où il y avait une source. Il y avait un gars de la communauté indienne, donc un Indien, qui en revendiquait la possession parce qu’elle se trouvait, disait-il, dans sa propriété. Il se rendait donc compte, par exemple, que le matin telle famille et telles autres familles étaient déjà passées s’approvisionner en eau et que la famille Massembo n’était pas encore passée, il arrachait la gouttière, le bambou qui servait de conduit d’eau, de telle sorte que nous ne puissions pas nous approvisionner en eau. Alors une fois sur les lieux et constatant ce méfait, nous nous contentions du peu qui stagnait là et repartions avec ».
- 35. Il apparaît aussi clairement que cette sorte de marginalisation n’était pas particulièrement d’ordre ethnique, puisqu’il n’y avait pas que des Indiens anonymes qui la manifestaient. Elle était aussi caractérisée dans certaines institutions publiques pourtant chargées de socialiser les enfants, c’est le cas de l’école où certains de ceux qui avaient la charge d’enseigner le vivre ensemble, au-delà des différences ethniques semblaient oublier leur rôle, insista M.-F. Massembo : « quand j’ai passé mon CEPE (Certificat d’Études Primaires Elémentaires), je me souviens que mon maître – qui avait l’habitude de rire de moi - se trouvait dans la même salle que moi, et comme il voulait faire rire l’autre examinateur en se moquant de moi ; il lui avait dit que ma mère était Kongo et chantait le « gwo ka » et qu’on faisait grapp. Mais l’autre examinateur ne riait pas, il ne trouvait cela pas risible… ».
- 36. Au-delà de la commune de Capesterre Belle Eau, les Guadeloupéens qui avaient eu écho de l’existence des Massembo, parlaient d’eux avec mépris, en exagérant parfois les traits. C’est ce que rapporte encore J. Massembo : « on nous prenait pour des gens très pauvres qui vivaient dans la saleté, dans la boue, parmi les immondices, les boîtes de Nestlé. C’est ainsi qu’on nous présentait partout. Nous vivions dans des taudis, des cases en bois. Une fois, un journaliste est venu de Pointe-à-Pitre pour s’en convaincre, de ses propres yeux. En arrivant à Cambrefort, il a demandé où se trouvait la famille Massembo On lui a dit qu’il ne fallait pas qu’il y aille parce que ce sont des gens infréquentables. Il y est malgré tout venu et s’est lui-même rendu compte que cela était faux »…
- 37. Lorsque des individus ou des groupes d’individus se sont forgés une opinion sur un fait social dont ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants, parfois même les témoignages les plus précis ne suffisent pas à servir de démenti. Ainsi peut-on considérer que ce spécialiste des média venu faire le « Saint-Thomas » chez les Massembo n’y est pas parvenu, car les Massembo ont semble-t-il continué à passer pour ce qu’ils ne sont pas : « il y a une manifestation qui a lieu souvent dans différentes communes les week-ends - le lewoz -. Nous avons l’habitude d’y aller mais en groupe. Comme nous étions toujours rejetés, marginalisés, nous avions décidés de nous déplacer, de nous y rendre en groupe parce que nous nous sentons plus forts comme ça. Mais lorsque nous arrivions dans les « léwoz » les gens disaient ironiquement aux autres : « poussez-vous, poussez-vous, voici les Massembo ». Ensuite, ils nous disaient : « vous n’allez pas danser ? Allez, dansez, allez dansez ! ». Alors qu’eux aussi savent parfaitement danser et que nous ne dansions pas mieux que tout ce monde présent sur les lieux. Mais par rapport à notre identité, à notre culture, c’est nous qu’on envoie vers le tam-tam (le « ka ») ». Le « léwoz » et le parler créole sont considérés comme rétrogrades et donc réservés au « bas peuple ». C’est donc tout naturellement que les gens se tournaient vers les Massembo - les voyant arriver - considérés comme faisant partie de cette catégorie de personnes.
- 38. Conscientes et soucieuses des dégâts psychologiques que cette situation quotidiennement invivable peut causer aux enfants, Rose-Aimée et Violette, les deux doyennes d’âge de la famille, préparaient leur progéniture à se doter d’un moral d’acier et surtout du sens de la répartie : « … maman avait des réponses à ce genre de provocations, elle nous disait de répondre de telle ou telle façon. Par exemple, elle nous disait de répondre par des mots kongo : « njini kya nguaku » ou « kunia mamau » ou encore « funi ya mamau ». Surtout nous ne devions pas parler créole, car on se moquait de nous. Parfois on nous bousculait ou même, à l’école, on nous attachait un objet répulsif (os de bête, une boîte de conserve pleine de saletés, etc.) autour du cou… » (M.- F.).
- 39. La stigmatisation, le discrédit et la marginalisation subséquentes avaient eu des conséquences, semble-t-il, incommensurables dans la vie sociale des Massembo notamment chez lez jeunes filles :… « Les hommes avaient peur de sortir avec des filles Massembo parce qu’elles étaient considérées non seulement comme sales mais aussi sorcières, elles font des pratiques magiques. D’ailleurs, jusqu’à ce jour, cette peur n’a pas encore tout à fait quitté nombre de gens ici », rapportait J. « À l’école où je travaille, il y a un enseignant qui m’embêtait. Dès qu’il a su que j’étais une Massembo, il a arrêté. Il m’a laissé tranquille », complète M.-F.
- 40 On peut imaginer la pression sociale dont ils faisaient l’objet au quotidien, et en tous lieux, tels des parias. Il fallait s’armer de beaucoup de courage pour aller affronter les regards et les réflexions humiliantes des autres. Mais, parfois, le courage n’était pas au rendez-vous notamment pour les plus jeunes Massembo : « on se moquait tellement de nous que parfois nous étions obligées de faire l’école buissonnière. On avait peur d’aller à l’école. Quand tu montes dans le bus, tu baisses la tête parce que tu as tellement honte de toi-même et tu ne veux pas qu’on te reconnaisse et qu’on se moque de toi : « Kongo Nwè ».
- 41. Il semble, que ce ne soit pas démesuré de parler ici de traumatisme psychologique comme cela apparaît clairement dans les propos précédents. D’ailleurs, comment comprendre que le seul fait d’entendre quelqu’un prononcer le mot kongo générait une vague d’angoisse chez les Massembo : « lorsque A. Nz. avait téléphoné chez nous, après avoir vu le nom de Massembo dans l’annuaire téléphonique de la Guadeloupe, pour nous dire qu’il était Kongo (Congolais), nous l’avions pris pour un méchant plaisantin, qui voulait encore se moquer de nous. Car le simple fait d’entendre le mot kongo nous donnait des frissons tellement que ça nous faisait très mal au cœur pour en avoir souffert » (M.-F. Massembo). Toute proportion gardée, on peut comparer cette tendance à l’ « infra humanisation » des Massembo à celle subie par les Noirs en général à un moment donnée de l’histoire de l’humanité dont nous venons de nommer les conséquences. Les propos suivants de M.-F. le confirment encore à travers ces propos : « avant, je n’avais plus confiance en moi. Quand j’ai rencontré mon mari, j’avais honte de lui dire que c’est ma maman qui faisait le grapp. C’est comme un gamin à qui en classe, on répète souvent « t’es nul, t’es nul ». Finalement, j’avais mis dans ma tête que j’étais nulle, ma famille aussi. J’avais honte. Je ne pouvais penser qu’on aurait pu m’épouser moi. Mon mari a eu beaucoup de courage pour m’épouser, Dieu seul sait s’il n’a pas vécu de pression sociale afin de me laisser tomber ». Il faut bien comprendre que le nom est de ce fait le lieu de tous les enjeux subjectifs et collectifs. Porter le nom patronymique « Massembo » devenait difficile, en Guadeloupe et particulièrement dans la commune de Capesterre Belle-Eau. Ce patronyme compromettait parfois les relations sociales : « nous avions du mal à entretenir des relations durables où tout simplement nous faire aborder par des garçons parce ce que nous sommes des Massembo. Nous en avons souffert et en souffrons encore », font remarquer des jeunes filles de la famille. Cette stigmatisation avait pris des proportions telles que les Massembo croyaient leur sort définitivement noué, jusqu’au jour où cette rencontre « salutaire » avait eu lieu comme nous allons l’apprendre ci-dessous.
- 42. Passionnant et émouvant, ce récit circonstancié est bien celui de la sortie des Massembo des ténèbres. Aujourd’hui, ils vivent pleinement dans leur être la lumière.
2.3. Des ténèbres à la lumière
- 43. Rappelons avant tout qu’en arrivant en Guadeloupe en tant qu’émigrés (engagés), les Massembo avaient bénéficié d’une relative liberté d’organiser leur vie sociale, contrairement à leurs frères de la période esclavagiste. La vie en groupe leur avait permis de mieux résister à la pression assimilationniste et aux railleries de tous genres. Il semble aussi que, pour être plus à l’abri de leurs détracteurs, ils devaient souvent vivre leurs traditions loin des yeux et des oreilles indiscrètes, en l’occurrence derrière leur « kaz a blanc » quand ce n’était parfois à l’intérieur.
- 44. Mais, se transmettant d’une génération à l’autre, ces traditions vécues avaient au fil du temps, fini par devenir un secret de polichinelle. Ces pratiques culturelles dont l’existence était désormais connue des autres Guadeloupéens, sans pour autant en percer les « mystères » ne pouvaient que générer stigmates et marginalisation comme nous l’avons montré ci-dessus. L’on comprendra donc facilement que porter et vivre ses traditions culturelles dans un contexte et un environnement socioculturels aussi chargés que celui de la Guadeloupe ou de la Martinique, n’était jamais chose facile. Cela nécessitait plus qu’un simple courage. Car non seulement la famille Massembo campait sur ses traditions culturelles kongos, mais aussi partageait et revendiquait sa créolité, ce qui, semble-t-il, n’avait jamais été ni du goût de nombreux Guadeloupéens ni de leurs voisins et frères Martiniquais dont la propension à se rapprocher de la culture de l’ancienne métropole était affichée. On remarquera par exemple qu’en privé comme en public, les membres de cette famille avaient et ont tendance à s’exprimer plus en créole qu’en français. Le cas de Violette Massembo qui, pourtant capable de parler français, avait juré ne prononcer un seul mot français en est la confirmation. Elle en fit encore la démonstration, lorsque vivant dignement ses derniers moments dans le lit d’hôpital et face à des médecins non « créolisant » qui lui posaient des questions, répondait en créole.
- 45. Le fait d’être Noir et Kongo, de vivre et d’assumer ouvertement ses traditions culturelles, comme nous venons de le montrer ici et ci-dessus et les conséquences lato sensu qui en découlaient, avaient rendu malaisée la vie de cette famille, au point parfois - ne comprenant pas cette sorte d’ostracisme - d’avoir la tentation d’arrêter le « grapp a kongo ». Mais, semble-t-il, chaque fois que leur effleurait cette idée de tout laisser tomber pour abréger leurs souffrances, la conviction qu’ils avaient du bien-fondé de leur manifestation traditionnelle, venait les encourager à continuer, jusqu’au jour où avait sonné le téléphone permettant une rencontre inattendue.
- 46. Nous comprendrons que cette rencontre avait eu lieu à une période où les interrogations et la remise en question de la poursuite du vécu identitaire étaient manifestes. Tout s’était donc passé comme si le visiteur accueilli par la famille Massembo, avec enthousiasme sur fond de méfiance et d’étonnement, était le libérateur venu les sortir d’une situation qui devenait on ne peut plus intenable. Il avait suscité une sorte de catharsis. En effet, dans cet instant, rien de mieux ne pouvait arriver à cette famille que de se laisser entendre dire, avec certitude et émotion non dissimulée, par un Kongo sorti du Congo et féru de l’histoire des Kongos, que tout ce qu’elle chantait était -à quelques détails près - des chants kongos. Et que cela ne relevait pas de l’invention. Peut-on se rendre compte à quel point ce moment particulier où cette famille est rassurée sur son identité constitue à la fois psychologiquement et socialement un véritable bouleversement. Comme ne cesse de le dire J. : « depuis ce jour-là, j’étais né pour la deuxième fois et j’avais pris de l’assurance. Quelque chose venait de changer en moi, je n’étais plus le même, alors je pouvais marcher droit et fier d’être un Massembo, un Kongo vrai. Comme si je venais de finir mon deuil, car je portais depuis longtemps des « dreads locks » que j’avais enfin décidé de couper». C’est un sentiment que partagent tous les membres de la famille Massembo.
- 47. Il semble pourtant que cette rencontre qu’on pourrait qualifier de privée, puisque s’étant déroulée sans d’autres témoins que M. Mb. (musicien des Palatas et ami de A. Nz.) et surtout dans un cadre familial, à la cour Masembo, n’avait pas suffi à donner plus d’assurance à cette famille. Elle se sentait porter vers un meilleur chemin, certes ; encore fallait-il que cela soit su du public Guadeloupéen. Des occasions s’étaient multipliées avec la presse locale où celui que les Massembo appellent toujours, « notre Christophe Colomb Kongo », devait attester de l’authenticité des traditions culturelles de cette famille longtemps méprisée. Cette démarche était une réussite, puisque les Massembo n’ont jamais cessé d’être sollicités par les médias de toutes sortes, et leur manifestation - le « grapp a kongo » - d’attirer beaucoup de monde. C’était pourrait-on dire, la consécration et la reconnaissance publique. Mais la plus significative des reconnaissances est celle des pouvoirs publics, en l’occurrence la commune de Capesterre Belle-Eau.
Conclusion
- 48. La première génération des Massembo qui avait fait le choix de préserver les traditions culturelles kongos en Guadeloupe était loin d’imaginer son importance et ses conséquences. Ces traditions incarnées par la cérémonie du « grapp a kongo » leur ont survécu. Elles sont restées vivaces, plus de 150 ans après. Préserver et entretenir cet héritage, symbole de leur identité, étaient devenus le leitmotiv et le combat quotidien de la famille Massembo. Ce combat n’a pas été vain puisque le « grapp a kongo » a eu la reconnaissance et le soutien des instances politico-administratives de la Guadeloupe et des médias. Cette reconnaissance passe également par les témoignages d’autres Kongos de la diaspora et du Congo, comme ce Congolais venu convaincre la famille Massembo de l’authenticité de ces traditions culturelles. Les railleries et autre marginalisation - conséquences de leur choix identitaire - n’étant plus qu’un mauvais rêve, aujourd’hui, c’est avec assurance et fierté que les Massembo continuent, tous les 1er novembre, de célébrer le « grapp a kongo »qui cristallise le désir de réappropriation d’une africanité perdue et fantasmée par de nombreux Guadeloupéens. Il attire donc une foule considérable, composée de curieux, voire de touristes au risque de le transformer en un simple rendez-vous folklorique.
- 49. Nous nous trouvons en présence d’un cas profondément ambivalent du processus en cours, au moins sur deux registres. D’une part, la cérémonie, et par là-même, la famille Massembo, sortent de l’ostracisme et du dénigrement. La reconnaissance de sa dignité, de la valeur du patrimoine qu’elle a su maintenir ; la liberté de s’affirmer en tant que Massembo et Kongo, la fierté d’être ce qu’on est, l’ouverture sur le vaste monde, la transmission du patrimoine à la jeune génération ne font plus aucun doute. Mais, cela passe par un glissement du cérémoniel au spectaculaire, du traditionnel au folklorique.
- 50. D’autre part, la notoriété du « grapp », sa survie en spectacle, les discours et la légitimation idéologique de cette fidélité à « l’Afrique des origines », avec tout ce qu’elle suppose en matière de croyances, alimentent ce glissement.
- 51. Si l’étude du « grapp a kongo » a mis en évidence par ailleurs les difficultés d’être Kongo en Guadeloupe et in extenso en Martinique, puisse-t-elle inciter des chercheurs à mieux faire connaître leur histoire et leur contribution dans la formation de la « société et la culture créoles ». Ceci consolidera leur affirmation identitaire et la fierté d’être Kongo.
Justin-Daniel Gandoulou
Études caribéennes
Les noms bakongo en Guadeloupe
- Choucoutu
- Condé
- Diboula
- Dendelé
- Dongal
- Gombo
- Loumengo
- Maes
- N’Dendélé
- Ndendé
- N’Goma
- N’guéla
- Siba
- Simba
- Sombé
- Soumbo
- Tacita
- Tagliamento
- Pambo
- Zodros
- etc
les patronymes à résonance Kongo existant à Marie Galante :
- Sombé = N’Tsombé – Soumbo = Soumba ou Soumbou
- N’Gom ou N’Goma
- Dongal = N’Donga ou Ndongala
- Siba = N’Tsiba
- Pambo = Pambou ou M’Pambou
- Zodros = N’Zondo
La plus célèbre est la famille Massembo qui occupe le quartier Cambrefort à Capesterre Belle eau.
C’est elle qui organise chaque année l’évènement Grap a kongo.
Les racines Kongo en Haïti
Le chercheur congolais en histoire et anthropologie socioculturelle des Noirs des Amériques, Arsène Francoeur Nganga, a retracé l’histoire de ce pays qui était d’abord une colonie française de Saint Domingue avant de devenir Haïti en 1804, et dont la population la plus nombreuse était des Bantu, principalement des esclaves en provenance du royaume Kongo.
Kongo à Cuba
kongo à cuba transformations d'une religion africaine
L’accent porté sur l’« invention » de l’« africanité » dans les religions afro-américaines, conçu comme un instrument de la concurrence pour la légitimité entre entrepreneurs religieux, tend aujourd’hui à faire oublier le débat classique sur les rapports historiques entre l’Afrique et l’Amérique. Pourtant les recherches initiées par Raimundo Nina Rodriguez, Fernando Ortiz, Melville Herskovits et Roger Bastide, dans lesquelles les éléments d’origine africaine ne sont pas conçus comme des artefacts idéologiques mais comme des faits positifs, ne sont pas épuisées. Le cas des religions bantu est particulièrement intéressant de ce point de vue car, comme l’a remarqué récemment Stefania Capone (2000), il a été négligé par les premiers afro-américanistes. La publication d’un ouvrage de Luc de Heusch (2000) comprenant un chapitre sur « Kongo en Haïti » nous incite à porter à notre tour notre attention sur « Kongo à Cuba ».
À la différence de nombreux pays d’Amérique, la présence démographique, culturelle et religieuse bantu à Cuba est patente, même si elle n’est pas aisément quantifiable. En premier lieu, les esclaves étaient classés à Cuba en fonction de leur origine. Même si les ethnonymes utilisés dépendaient plus des factoreries sur la côte africaine que des peuples eux-mêmes, une série de noms utilisés pendant la période coloniale renvoyait à la zone de peuplement kongo. Par exemple, lors de l’épidémie de choléra de 1833 à La Havane, 457 victimes sont enregistrées officiellement comme Congos. Plus généralement, à partir de témoignages d’anciens esclaves et de sources écrites, Fernando Ortiz mentionne en 1916 les termes motembos, mumbona, musumdí, mumbala, mondongos, cabenda, mayombe, masinga, banguela, munyaca, loango, musungo, mundamba, musoso, entoterá, qui désignent selon lui des régions ou des peuples kongo ou bantu (1975, p. 45). Selon les sources, entre 17 % et 24 % des esclaves africains entrant à Cuba de 1817 à 1843 étaient des Bakongo (Castellanos et Castellanos, 1988, p. 43). 59 1 SACO, 1960-1963, p. 343, cité dans THOMAS, 1971
De plus, une fois à Cuba, des associations d’entraide furent créées sur une base ethnique ; certains de ces cabildos étaient explicitement appelés « congo » . L’un des plus anciens recensés était le Cabildo Rey Mago San Melchor, fondé officiellement en 1792, bien qu’il existât probablement officieusement auparavant. Les manifestations publiques des cabildos étaient interdites à la fin du XIXe siècle, mais ils continuèrent à fonctionner de façon privée dans le premier tiers du XXe siècle. À La Havane en 1909, par exemple, on pouvait trouver dans le registre des associations du gouvernement provincial de La Havane les associations suivantes (Ortiz, 1992, pp. 12-13) :
- Congos Mambona, sous le patronage de Notre Dame de Regla, Cabildo africain. Secours mutuel.
- Congos Masinga, Société de secours mutuels, sous le patronage de Notre Dame de Montserrat.
- Cabildo de Congos Reales, Société de secours mutuels, sous le patronage du Christ du Bon Voyage.
- Cabildo Congo Mumbala, société de secours mutuels.
- La Caridad, Société de secours mutuels de la nation Congo Mobangué, sous le patronage de Notre Dame de la Charité du Cobre.
- Asociación Africana, Ancien Cabildode Congo Reales, sous le patronage de Notre Dame de la Solitude.
Enfin, sur le plan religieux, il existe un complexe mythico-rituel spécifique d’origine kongo à Cuba. Les premiers anthropologues qui se sont intéressés au sujet l’ont assimilé à une influence bantu dans la santería, sans voir que croyances, rituels et organisation du groupe des paleros étaient distincts de ceux des santeros. Avec L. Cabrera (1954), le palo monte mayombe (couramment appelé palo par les pratiquants) est clairement identifié comme une religion afro-cubaine spécifique, qui possède néanmoins de plus grandes variantes que la santeria . De plus, même si le terme mayombe, qui désigne une région boisée du pays kongo, était insuffisant à établir l’origine du palo, l’examen du vocabulaire rituel des paleros permet de rapporter l’immense majorité des morphèmes à des variantes du kikongo ou à des langues des ethnies limitrophes. González Huguet et Baudry (1967, p. 33) ont ainsi établi l’origine probable de 359 morphèmes : 141 proviendraient du ladi (ou laris), une variante dialectale du kikongo, 116 du monokutuba, 57 du lingala, 19 du kiswahili. Schwegler (1998, p. 139) va plus loin : pour lui, le vocabulaire rituel des paleros n’est pas un mélange de diverses langues bantu et d’espagnol, mais le résultat d’une transmission directe et d’une préservation claire du seul kikongo.
Si l’existence d’une religion d’origine Kongo est avérée à Cuba, cela ne signifie pas pourtant qu’elle se soit conservée à l’identique. Pour mesurer l’écart entre l’Afrique et Cuba et comprendre sa genèse, il faut partir des descriptions disponibles de la religion des Bakongo au temps de la traite, puis évaluer les transformations en fonction de sources ethnographiques cubaines contemporaines.
Comparant le palo monte et les religions bantu, Jesus Fuentes distingue trois types d’éléments : les composants bantu dans le palo monte, les composants étrangers à la culture bantu, les éléments bantu ayant disparu du palomonte dans le contexte colonial cubain (1994, p. 24). Il tente d’établir des rapports systématiques entre les deux religions, mais l’usage de sources africanistes trop générales et de données trop récentes ou trop anciennes entrave ce projet. Comme le montre Schwegler du point de vue de la linguistique (1998), il ne faut pas rapporter le palo monte aux religions bantu en général, mais bien à la religion spécifique des Bakongo au temps de la traite des esclaves . On infléchira donc les conclusions du chercheur cubain de ce point de vue, en mettant l’accent sur des processus plus que sur des résultats.
En plus des données disponibles dans la littérature ethnographique (principalement dans l’œuvre de Lydia Cabrera), je m’appuie ici sur une série d’entretiens réalisés entre 1994 et 1999 à La Havane et à Santiagode Cuba avec neuf tata ganga, qui sont des paleros expérimentés . Pendant la même période, j’ai aussi pratiqué l’observation participante lors de plusieurs fêtes de tambours, et recueilli des manuels ronéotypés qui s’échangent dans la communauté des paleros.
Ce type de sources a été négligé dans l’étude des religions afro-américaines, en particulier dans celle du palo monte. Il est vrai que le volume de documents en circulation concernant cette religion est très inférieur à ceux appartenant aux traditions d’origine yoruba à Cuba. Pourtant, l’un de ces manuels anonymes intitulé Conocimientos y practicas de palo monte comprend des informations qui relèvent à la fois de la mythologie, de la mémoire collective et de l’histoire. Se présentant sous la forme d’un livret de grand format ronéotypé de 93 pages, il s’agit d’un document composite dont la première partie (13 pages) est une copie démarquée de passages concernant le palo monte dans l’ouvrage El Monte (1954) de Cabrera. La suite du texte est annoncée dans la table des matières comme une série de « notes prises directement à partir de cahiers de vieux paleros, avec le consentement de leurs héritiers ». Trois cahiers de paleros sont ainsi copiés. On y trouve des listes de vocabulaire espagnol/congo, de recettes d’envoûtement ou de désenvoûtement, le texte de chants et de prières transcrits et des dessins associés aux esprits supérieurs, que l’on appelle firmas, des « signatures ». Ce document se révèle une source très précieuse pour étudier non seulement le lexique kikongo présent dans le palo monte, mais aussi pour comprendre la représentation à la fois historique et mythique de l’Afrique en vigueur dans la communauté des croyants.
Religion des Bakongo au temps de la traite des esclaves
MacGaffey distingue trois grandes périodes dans l’histoire des Bakongo jusqu’au début du XXe siècle (1986, Préface). La première est celle des « vieux royaumes », du XIIIe siècle de no tre ère à la fin du XVIIIe siècle. Lorsque les Portugais abordent les côtes du royaume du Kongo en 1482, il « est déjà puissamment établi. Il résulte du regroupement de multiples unités politiques en un État relativement centralisé, soumis à un souverain résidant dans une capitale » (Balandier, 1967, §1). Cette unité politique, qui comprend deux à trois millions d’habitants au XVIe siècle à l’ouest du Malebo Pool sur le fleuve Zaïre, se maintient malgré l’intervention des Européens, le développement de la traite des esclaves vers les Amériques et les dissensions internes. Des trafiquants et des missionnaires catholiques s’installent à Mbanza Kongo, la capitale qui est rebaptisée Saõ Salvador. Le roi se convertit au catholicisme et certains éléments du christianisme se diffusent dans la population.
Le royaume se défait complètement après la bataille d’Ambuila en 1665. Les Bakongo sont battus et la capitale désertée. Au début du XVIIIe siècle, une deuxième période commence, celle de l’éclatement du royaume en chefferies rivales. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les Européens délaissent l’intérieur des terres et se contentent de commercer sur la côte atlantique. C’est le temps de la traite massive vers les Amériques. Au XVIIIe siècle, le nombre d’esclaves déportés à partir de la zone Kongo est estimé à plus de 15 000 par an (Ade Ajayi et Crowder, 1988, p. 101). La troisième période commence avec l’occupation coloniale, l’implantation d’une administration coloniale à la fin du XIXe siècle et l’intensification des missions chrétiennes en pays Kongo. La société traditionnelle se déstructure alors largement sur tous les plans.
C’est la période de la traite qui nous intéresse le plus ici. Quelle était la forme de la religion des Kongo à cette époque ?
Il n’existe pas de source ethnographique antérieure à l’arrêt complet de la traite, soit les années 1860 dans le cas de Cuba. Néanmoins il existe des données fiables concernant la période juste postérieure. En effet, Karl Laman, missionnaire suédois, forma une équipe de jeunes Bakongo qu’il chargea de décrire les mœurs et coutumes de leur pays dans la première décennie du XXe siècle. Plus de quatre cents cahiers ethnographiques furent ainsi rédigés en kikongo par cette équipe. Conscients des transformations affectant leur pays, les jeunes ethnographes recueillirent des informations auprès d’informateurs âgés, notamment sur la question religieuse. À partir de ces cahiers, MacGaffey propose un tableau du système religieux traditionnel kongo, qui combine trois dimensions : un modèle actantiel (agents humains, intermédiaires spirituels, patients humains), une division éthique des actions opposant nuisance et bienfaisance, et une division politique opposant les sphères d’exercice public ou privé du pouvoir (d’après MacGaffey, 1986, p. 7).
Les ancêtres avec lesquels les chefs et les vieillards avaient des relations privilégiées étaient liés aux vivants par la filiation . Leur action pouvait être destructrice, mais elle était légitime : les chefs pouvaient les invoquer dans le cas où un membre vivant du lignage avait enfreint les règles du groupe. Ce type de rétorsion était publique : l’action du chef visait l’intérêt général. Au contraire, les fantômes n’appartenaient à aucun lignage ; il s’agissait de morts errants avec lesquels les sorciers passaient des pactes. Ces nkuyu étaient en fait des sorciers morts qui s’étaient vu refusé l’accès au village des ancêtres du fait de leur mauvaise conduite (ibid., p. 73). Ils hantaient donc la forêt, l’espace intermédiaire entre le lieu de résidence des vivants et celui des morts, et poursuivaient leur nuisance après leur disparition physique, avec la collaboration des sorciers encore vivants. On pourrait ajouter à la liste de ces fantômes ceux qui étaient morts assassinés ou à la guerre, ainsi que les suicidés. Le commerce avec les esprits errants était une affaire privée, car c’était une activité visant exclusivement à nuire à autrui, qui était condamnée en tant que telle par la collectivité. Alors que le pouvoir de répression du chef ou du vieillard se fondait en principe sur le respect de la norme collective dans l’intérêt général, le sorcier kongo ne poursuivait que son propre intérêt en attaquant autrui. Néanmoins, le caractère dangereux du pouvoir du chef et de celui du sorcier faisait que le premier était souvent soupçonné d’agir comme le second, c’est-à-dire à des fins privées.
Tout comme De Heusch (1971, p. 171), MacGaffey critique l’identification durkheimienne de tout rituel privé à un rituel maléfique. En effet, il apparaît qu’il existait chez les Bakongo des rituels maléfiques publics (la vengeance du chef) et des cérémonies privées bénéfiques. En revanche, « la distinction entre une magie blanche et une magie noire, à laquelle nous réserverons le terme de sorcellerie, est toujours présente à l’esprit des Bantous. Le sorcier et le magicien (ou plus exactement le sorcier et l’anti-sorcier) sont partout donnés ensemble, comme deux termes complémentaires, indissociables » (ibid.). Chez les Bakongo du début du siècle, le nganga bienveillant luttait contre le ndoki maléfique. Le nganga était en relation avec différents types d’esprits en fonction de l’échelle à laquelle se situait son action, selon le principe suivant : « Les pouvoirs les plus hauts et les plus généraux (c’est-à-dire ceux dont la signification était la plus clairement publique et collective) sont représentés par des formes relativement abstraites – vent, eau, phénomènes atmosphériques, blancheur – et les pouvoirs les plus spécifiques et particuliers par de complexes arrangements de matières organiques » (MacGaffey, 1986, p. 137). Schématiquement, le nganga intervenait donc dans deux types de situations.
Dans la première, il était en relation avec des pouvoirs locaux, les bisimbi, qui étaient plutôt attachés à une collectivité territoriale (un village par exemple) qu’à un lignage particulier. C’étaient des esprits bienveillants invoqués lors de cérémonies collectives. Les esprits bisimbi étaient tenus pour d’habiles techniciens, experts dans le tissage et dans le travail des métaux. Certains Bakongo pensaient qu’ils ressemblaient aux Européens, d’autres que c’étaient des ancêtres bakongo que les Blancs faisaient travailler à leur profit, ce qui aurait expliquer la grande richesse matérielle de ces derniers (MacGaffey, 1986, p. 81).
Dans la seconde, le nganga visait non à résoudre un problème collectif mais à soigner un trouble personnel. Rien n’unissait les clients d’un nganga dans ce cas, si ce n’était éventuellement un certain type de maladie. En effet, le nganga était en relation avec un nkisi que l’on considérait à la fois comme le responsable de l’affection et celui qui pourrait la faire disparaître. Le statut de ce nkisi est difficile à cerner : « le mot n’kisi est utilisé habituellement pour désigner les remèdes indigènes mais aussi les sculptures de bois », à condition que celles-ci aient été « chargées » avec les ingrédients actifs appelés bilongo (ibid., p.140). Tout récipient de ces ingrédients (sacs de cuir, gros coquillages, bouteilles, vases, etc.) pouvait être considéré comme un nkisi, notion qui n’était donc pas limitée aux « fétiches à clous » anthropomorphes ou zoomorphes qui ont focalisé l’attention des collecteurs d’objets d’art africain dans la première moitié du XXe siècle, et même bien avant eux des premiers Européens à se rendre au Kongo comme Duarte Lopez, pour qui les Bakongo « se choisissaient comme dieux des couleuvres, des serpents, des animaux, des oiseaux, des herbes, des arbres, diverses figures de bois et de pierre, des représentations des choses énumérées ci-dessus, peintes ou taillées dans du bois, de la roche ou une autre matière » (1963 [1591], p. 97).
Il faut néanmoins remarquer que le nksisi était aussi une entité spirituelle dotée d’une personnalité. Le bilongo à l’intérieur du récipient était le support matériel de cette puissance. Plus exactement, le complexe nkisi/bilongo était « une capture métonymique des esprits ancestraux au centre d’un piège métaphorique qui ne laisse aucune équivoque ni latitude » (De Heusch, 1971, p. 182). En effet, le bilongo réunissait des éléments métonymiques provenant substantiellement de l’esprit et d’autres devant lui transmettre métaphoriquement leur propriété. Dans le premier groupe, on trouve de l’argile blanche du lit d’une rivière, de la terre recueillie sur une tombe ou à un croisement, qui sont des lieux de résidence pour les esprits. C’est ainsi que l’esprit est « pris » dans le récipient. Le second groupe comprend tous les ingrédients appartenant au règne animal ou végétal qui lui donneront leur « force ». Ainsi, le nganga y incluait la tête de serpents venimeux, des dents de chiens ou de rongeurs, les griffes d’oiseaux de proies pour attaquer et déchiqueter les ennemis, des morceaux de corde et de filet pour les entraver, ainsi que toute sorte de plantes dont le nom rappelle un pouvoir dont on veut doter l’entité comme la noix de kola, mukazu, dont le nom ressemble au verbe « mordre », kazuna (MacGaffey, 1993, p. 62). La charge d’agressivité placée dans le nkisi laisse penser que la distinction entre pouvoir de nuisance et pouvoir de bienfaisance est pratiquement difficile à établir. La différence entre nganga et ndoki pourrait en fait être issue d’une variation de point de vue : pour le client du nganga, celui-ci est bénéfique puisqu’il identifie et combat le mal, mais comme bien souvent la maladie est rapportée à un ennemi bien vivant que le nganga se charge d’annihiler grâce au nkisi, ce nganga sera perçu comme un ndoki par la victime. Celui que l’on accuse de sorcellerie demandera alors de l’aide à un autre nganga, qui sera perçu comme un ndoki par la partie adverse, relançant alors le cercle de l’attaque sorcière et de la protection magique. Retenons ici que si la distinction entre magie positive et sorcellerie était opératoire au niveau des représentations, elle ne correspondait certainement pas à une opposition pratique réelle puisque le nganga répondait à l’attaque par la contre-attaque.
Comme on l’a indiqué plus haut, le contact entre Bakongo et Européens eut des conséquences politiques, économiques et religieuses. Dès le XVIe siècle, les missionnaires catholiques sont présents en pays kongo. Les jésuites, puis les capucins tentent d’évangéliser la population pendant toute la période de la traite des esclaves. Le roi se convertit dans les premières années de la présence portugaise, et certains éléments du christianisme se répandirent dans la population. La pénétration du catholicisme dans l’aristocratie bakongo fut assez profonde pour qu’un mouvement messianique vît le jour au XVIIIe, mené par une princesse nommée Dona Béatrice qui se disait inspirée par saint Antoine. Elle voulait restaurer le royaume du Kongo en réinstallant le roi dans la capitale San Salvador où elle affirmait que le Christ était né. Les capucins réprimèrent durement les « antoniens » avec l’aide des factions royales rivales de Dona Béatrice, qui périt sur le bûcher en 1706.
Hormis les classes dirigeantes, on peut néanmoins douter que le christianisme ait profondément pénétré les esprits bakongo avant la colonisation. Il semblerait plutôt que les symboles et pratiques catholiques se soient superposés aux anciennes traditions sur la base d’une correspondance formelle. Ainsi, la croix fut d’autant mieux acceptée que la religion traditionnelle faisait déjà usage de ce symbole. « Les anciens interdisaient aux enfants de tracer des croix sur le sol. Ils pensaient que Nzambi avait tracé des croix sur la paume de tous les humains au moment de leur création. Ils nommaient ces croix les chemins de Dieu », écrit Kunzi, un informateur de Laman au début du XXe siècle (Janzen et MacGaffey, 1974, p. 71). Des scarifications cruciformes sont aussi connues chez les Bakongo 11 (Ngoma, 1963, p. 104). Il est significatif que la première église érigée par le roi Afonso au début du XVIe siècle dans la capitale fût baptisée Sainte-Croix (Pigafetta et Lopez, 1963 [1591]). D’autre part, les symboles chrétiens s’ajoutèrent aux minkisi sans en affecter la logique opératoire. En 1857, par exemple, l’ethnographe allemand Bastian remarquait que des statues grandeur nature des pères capucins étaient promenées par temps de sécheresse dans la ville de Mbanza Kongo pour conjurer les aléas climatiques (cité par MacGaffey, 1986, p. 207). Quel que soit le degré de pénétration du christianisme dans la population, il est donc probable que les Bakongo déportés en Amérique aient eu un premier contact avec le christianisme. Cette hypothèse sera confirmée un peu plus loin dans le cas du palo monte.
Au temps de la traite, la religion des Bakongo était donc structurée par plusieurs grands principes. La première dichotomie sépare le monde des vivants de celui des morts. Mais il existe des points de passage entre ces deux « territoires » : les rivières, les cimetières, les croisements, les forêts. Certaines personnes peuvent entrer en contact avec les esprits, ce sont les chefs, les sorciers et les magiciens. Une deuxième dichotomie distingue le pouvoir de nuire du pouvoir de guérir, mais pratiquement, le pouvoir est toujours ambigu. Le chef est fréquemment accusé d’être un puissant sorcier, tout comme le magicien. Une troisième dichotomie permet de classer actions rituelles privées et publiques, les esprits actifs dans chaque sphère d’activité étant plus ou moins abstraits. Qu’est-il advenu de ce système à Cuba ?
Palo Mayombe
Le Palo Mayombe, plus simplement appelé Palo, est une religion syncrétique afro-américaine pratiquée à Cuba, et a Miami proche de la Santeria et du Candomblé. Il s'agit de croyances chamaniques africaines mélangées d'éléments de spiritisme, de magie et de catholicisme.
Présentation
Le Palo est une tradition en provenance du bassin du Congo amenée à Cuba par les esclaves dès le début du xvie siècle. La pratique s'articule autour d'un thème central, le "nganga" (esprit et puissance), construit selon un rite et un thème très précis, que manipule le prêtre "el Tata" (le Père) pour invoquer les morts en conjonction avec les forces de la nature et les esprits décédés (guides spirituels).
La religion est initiatique et secrète, le disciple, le Palero, reçoit son enseignement d'un maître qui lui révèle les secrets des forces naturelles, les codes, langage et cérémonies rituelles à très fortes consonances bantoues. Le palero est à la fois un guérisseur, devin, et prêtre avec une fonction sacerdotale et sociale bien ancrée dans la culture afro-cubaine.
À l'inverse de la santeria qui est d'origine Yoruba, le palo fonctionne par la manipulation de 2 forces, la Lumière (Nsambi) et les Ténèbres (Ndoki), pour leur application dans un but particulier. La cosmologie du palo, d'origine entièrement bantoue, est reliée à l'histoire des ramas, les branches du palo qui furent implantées par les différentes tribus, chacune ayant sa singularité linguistique et rituelle.
Dans son travail, le palero se réfère et utilise constamment par le biais de la langue rituelle, aux lieux naturels, animaux, arbres, plantes et esprits pour "actionner" le travail magique. Toute chose visible ou invisible, qu'elle soit positive ou négative, est pour le Palo imbue de puissance et d'intelligence, et peut être invoquée.
Il y a plusieurs étapes dans l'initiation, appelée rayamiento qui est un marquage corporel rituel et une "mise en éveil" ou s'effectue un pacte entre l'adepte, son propre guide spirituel, son maître appelé padrino (parrain) et l'esprit du Nganga (appelé aussi caldero, gando, fundamento, kindembo, prenda...). Chaque Nganga est reconnu comme un objet sacré et vivant, représentant les puissantes forces de la nature, et est honoré par des chants, sacrifices, danses et tambours permettant aux esprits de se manifester par l'entrée en transe des prêtres.
Le palo est ouvert aux hommes et femmes hétérosexuels seulement (à l'inverse de la santeria qui initie les homosexuels), bien que les femmes soient restreintes dans leur usage du nganga. La religion bantoue est présente à Cuba, Haïti et au Brésil.
Palo Monte - Festival del Caribe
Conclusion
Avec la traite et l’esclavage dans les Amériques, la religion des Bakongo s’est implantée à Cuba. Quelle a donc été sa dynamique de conservation et de transformation ?
Tous les rituels en rapport avec la fonction royale ont disparu. La religion kongo est devenue, comme toutes les religions africaines du Nouveau Monde, une religion des esclaves et des opprimés. Confrontés à la domination politique, économique et religieuse des Espagnols, les Bakongo et leurs descendants ont dû dissimuler leurs croyances et leurs pratiques, qui se sont privatisées. À la fois secrètes et privées, celles-ci se sont focalisées sur la résolution de problèmes individuels en rapport avec la maladie, les problèmes conjugaux et familiaux, la pauvreté ou les poursuites judiciaires. Les minkisi, qui ne représentaient qu’une partie des objets rituels en pays kongo, sont devenus le centre de l’attention des paleros. Leur principe de construction est resté le même : ils contiennent l’esprit d’un mort qui « travaille » pour le palero. Sur le plan stylistique, en revanche, alors que les minkisi kongo présentaient une grande variété d’apparence – de la statuette anthropomorphe au simple sac de toile rempli d’éléments en rapport avec l’esprit – les gangas cubaines sont toujours construites sur le même modèle : une marmite de fer ou de bois, remplie de bâtons, d’ossements animaux et humains, de terre et de pierres.
La relation entre le palero et le mort que renferme la ganga est de nature « magique », au sens de l’anthropologie classique. Le palero domine l’esprit et l’oblige à agir pour lui ou pour un tiers qui s’est adressé à lui. Insultes, coups, menaces, tous les moyens de coercition sont bons pour faire travailler le mort, qui est assimilé fréquemment à un « chien » méchant, tout comme au Kongo. Pourtant, cette relation coercitive se double d’un rapport entre homme et esprit d’une nature différente. En effet, les paleros connaissent un dieu suprême et des entités intermédiaires, issus des bisimbi du Kongo. Ces derniers ont été identifiés aux orichas yoruba et aux saints catholiques, par un phénomène de double articulation, unique, à ma connaissance, dans les Amériques. L’influence catholique est manifestement antérieure à la déportation des Bakongo à Cuba, par exemple, la distinction entre « juif » maléfique et « chrétien » bienveillant est connue au Kongo. En revanche, il existe une influence du vaudou haïtien sur le palo monte qui n’a pu se produire qu’à Cuba. L’hybridation kongo, yoruba et catholique se complique donc d’une troisième influence, celle d’une autre religion afro-américaine, elle-même déjà composite en Haïti. Une quatrième influence, dont les rapports avec les religions précédentes fera l’objet d’une autre publication, s’ajoute encore aux précédentes : il s’agit du spiritisme d’origine européenne et nord-américaine, qui s’est implanté à Cuba dans la deuxième partie du XIXe siècle. On voit ici toute la complexité du processus d’élaboration d’une religion afro-américaine, issue à la fois de la restructuration de pratiques traditionnelles et d’incorporation d’éléments exogènes de toutes provenances.
Soulignons enfin que malgré ces emprunts à d’autres religions, le palo monte conserve le souvenir de ses origines kongo dans les chants et les prières, mais aussi dans des documents écrits circulant dans la communauté des paleros. Des prières, des chants, des recettes rituelles qui font référence au Kongo – devenu un territoire mythique – y sont transcrits. La majorité de ce matériel est issu de la tradition orale. Pourtant, la référence à l’Histoire du Kongo et de l’Angola laisse penser que les paleros utilisent des sources historiographiques pour réactiver ou même reconstruire la mémoire collective.
Sources
- Lydia Cabrera, El Monte, La Havane, Editorial Letras Cubanas, 1993
- Lydia Cabrera, Palo Monte Mayombe: Las Reglas de Congo
- Lydia Cabrera, La Regla Kimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje
- Jesús Fuentes Guerra et Armin Schwegler, Lengua y ritos del Palo Monte Mayombe, 2005
- Jeff Lindsay, Dexter in the Dark, 2007
- Nicholaj De Mattos Frisvold, Palo Mayombe, The Garden of Blood & Bones, 2010
- Alain Lecomte. Raoul Lehuard. Bertil Söderberg. Bakongo. Les sifflets. Edition Alain Lecomte. Paris 2013.
Erwan DIANTEILL Centre d’Études Interdisciplinaires des Faits Religieux E.H.E.S.S.
La mémoire des Kongo au Brésil
1Cet article propose une lecture historique de la culture matérielle du Congado dans le Minas Gerais, à travers l’analyse de photographies et d’objets d'Afrique centrale (datant des XIXème et XXème siècles).
Le royaume Kongo en Afrique et le trafic négrier
Le Royaume du Kongo s’étendait sur un immense territoire couvrant le nord de l'Angola, la bande côtière de la RDC et de la République du Congo ainsi que le sud du Gabon. Il comprenait les provinces suivantes: Mpemba, Nsundi, Mbamba et Soyo, qui étaient soumises au roi Mani Kongo. Au XIVème siècle, ce royaume a annexé deux autres régions situées plus à l'est (Mpangu et Mbata), connaissant son apogée au XVème siècle (Vansina, 1973).
Rappelons que la présence portugaise dans la région, attestée dès 1482 – 1483 par l’exploration par Diogo Cão de l’embouchure du fleuve Zaïre, a créé de nouvelles dynamiques socioreligieuses et politiques, engendrant de nouvelles hiérarchies et relations entre les lignages locaux. En 1503, le fils du premier Mani Kongo dépêchait un ambassadeur à Rome afin d’obtenir le titre de prince catholique d'Afrique, se faisant désormais appeler Alfonso Ier. Au cours du règne d’Alfonso Ier, des éléments du culte catholique ont été incorporés aux objets, insignes et symboles du royaume. Le catholicisme, jusqu’alors religion des nobles, a été progressivement adopté par la population. Son expansion a été rendue possible par l’incorporation de divers éléments catholiques au quotidien des différents groupes sociaux du royaume, créant une culture «afro-catholique» sur la côte du Congo-Angola (Heywood, 2002 et 2009).
18Les Royaumes du Ndongo (l’actuelle l'Angola), Kongo, Loango (République du Congo) et les villes côtières de Luanda, Ambriz, Pinda, Cabinda et Loango étaient les principaux centres d’exportation pour les produits qui traversaient l'Atlantique. Ces relations commerciales qui ont débuté avec les Portugais se poursuivront avec d'autres puissances européennes pendant plus de trois siècles.
19Au Brésil, les ports de São Luiz, Recife, Salvador et Rio de Janeiro, villes les plus importantes de l’Amérique du Sud portugaise, reçurent des esclaves, entre autres marchandises, pendant toute la période de la traite négrière. Nombreux étaient les hommes et les femmes du Royaume du Kongo, qui furent envoyés dans diverses villes brésiliennes comme esclaves (Elits : 1999). Au cours du XVIIème siècle, Recife était le port brésilien qui donnait lieu au plus intense flux commercial avec le Congo-Angola. À la fin du XVIIIème siècle, mais aussi pendant la première moitié du XIXème siècle (y compris la période pendant laquelle le commerce négrier était interdit – 1831-1850), la plupart des esclaves arrivant au port de Rio de Janeiro et aux petits ports illégaux sur la côte de la province, provenaient des deux régions citées précédemment, mais également de Benguela – au sud de Luanda – et du Mozambique – côte orientale (Manolo, 1995).
20Ce commerce illicite était notamment stimulé par la demande des caféiculteurs du sud-est brésilien, principalement de la province de São Paulo et de Rio de Janeiro. Les commerçants du Triângulo Mineiro, situé à l’ouest de ces deux provinces, avaient également acheté des prisonniers parmi les derniers arrivages d’Afrique ou parmi les fugitifs venus des mines d’or du centre du Minas Gerais.
Le quilombo d’Ambrósio dans le Minas Gerais et les confréries noires
À la fin du XVIIIème siècle, plusieurs communautés d’esclaves en fuite se rendirent dans ces régions du Minas pour y établir des communautés appelées quilombos. Au XIXème siècle, dans ces régions de l’intérieur du pays, l’unification du territoire national a exigé une politique de peuplement qui passait par la destruction des quilombos, comme ce fut le cas en 1769 avec le Quilombo de Ambrosio (qui se trouvait sur le territoire du Triângulo Mineiro. Afin de réaliser cette unification, l’État impérial se devait de contrôler les espaces peuplés par les esclaves en fuite, qui y dictaient leur propre loi. À cette fin, il a encouragé la culture du café et du riz ainsi que l’élevage du bétail, remplaçant les premiers habitants par les esclaves des plantations et leurs maîtres.
Le peuplement tardif de cette zone géographique, après la destruction du Quilombo de Ambrosio, a également permis la création de plusieurs confréries du Rosaire à une époque où, dans les environs de métropoles telles que Rio de Janeiro et Recife, ce type de catholicisme populaire était réprimé par la papauté et l’administration impériale (Abreu, 1999 et Cord, 2005). Cependant, au cours des XVIIème et XVIIIème siècles, les confréries de noirs, formées d’esclaves et d’hommes libres, comme celles dites du Rosaire, Saint Benoît, Sainte Efigénia ou Saint Eslebão, ont servi la politique coloniale mise en place par la couronne portugaise dans les Amériques et les territoires récemment peuplés. À cette époque, certaines confréries comme Satíssimo Sacramento, Maison de la Miséricorde, comptaient des blancs dans leurs rangs qui étaient hommes d'affaires ou fermiers. Faute de fonctionnaires suffisamment nombreux pour assurer l’administration des villes et des villages, la couronne portugaise devait s’appuyer sur l’Église, en recourant à ces organisations catholiques composées de laïcs (Boschi, 1986). Notons que ces confréries organisaient la vie quotidienne des villages sans pour autant participer à égalité au pouvoir politique.
Dans le bourg de São Pedro de Uberabinha (actuel Uberlândia), le siège de la « Confrérie du Rosaire et de Saint Benoît des Hommes de Couleur » a été ouvert en 1876. À Araxá, la plus grande ville de la région du Triângulo Mineiro au XIXème, le siège de la Confrérie du Rosaire a été découvert en 1836. Composée d’esclaves et d’hommes libres, cette confrérie s’organisait autour de l’élection de son roi du Congo et célébrait un culte à Notre-Dame du Rosaire et à Saint Benoît. Ses membres élisaient leurs dirigeants chaque année, notamment le roi et la reine du Congo, le comptable, les secrétaires et les juges. Dans un certain nombre de confréries, les donations en argent, qui garantissaient à leurs auteurs une place importante au sein de la confrérie, permettaient de financer les commémorations en l’honneur du saint patron de la confrérie. L’argent de la trésorerie permettait de subvenir aux frais d’entretien et finançait les émoluments du curé ou de l’abbé. Il était possible de débloquer des fonds en urgence pour l’achat par exemple d’un esclave en vue de son affranchissement (Silva, 2003).
Les passerelles culturelles
Il est possible de se renseigner sur les usages et les significations que les esclaves du Rosaire ont faits du roi et de la reine du Congo, à qui ils ont rendu hommage. En ce sens, la compréhension du rôle de Mani Kongo dans l'histoire de l'Afrique centrale et, par conséquent, de la formation du monde atlantique permet de penser à la construction du mythe devenu roi du Congo pour l'histoire de la diaspora.
Les relations commerciales avec les puissances européennes, qui ont duré plus de trois siècles, ont entraîné la dissolution de la centralité politique du Mani Kongo, lequel assista dès le début du XVIIIème siècle à la fragmentation de ses possessions et à l’érosion de son pouvoir. Malgré tout, l’apogée de son règne fut mémorable, le Royaume du Kongo acquérant une renommée internationale dont témoignent diverses histoires comme celle des relations diplomatiques avec les Européens (Portugais, Hollandais), notamment le Vatican. Selon John Thornton (1997) et Joseph Miller (1976), une grande partie des esclaves d’Amérique sont venus de la région du Royaume du Kongo, mentionné par la documentation du trafic de l'Atlantique comme Congo-Angola. Nombre d’entre eux furent vendus aux Européens pour des plantations dans les Amériques, à cause de l’instabilité sociale subie par le Congo – Angola à cause de la guerre civile entre les provinces du Royaume, des conflits militaires entre nobles et des interventions directes des Européens (notamment celle des Portugais en Angola). Ces Africains, aussi bien captifs que commerçants, connaissaient les histoires relatant les négociations diplomatiques entre le Mani Kongo et les Européens, en particulier le Vatican.
Après plus de trois siècles d’histoire de Mani Kongos, le Mani Kongo s’est transformé en légende à son arrivée en Amérique10. Spécialiste de l’histoire orale de l’Afrique centrale, Jan Vansina nous explique qu’un mythe est une histoire qui fait son propre chemin, « en se transmettant de bouche à oreille » (2003).
Ainsi, même les prisonniers originaires de l'île du Mozambique, en Afrique de l'Est, et de Benguela, au sud de Luanda, s’identifiaient, une fois arrivés au Brésil, aux vieux Africains originaires du Kongo. Ils dansaient et chantaient en souvenir de leur roi et adoptaient les coutumes et les pratiques des confréries en rendant hommage au souverain du Kongo (Souza, 2000). Tous ces peuples honoraient leur roi et vouaient un culte à Notre-Dame du Rosaire. Ils ont ainsi inventé un mythe fondateur qui explique l’existence des différents groupes composant le Congado
L’esclave a trouvé Notre-Dame du Rosaire dans la mer, il a demandé l’autorisation de la récupérer à son maître (senhor). Avant de laisser faire l’esclave, le senhor a lui même essayé de la retirer, mais il n’y est pas parvenu. À son tour, l’esclave du Congo a tenté sa chance, Notre-Dame du Rosaire lui a souri. Seul l’esclave du Mozambique avec l’aide des Marinheiros est parvenu à la retirer. Ils ont alors construit une petite église pour l’abriter. Et elle y restera à condition que son culte soit accompagné par la musique des tambours.
Le patrimoine culturel des congadeiros se nourrit du savoir-faire et des pratiques culturelles provenant d’Afrique, que ce soit des régions proches du Royaume du Kongo ou des localités éloignées. Transmises de génération en génération, ces représentations renvoient à un certain type d’organisation sociale, tout en faisant référence à l’époque glorieuse du Royaume du Kongo. Un certain nombre d’éléments symboliques similaires et d’autres très différents entre eux ont circulé parmi les diverses ethnies africaines au Brésil et ont contribué à créer, de ce côté de l’Atlantique, un nouveau mode de vie.
La culture matérielle
Dans le centre-ouest de l’Afrique, on observe des similitudes entre certaines structures sociales. Par exemple, chez les Bateke (situés au nord-ouest du territoire des Bakongo), le mfumu était « le grand homme », selon la traduction de Jan Vansina (1990 : 81-82). Le territoire du mfumu pouvait correspondre à un village, un clan, voire donner naissance à une dynastie royale. Sa fortune s’évaluait au nombre de personnes présentes dans son entourage ou dépendant directement de lui pour vivre : les clients, les femmes, les enfants, les fonctionnaires, les conseillers, les soldats. Toutefois, certaines institutions primaient pour ainsi dire sur ce pouvoir individuel pourtant étendu. Elles permettaient l’existence d’un pouvoir décentralisé et partagé entre d’une part le mfumu et d’autre part, les dirigeants des groupes d'âge, qui étaient normalement identifiés lors de la circoncision, ou choisis parmi les kitomes (conseillers spirituels du Royaume), les guérisseurs traditionnels (ou sorciers), ou les chefs de métiers comme les forgerons. Ces groupes formaient un réseau de pouvoir dont l’autorité était respectée et ils étaient consultés pour des problèmes d’ordre personnel ou collectif.
Les membres de ces institutions arboraient des signes distinctifs marquant leur fonction, tels que les vêtements, les ornements et les objets utilisés lors des célébrations traditionnelles (MacGaffey, 1991). Selon Arjun Appadurai, ces objets ont une vie sociale (2008), ce qui signifie qu’ils en disaient long sur les personnes qui les portaient. Ils marquaient une situation sociale où les individus assumaient publiquement leur fonction. Dans ce cas, l’objet est le sujet créateur de la situation sociale. On peut dire que la fonction sociale est conférée par l’objet porté par la personne.
Ces marques de distinction et de pouvoir, qui ont façonné la culture de la région, se sont déplacées en même temps que les Africains déportés au Brésil. Ces éléments sont utilisés par leurs descendants dans le Congado, leur permettant de s'affirmer comme groupe de congadeiros et de se distinguer des autres. Les individus utilisent des objets et autres éléments distinctifs : ils jouent de certains instruments de musique – gunga et patangome – ou portent des jupes spéciales et des coiffes de plumes au cours de défilés accompagnés de percussions et de danses spécifiques.
Les cinq groupes participant au Congado sont Moçambique, Congo, Catupé, Marinheiro et Vilão. Pendant la célébration des rites, les danseurs se répartissent entre ces cinq groupes et organisent une procession rituelle. Le groupe dit du Moçambique porte les saints, le roi et la reine Congo ; il est suivi par celui du Catupé puis celui du Congo, les groupes du Marinheiro et du Vilão fermant la marche. La hiérarchie entre les groupes repose sur le mythe fondateur du Congado, qui remonte au XIXème siècle.
Dans le Minas Gerais, chaque groupe du Congado peut être reconnu et identifié par les marques d’appartenance qui le distinguent des autres groupes. Lorsqu’on connaît leurs codes et leurs comportements culturels, on peut facilement identifier le rôle d’un groupe ou d’un individu en observant les décors et les symboles qu’il utilise. Bien qu’ils ne revendiquent aucun territoire physique, les groupes du Moçambique, Congo, Catupé, Marinheiro et Vilão constituent des nations (Soares, 2004), étant donné que leurs membres sont unis par une identité commune et une même mémoire matérielle et immatérielle qui construit des passages symboliques entre les océans. Ces groupes forment un royaume du Congo transplanté au Brésil, territoire abstrait et imaginaire réorganisé à partir de références socioculturelles africaines.
Les groupes de Congos du Congado représentent des ethnies arrivées sans interruption au Brésil depuis le XVIème siècle. Il s’agit de captifs ayant embarqué dans les ports de l’ancien royaume du Kongo et Ndongo communément appelé Congo-Angola. Ceux-ci sont venus du littoral et ont depuis longtemps appris à vivre en Amérique dans la société créée par les blancs et marquée par des règles rigides et la présence de l'Église. Comme le mythe fondateur le raconte : « À son tour, l’esclave du Congo essaya de sortir Notre Dame du Rosaire de l’eau et celle-ci lui sourit. Seul l’esclave du Mozambique parvint à la retirer de la mer ». Ce sont eux les premiers arrivés. Ils représentent le peuple du Congo, les sujets légitimes du Mani Kongo.
Les groupes de Congos du Congado forment le peuple-soldat, qui protège la cour du Roi Congo représentée par les groupes de Moçambiques. Ils incarnent donc le peuple du Royaume du Congo au Brésil. Ils sont importants en ce qu’ils affirment la hiérarchie sociale héritée du Congo-Angola. Les distinctions entre chaque groupe du Congado, le mythe fondateur du rituel et la cérémonie du Congado devant l’église manifestent une interprétation de la structure sociale du royaume du Kongo, ou plutôt, un arrangement de plusieurs symboles de la structure sociale de certains groupes ethniques en Afrique centrale: le roi et reine du Congo, leur cour (le Moçambique), le peuple-soldat (le Congo).
La familiarité des congadeiros avec tels objets ou danses s’explique par leur proximité avec les références ancestrales et le patrimoine des Africains arrivés au Brésil il y a des siècles. Dans le Triângulo Mineiro, ces références ont été systématisées et fixées au XIXème siècle sous la forme du rituel Congado.
Les souvenirs des congadeiros nous conduisent au Royaume du Kongo et aux organisations africaines sociales solidement structurées du XVIème et XVIIème siècle. La symbolique de l’objet représentant au Congo-Angola la permanence du pouvoir a été adaptée aux conditions locales ; et de l'autre côté de l'Atlantique, ceux qui avaient besoin de ces références ont reconstruit leur vie et enregistré leur histoire.
L'analyse de ces deux cultures matérielles à travers l'histoire orale, l’anthropologie visuelle et les sources des photographies ethnographique permet d’établir des parallèles entre la diaspora africaine au Brésil et l'histoire de la région du Congo-Angola, qui, à ce jour, est peu documentée par l'histoire écrite. Cette étude comparative basée sur l'histoire de l'Afrique Centrale mais aussi sur l’histoire de l’Esclavage à Minas Gerais, entre les niches régionales de deux lieux éloignés, voire très éloignés l’un de l’autre, jette sur la formation du monde atlantique une lumière nouvelle, en dialogue avec les grands processus de l’histoire. Toutefois, de nombreuses lacunes restent à combler, et c’est ce qui rend cette histoire si stimulante.
Auteur
UNILAB / Ceará
larissa.gabarra@unilab.edu.br
Référence
Centre d’Études Interdisciplinaires des Faits Religieux E.H.E.S.S.
Pyramide Papyrus Presse
Bibliographie
Balandier, G. (1965). La vie quotidienne au royaume du Kongo du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, Hachette,
Benoist, J. (1972). L’Archipel inachevé, culture et société aux Antilles françaises, Montréal, Presses de l’Université de Montréal.
Blanche, J-C. (1980). « L’immigration kongo en Guadeloupe », L’historial antillais, tome IV, Fort-de-France, Dajani.
Blanche, J-C. (1994). 6 000 « engagés volontaires » en Afrique et en Guadeloupe, 1858-1861, thèse de doctorat, Université Paris 1, 3 vol. dact.
Dianteill, E. (2002). « Les Amériques Kôngo, Brésil, Cuba, Haïti », in Le Geste Kôngo : 185-193, Paris, Musée Dapper.
Date de dernière mise à jour : Wednesday, 20 March 2019
Ajouter un commentaire