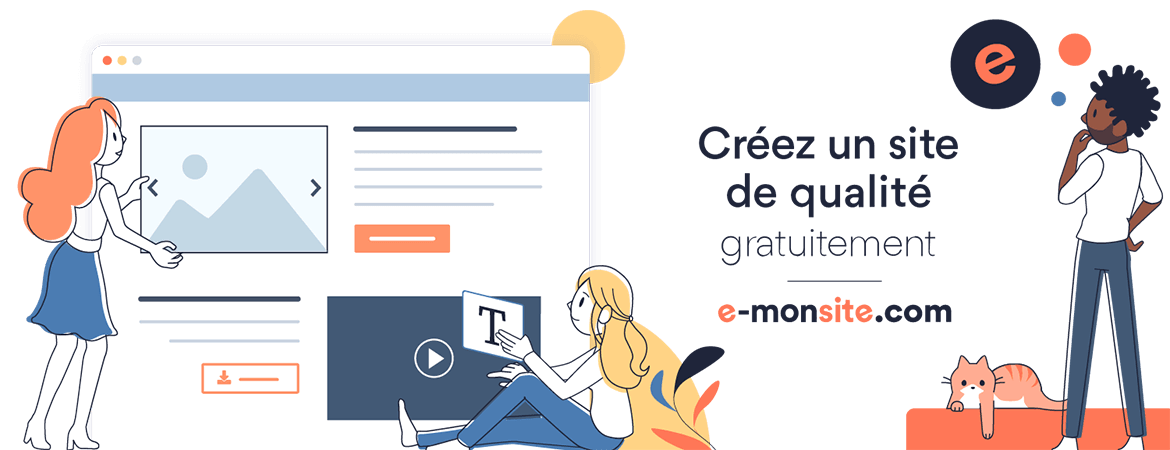- Accueil
- Pages
- LES ETHNIES ET TRIBUS DE LA RD CONGO
- Peuple Solongo, (Basolongo) du Kongo central
Peuple Solongo, (Basolongo) du Kongo central
 Les Solongo sont un peuple établi à l'ouest de la République démocratique du Congo dans le Kongo central et au nord-ouest de l'Angola. Ils forment l'un des principaux sous-groupes des Kongos. On les appelle donc communément les Bakongo en ce qu’ils sont issus d’un même ancêtre éponymique appelé Ne kongo et en ce qu’ils parlent tous une langue commune appelée le kikongo même si par ailleurs chaque sous-groupe (tribu) a sa langue spécifique qui se distingue des autres par certaines caractéristiques morphologiques, syntaxiques, lexicales ou encore suprasegmentales. Ainsi les Basolongo parlent le kisolongo.
Les Solongo sont un peuple établi à l'ouest de la République démocratique du Congo dans le Kongo central et au nord-ouest de l'Angola. Ils forment l'un des principaux sous-groupes des Kongos. On les appelle donc communément les Bakongo en ce qu’ils sont issus d’un même ancêtre éponymique appelé Ne kongo et en ce qu’ils parlent tous une langue commune appelée le kikongo même si par ailleurs chaque sous-groupe (tribu) a sa langue spécifique qui se distingue des autres par certaines caractéristiques morphologiques, syntaxiques, lexicales ou encore suprasegmentales. Ainsi les Basolongo parlent le kisolongo.
Les Basolongo

Chapitre 1 : La société des Basolongo
1.1 Localisation géographique des Basolongo
En effet, les Basolongo se retrouvent aussi bien en Angola qu’en R.D. du Congo.
En Angola, on les localise à Soyo et dans ses environs c’est-à-dire dans le sud est entre le port de Mpinda où débarquèrent Diego Caõ et ses compagnons en 1482 et le port d’Embrizete, le long du fleuve Congo, qui débouche sur la côte atlantique. En République démocratique du Congo, c’est à l’ouest du Congo précisément dans le bas du fleuve Congo que l’on trouve plusieurs localités des Basolongo, notamment Matombe (commune de Moanda), Kibamba, Vungu, Senge, Bote, Malele, Kimuabi, Longua, Kinlau, etc.
1.2 Les Basolongo premier groupe social congolais à avoir été en contact avec les Européens.
Les Basolongo occupent une place spéciale dans l’histoire des Congolais en général et Bakongo en particulier pour avoir été les premiers à avoir rencontré les Européens. Disons, pour rappel, que le 15ème siècle fut déterminant pour les Portugais dans leur entreprise d’exploration de nouveaux continents. Sous le règne du roi Joaõ II, entre 1481 et 1495, plusieurs bateaux cherchèrent à atteindre les Indes. En 1482, Diego Caõ reçut l’ordre du roi de descendre plus au sud après sa tentative limitée au long des côtes africaines qui restaient à connaître. C’est finalement en 1482 qu’il découvrit l’embouchure du fleuve Congo et accosta au port de Mpinda à Soyo, où il rencontra les Basolongo (L. Groegart 1985 : 146 -147.) D’après la légende, les Basolongo prirent ce nom comme celui de leur groupe pour avoir, les premiers, rencontré des Blancs qu’ils surnommèrent Zimvumbi ‘revenants’12. L’appellation Basolongo vient du verbe sólóla "découvrir ou être découvert". Le sous-groupe solongo est donc une société découverte par l’étranger (l’homme blanc.)
Devant la grande surprise et la difficulté évidente de communication de part et d’autre, Diego Caõ se décida à laisser quatre hommes de son équipage. Il en prit quatre autres chez les Basolongo en échange, pour les présenter au roi Joâo II en guise de symbole d’amitié, mais aussi avec l’intention de les initier à la langue portugaise afin qu’ils servent d’interprètes à son retour (G. Balandier 1963 ; W. Randles, 1968)
1.3 Les Basolongo dans le royaume kongo
À l’instar d’autres sous-groupes des Bakongo, les Basolongo, appartiennent au royaume du Kongo. Ils sont fils de Bena Kongo, descendants de Nsaku, Mpanzu et Nzinga Lukeni (G. Balandier, 1963 ; W. Randles, 1968). Dans ce royaume, ils occupent une grande province que dirige l’oncle du roi, le nommé Mani-Soyo.
Celui-ci reprit contact avec Diego Caõ et ses quatre hommes échangés, lesquels faciliteront dorénavant la communication après quinze mois passés au Portugal.
Cette fois là, l’ambiance dans les contacts n’est plus glaciale, mais plutôt cordiale. Ces négociations aboutirent à la visite chez le roi lui-même à Mbanza Kongo. Quelques années plus tard, après des échanges réguliers de cadeaux et d’intentions dans les règles diplomatiques, le roi Nzinga Nkuvu demande la venue des missionnaires catholiques franciscains et johannites. C’est en 1491 que les premiers missionnaires débarquèrent à Mbanza Kongo, munis de riches cadeaux visiblement utiles pour démarrer l’évangélisation.
Les Basolongo sont ainsi considérés comme les premiers Noirs du Congo à avoir rencontré l’homme blanc. Ils sont aussi les premiers Congolais à avoir foulé le sol européen. La conséquence de cette rencontre a eu comme retombée aujourd’hui l’injection de nombreux vocables portugais dans le kisolongo. Il s’est donc produit une espèce de pidginisation de la langue parlée à Soyo, en Angola tandis que les autochtones se sont mis à ‘singer’ les manies occidentales.
Historiquement et même actuellement, les Basolongo ont été et sont encore favorisés par la position géographique de leur province Soyo qui a un port de grande importance, Mpinda, situé à quelques kilomètres de l’océan atlantique.
C’est là qu’eurent lieu la plupart des échanges commerciaux et humains entre Européens et Africains du coin. Le kisolongo, qui avoisine le kisansala ou le kisalvador, est vraisemblablement la langue qui était parlée à la cour royale, à Mbanza-Kongo, rebaptisé plus tard San Salvador ou (H. Bentley, 1887 ; K. Laman, 1912).
Culture des Basolongo

1.4 Organisation sociale et mode de vie
L’organisation sociale des Basolongo se fonde sur la famille nucléaire, vúmu dirigé par táata ou sé ‘le père’. Une ou plusieurs familles peuvent former un village ou vata que G. Buakasa (1973) appelle communauté résidentielle.
Chaque village est placé sous la responsabilité d’un chef qu’on appelle duki ou mfumwa vata, chef du village. Un ensemble de familles (du côté paternel et du côté maternel) forme le luvila "lignage ou clan". Les membres d’une même famille ou d’un lignage sont liés par une parenté de type matrilinéaire (pour la plupart des Bakongo) ou patrilinéaire, comme c’est le cas chez les Basolongo.
Un groupe de familles ou de lignages constituent un clan, le dikanda (K. Laman, 1936) C’est à l’aîné des pères de familles constitutives que revient généralement le rôle de chef de clan ou mfumwa kanda.
Au niveau du clan prime la notion de la territorialité. En effet, le clan compte en son sein tous les ascendants et descendants (vivants ou décédés) d’une souche commune c’est-à-dire sur la base de la communauté de sang véhiculée par les femmes de condition libre et sur la base de la possession et de l’établissement sur un territoire donné (notion de territorialité). Le chef de clan, mfumwa a kanda décide sur toutes les affaires de la famille telles que le mariage, l’initiation et la protection des interdits et sur d’autres valeurs rituelles comme le káandu, la nsámbu ou le kikumbi.
Mais en définitive, tous les sous-groupes des Bakongo respectent la répartition du pouvoir établi en faveur de l’aîné, du père, du mfumwa kanda ‘chef de famille ou du clan’, des maduki, des vieux’, du mfumwa vata ‘chef du village’ au détriment respectivement du cadet, de la mère, des autres membres, du reste des concitoyens, et des bantuenya ou yanana ‘Les jeunes’. Les principales activités des Basolongo sont les travaux de la forêt, la pêche, la chasse, l’artisanat, la culture (manioc, haricot, banane, papayer, café, cacao, etc.), l’élevage des caprinés et des gallinacés et rarement celle du gros bétail.
Plusieurs autres activités rythment la vie des Basolongo :
• Le kinzónzi mu fu kia nsi, la palabre (activité par excellence des initiés duki ou chef) ;
• Les anti-sorciers : nganga a nkisi ‘le féticheur’, nganga ngombo "le devin (spécialiste des sorciers)";
• Les loisirs : mutopi (football), le ngóola (jeu qui se joue avec des petits cailloux sur un support en bois rectangulaire à plusieurs petits trous), la musique traditionnelle dont les instruments sont : ngoma "tambour", ntáabala "petit tambour", nsáambia "harmonica", dikémbe "instrument à son", ngóongi "instrument métallique à son" et makinu "la danse" (W. MacGaffey, 1995).
Les Basolongo reconnaissent deux types de pouvoirs (spirituel et politico-social).
1.5 Pouvoir politico-social
Le pouvoir politico-social traditionnel des Basolongo s’apprécie aux fonctions qu’exercent les chefs à différents niveaux de la vie sociale, notamment le duki ou mfumwa vata, chef du village, qui coordonne un conseil composé de kapita (son assistant potentiel), des maduki, vieux sages et membres du conseil de la cour traditionnelle. Le conseil du village en tant que tribunal populaire (cf. 9.2.) joue le rôle de gardien et de maintien de la paix et tranche selon le fu kia nsi "la coutume" les éventuels différends entre les membres du vata ou communauté résidentielle.
L’Etat congolais, conscient de ces acquis traditionnels dans la relation entre tradition et modernité a placé à la tête de chaque chef du village un duki, un chef de groupement qui coordonne cinq à dix villages appartenant à un territoire administratif moderne. Ce qui permet à l’Etat d’avoir un droit de regard direct sur les réalités sociales des entités traditionnelles de base. Il gère ainsi les valeurs des ancêtres sans les étouffer (G. Hulstaert, 1950 : 143.)
Les Basolongo accordent une place importante à la hiérarchie sociale. Ainsi, même au niveau de la famille nucléaire, vúmu, le táata, le père, et le fils aîné, mwana nkuluntu, yaya, mfumw’éto (grand-frère ou grande-sœur) gèrent la mama, la mère et les baleke, les cadets. Au niveau de la famille élargie, le mfumwa kanda, chef du clan, gère les autres membres de la famille.
1.6 Pouvoir spirituel
Toutefois, la règle générale pour tout échelon de la société clanique est l’initiation à la réalité fondamentale de la vie, c’est-à-dire à la sorcellerie, kindoki. Ce qui induit l’efficacité du verbe et la crainte de ces différents chefs par les autres membres de la société.
Le pouvoir spirituel exercé par le chef coutumier et comprend entre autres l’initiation et l’éducation de la jeunesse. Dans chaque luvila, le chef de clan, mfumwa kanda, est le gardien de la tradition et de la transmission des connaissances accumulée par les bakulu ‘ancêtres’. Parmi les personnages de notoriété pseudo-spirituelle, nous citons Le nganga nkisi ‘féticheur’ et le nganga ngombo ‘guérisseur anti-sorcier’ ont un pouvoir spirituel en tant que la communauté admet qu’ils combattent le mal par la connaissance de minkisi "fétiches ou remèdes" (G. Buakasa, 1973 ; W. MacGaffey, 1974 ; T. Barbara, 1999) Les minkisi contribuent au bien-être des membres de la société des Basolongo.
Comme le confirment ces différents auteurs, les minkisi, les nganga ainsi que tout autre individu (mfumwa ntótó "chef coutumier" (ou chef de groupement), nsadisi a makaya ma nsi ‘guérisseur’) doté d’une parcelle de pouvoir spirituel peut faire et font du bien aux membres de la communauté. Mais cela n’empêche pas que certains utilisent leurs pouvoirs à d’autres fins, à des fins personnelles singulièrement ou encore pour nuire à l’un ou l’autre membre de la société..
Par ailleurs, nous sommes conscients des risques de dérapage et de surdosage dans le domaine du traitement des maladies à l’aide des plantes médicinales.
Certaines plantes peuvent être vénéneuses, autrement dit, elles peuvent être des véritables poisons. La rareté des accidents dans ce domaine constitue la preuve manifeste de la maîtrise des connaissances ancestrales par les « tradipraticiens » Basolongo.
1.7. Education
L’éducation traditionnelle chez les Basolongo se fait dans le cadre des institutions initiatiques : pour les jeunes filles dans le kikumbi "rituel qui les prépare au mariage et à la vie de femme" et pour les garçons par le nzéngolo a sútú "la circoncision". Le rite de l'initiation rituelle est suppléé quotidiennement par l’accompagnement des membres de la famille (táata ou se "le père", yaya ou mfumw’éto "grand-frère ou grande-sœur" et máama "mère" (surtout pour les filles).
En effet, la famille guide les jeunes en tout lieu et dans les activités quotidiennes où ils se frottent aux réalités concrètes de la société dans la forêt, à la rivière et au champ. On apprend aux jeunes l’usage et le respect de la nature.
Cette éducation comporte trois volets :
• L’éducation à domicile : elle est donnée spontanément par le père, la mère, le grand-frère ou la grande-sœur et même par l’oncle ;
• L’éducation de rue qu’au soir et autour du feu les bambuta, les vieux dispensent aux jeunes garçons. C’est là que les jeunes apprennent le fu kia nsi "la coutume", les règles de politesse et le respect dû aux parents et aux aînés. Ils s’initient aussi à l’expression orale, à l’éloquence, à l’usage des proverbes, aux rapports matrimoniaux, à l’histoire de luvila et aux règles de la cour populaire pendant les binzónzi "palabres";
• L’éducation rituelle sert à préparer la jeune fille ou le jeune garçon au mariage ou au statut spécial de mfumwa vata "chef du village", nganga "féticheur", nsádisi "guérisseur", mfumwa kanda "chef de clan", etc. Elle est aussi à encadrer les jeunes au rituel de la palabre préparatoire au mariage.
Dans les lieux de travail (dans la forêt, à la rivière ou aux champs), les bambuta "vieux sages" profitent du temps de pause pour raconter aux jeunes l’histoire de luvila et leur apprendre les techniques sur les aspects juridiques de la vie au travers de la tradition (us et coutumes, interdits et leurs conséquences). C’est dans de telles occasions que sont également données des notions élémentaires sur l’usage de certaines plantes médicinales.
De nos jours, il y a un quatrième type d’éducation consécutive à la présence des Européens en Afrique. On l’appelle ngángu za mindele "l’intelligence des Blancs", autrement dit la scolarisation obligatoire. Elle est accessible dans presque chaque village où existent une ou deux confessions religieuses reconnues, qui côtoient généralement un dispensaire d’Etat. Là où des jeunes n’ont pas pu poursuivre une scolarité régulière, ils sont orientés vers l’apprentissage d’un métier moderne.
1.8. Activité économique et vie matérielle

Les principales activités économiques auxquelles se livrent les Basolongo sont : le zimpantu "agriculture", le túela "élevage", le lóya "pêche", le lóza "chasse", le wunkéte "artisanat", et le tóta "cueillette". Selon Lubana (1990) et W. Bal (1963), les principales cultures pratiquées sont le manioc, le maïs, la banane plantain, le haricot, l’arachide, le riz et la patate douce. Le manioc est l’aliment principal de tout Mukongo. Grâce au manioc, on fabrique la chikwange, le foufou et le bikedi (manioc trempé et séché) et le gari, le manioc moulu, puis séché, qui se mange mélangé à l’eau et au sucre.
Le mode de vie des Basolongo est profondément marquée par la forêt qui recèle les ressources exploitées par les villageois : matériau de construction des logis, plantes médicinales, palmiers, raphia (desquels on extrait le mafúta "huile de palme" et le nsámba "vin de palme" le lungwila "alcool fermenté’"),de cannes à sucre d’où provient le jus du même nom. Le lubota ou nlúungu "pirogues" ou le vémba "radeau" sont construits pour servir de moyens de transport fluvial et maritime tandis que les mintámbu "pièges" permettent de capturer des bêtes de toutes tailles.
Chapitre 2 : Le kisolongo et ses locuteurs
Notions de grammaire du kisolongo
Pour faire de cette langue une présentation rapide, nous allons analyser non seulement quelques éléments de sa grammaire, mais aussi ceux de sa prosodie et de l’orthographe.

Phonétique et phonologie du kisolongo
Le tableau vocalique du kisolongo comprend cinq voyelles : a, o, i, e, u.
Les voyelles e et o ne se prononcent certes toujours pas de la même manière, mais ces différences de prononciation n'ont rien à voir avec la signification des mots. Nous illustrons plus loin cette affirmation.
1. La consonne dentale alvéolaire s se prononce comme en français s et rarement z ; y compris entre deux voyelles. Ex : asundi = lauréat.
La voyelle u, aperture minima non arrondie, se prononce toujours comme en allemand /ou/ (Ursula.) Mais devant les voyelles a, i, e, u, elle devient w.
Exemple : u + a = wa ; u + e = we ; u + i = wi ; u + o wo ; u + u = wu.
2. La voyelle i, aperture minima non arrondie, devient y devant les voyelles u, i, e, o. Exemple : i + o = yo ; i + a = ya; i + e = ye ; i + u = yu.
3. V et /v/, le kikongo distingue entre le V labio-dental qui ressemble au V français et un autre /v /, qui n'existe pas en français. Celui-ci se prononce des deux lèvres et non en joignant la lèvre inférieure et les dents de la mâchoire supérieure. Il importe de bien distinguer entre le labio-dental v et la fricative sonore / v/, car ce /v/ provoque des changements euphoniques que le v français.
Ex: Vátá, cultiver et vata, village.
3. Mu / mou/ est le préfixe qui exprime le singulier. Son pluriel est Ba / ba/ ou Mi / mi/.
d) Les consonnes
Les consonnes communes qu’on rencontre en kikongo sont :
Labiales : m, p, b, f, v ; alvéolaires : n, t, d, s, z, l ; vélaires : k et g.
Notons que le g apparaît généralement dans le contexte complexe ng exemple : ngáanga, féticheur ; ngáandu, crocodile ; ngóongól,o mille-pattes.
Autres exemples de consonnes :
Máama, mère ; núni, oiseau ; púlúpúlú, diarrhée ; táata, père ; dílá, pleurer ; kóoko, bras ; bábá, muet, fofóolo, boîte d’allumettes ; vimba, gonfler ; luzólo, volonté ; mvúla, la pluie ; sóka, hâche..
e) Complexes consonantiques
En kikongo on rencontre trois types de consonnes ou groupes consonantiques :
1) une consonne précédée d’une nasale ng. Les complexes de ce type couramment attestés sont : ngáandu (crocodile), ngálu (petit plateau en paille), ngúlu (porc), ngólo (force), etc.
2) une consonne suivie d’une semi-voyelle :
ces types sont couramment attestés par : my, mw, py, pw, by, vy, vw, tw, dy, lw, ky, kw. Exemple : myéezi étoiles, lyéenzi, lumière (en kisolongo), nwána, se battre, mwana enfant, kwíika allumer dyamba chanvre, syama être en bonne santé (kisingombe en kimanianga, etc.
Une consonne entourée d’une nasale et d’une semi-voyelle
3) Les complexes attestés sont les suivant : mmy, mpy, mpw, mby, mbw, mfy, mv, mvw, nzy, nzw, nky, nkw, ndy, ndw, nsy, nsw :
Exemple : mpyoodi, hareng ; ntwéedi, éleveur ; ndyatilu, démarche ; mfwidi, je meurs ; nswéeswe, frais ; lungwénia, caméléon ; etc.
4) Quelques verbes à l’infinitif kisolongo
Sámba (15) : prier, comparaître, supplier
Lóomba (15) : demander
Súmba (15): acheter
Lamba (15) : préparer
Zawula (15) : courir
Sonéka (15) : écrire
Tala (15) : regarder
Vuanda (15) : s'asseoir
Fukama (15) : s'agenouiller
Yimbila (15) : chanter
Bokota (15) : chuchoter
Tanga (15) : lire
Visa (15) : comprendre
Kina (15) : danser
Dasuka (15) : se fâcher
Sukula (15) : laver
Dumuka (15) : sauter
Kamba (15) : avertir
Biéka (15) : introniser
Fúnda (15) : accuser
Kwéla (15) : marier, se marier
Kandika (15) : interdire
Túma (15) : commander, envoyer
Kóta (15) : entrer
Vayika (15 ) : sortir
5. Quelques phrases au présent
• mwana yakala ofukamene va ntoto : le jeune est à genou par terre
• E nkombo yi fwidi : la chèvre est morte
• Tata Lembe osumbidi e buku dia mpá : Papa Lembe vient d'acheter un nouveau livre
• O mwana o kotele mu kalasi : l’enfant entre en classe ou l’enfant vient d’entrer en classe
• E dibundu dia missioni dikangamene : l’Eglise protestante vient d’être fermée
• E malavu makandikilu kwa tata Mpélo : le vin est interdit par le prêtre.
• Yele ku zandu : je pars au marché
• Tuénda sumba onkélé : allons acheter le fusil
• Bele ku vata dia nkéento : ils vont au village de la femme.
• Paulo ovuende va sala : Paul est assis au salon
• Mama Mandelani osumbidi e dikalu diampá : maman Madeleine a acheté une nouvelle voiture.
• O nlúngwa a matoko usindidi : la pirogue des jeunes garçons vient de couler
• E yana makéento betolanga é nkúnga mia kiadi : les jeunes filles chantent des lugubres chansons.
Chapitre 3 : Quelques Rituels en rapport avec le káandu au pays des Basolongo
3. 1. Kikumbi "initiation au mariage"

Chez les Bavili, les Basolongo et les Bawoyo, le kikumbi consiste en l’initiation ou en la préparation d’une jeune fille au mariage. C’est un rituel lié à la vie sociale et qui se prépare pendant au moins un ou deux ans. La pratique du kikumbi se retrouve également dans d’autres groupes sociaux de l’Est du pays, notamment chez les Barega, les Bahunde, les Babembe, ainsi que chez les Ba Lulua et les Baluba du Kasaï. Ces derniers sont d’ailleurs réputés pour la danse d’amour que, lors de l’initiation, les filles apprennent dans le bois sacré pour acquérir l’ukutchebana "talent indispensable pour une bonne épouse" (Lire Anicet Kashamura (1973 : 82-83). Dès que leur fille atteint ses quinze ans, les parents s’organisent pour rassembler vivres et boissons pour faire plaisir aux différents invités à cette grande fête dansante traditionnelle qui peut durer entre quinze et trente jours d’affilée. Dans certains cas, des jeunes filles pubères d’une même famille peuvent être internées ensemble pour le kikumbi, ce pour minimiser les dépenses des parents.
Voyons ci-dessous le déroulement de l’initiation :
• Internement : Selon tata Polo dans son interview (2001 en annexe), la fille en âge nubile est – durant son internement – entourée de ses tantes et des sages femmes qui l’initient à l’art sexuel, aux soins intimes, aux rapports sociaux avec les futurs beaux parents et avec le futur mari. Elle ne touchera à rien à l’exception de ses soins intimes.
Les hommes sont interdits d’entrer dans sa chambre. Elle se déplace en escorte avec deux à trois duègnes, la tête couverte d’un pagne jusqu’au pied afin d’éviter le regard des hommes. Elle ne sort que pour les stricts besoins physiologiques. Après la douche obligatoire vers cinq ou six heures du matin, elle se maquille avec le ng?ola (terre rougeâtre) et avec d’autres onguents. Vers midi, elle prend son repas.
Chaque soir sont organisés - devant la case où elle est internée - un spectacle chorégraphique au tam tam, des jeux de devinette et des bigógólo "causeries" improvisés par les maduki "les anciens ou vieux". Il arrive aussi qu’un griot improvise un concert. Cependant suite au contact avec le kadilu kia mindele "modernisme", ce rituel tend à être abandonné et n’a plus sa rigueur d’antan. sous prétexte qu’il n’a pas de raison d’être pour les chrétiens et les personnes « civilisées ».
• Sanction : Avant l’internement de la future initiée, les sages femmes pratiquent sur la future initiée un test vaginal. Une jeune fille déflorée avant le rituel est sanctionnée ainsi que d’ailleurs l’homme qui l’a conduite à cet état.. On rase à chacun sa tête, on y verse de l’huile de palme et on leur retire leurs habits et livrés une journée entière aux moqueries du public au rythme du tam-tam. De cette manière, la société entière apprendra la leçon. Au lendemain, la jeune fille est autorisée à intégrer le kikumbi tandis que le garçon coupable est prié de payer l’amende prévue par la jurisprudence et est obligé de prendre en mariage cette jeune fille immédiatement après l’initiation.
• Objectif : L’objectif principal du rite de kikumbi est d’inciter la jeune fille, future mère, à se garder pure. La virginité de la femme est une vertu indispensable dans son rôle de reproductrice des autres vies humaines. Pour les Basolongo, avoir des rapports sexuels avant le kikumbi rend impure ou souillée une jeune fille. Cette façon de voir les choses est partagée par les chrétiens, les musulmans et les juifs. Chez les musulmans et les juifs, la virginité fait partie de la fierté de la jeune fille et de ses parents, voire de toute la famille. De même pour les kimbanguistes, une jeune fille ou un jeune garçon ne peuvent cohabiter sans avoir été unis par le sacrement du mariage. De la même manière que le nganga "féticheur" prescrit l’abstinence sexuelle à des compétiteurs (joueurs de football par exemple) avant d’entamer un match de football par exemple pour lequel il est consulté. C’est pourquoi G. Buakasa (1985: 27) considère que la sexualité est une chose à la fois permise et défendue. Après son initiation, la jeune fille peut intégrer le monde des adultes mature et prête.
3. 2. Nsámbu "bénédiction"
Le nsámbu ‘bénédiction’ est un rituel qui se déroule selon la cosmogonie des Basolongo (les Bakongo en général) et qui concerne un jeune homme ou une jeune fille qui respecte les anciens et les règles de la société. La bénédiction permet au bénéficiaire
d’acquérir un plus par rapport au cours normal des choses. Ainsi, un pêcheur béni attrapera plus de poissons ; le fruit de chasse sera d’autant plus abondant que le chasseur est béni ; un cultivateur béni cultive davantage d’hectares de terre et aura une récolte d’autant plus abondante.
3. 3. Objectif du nsámbu
L’objectif principal de ce rituel est la modification ou l’amélioration du cours normal des choses car rien n’est impossible à celui qui croit ou qui a la foi en Nzambi "Dieu", aux bakulu "ancêtres" et aux divinités secondaires.
3. 4. Types de nsámbu
D’après nos informateurs, il existe deux sortes de nsámbu "bénédiction": le nsámbu za salu "bénédiction relative au métier" que les Basolongo appellent dilau dia sálu et le nsámbu za zingu "bénédiction relative à la protection" qu’ils appellent élau dia zingu. Les deux rituels sont différents dans leur exécution et dans leur fondement. Comme leurs noms respectifs l’indiquent, l’un est temporaire tandis que l’autre est permanent :
3. 4. 1. Nsámbu za kisalu
• Pratique du nsambu za kisalu : Le requerrant se présente chez un parent (père, oncle ou grand-père paternel ou maternel selon le système patrilinéaire ou matrilinéaire) et fait la requête verbalement et à genou : « Moi, x, je suis chasseur. Je viens auprès de vous (mon père) pour solliciter la chance qui me manque pour mieux faire mon travail. Par la même occasion, je vous prie de me pardonner au cas où je vous ai offensé ou au cas où j’ai posé un acte répréhensible au regard du canon de notre société ou de celui de nos ancêtres. »
Cette supplique se fait discrètement et tard la nuit c’est-à-dire quand les ancêtres sont levés. En effet, quand les morts dorment, les vivants (y compris les sorciers) sont éveillés et vice et versa. C’est pourquoi, lors de l’accomplissement de ce rite, la discrétion est recommandée afin de ne pas réveiller les sorciers. L’impétrant apporte une dame-jeanne de vin de palme pour s’attirer la bienveillance de l’exécutant qui l’invitera le lendemain tôt le matin chez lui avant que tous les deux n’aient fait leurs ablutions.
On reconnaît là le principe d’équilibre entre le positif et le négatif. Les ancêtres (le positif) étant les plus forts que les sorciers qui sont des vivants, la bénédiction tournera d’abord à l’avantage du demandeur.
Mais il peut arriver que, plus tard, le négatif retourne le cours des choses à son avantage. Alors, il faut tout remettre à zéro. C’est pourquoi ce type de bénédiction est perçue comme temporaire. Elle nécessite un renouvellement continu chaque fois que le besoin s’en fait sentir car les esprits malfaisants sont informés enfin de compte du privilège acquis par le requérant grâce aux autres membres de la société qui constateront son avancement spectaculaire. C’est pour cette raison que d’aucuns, se méfiant du caractère temporaire de ce système, vont chez les nganga ‘devins ou féticheurs’ pour solliciter un charme approprié qui durera si possible toute la vie, en faveur de leurs proches parents ou pour assurer ou conforter leur virilité. Il va de soi que le requérant doit être capable de fournir le nécessaire pour que
l’exécutant fasse un sacrifice expiatoire.
Tout chef de famille peut bénir son fils, son neveu, sa fille ou sa nièce.
Mais ce pouvoir est limité et peut être contourné par les esprits malveillants qui rôdent inlassablement autour des autres membres du clan en vue de détruire tout ce qui est bénéfique à tout individu.
• Déroulement de la cérémonie du Nsámbu za kisalu : Une fois au lieu sûr, le demandeur s’agenouille devant l’exécutant assis et introduit sa requête en commençant par confesser ses péchés ou, s’il n’y a pas matière à confesser, il décline l’objet de sa requête. Se saisissant des deux mains du requérant, l’exécutant prononce les paroles ci-après :
« Moi x, père de y, je suis fils de z, petit-fils de m, je vous supplie, vous mes ancêtres, dans le bonheur comme dans le malheur, vu la conduite irréprochable de mon fils, de laver cet enfant et de bénir tout ce qu’il fait avec ses mains. Que ma prière soit exaucée par les seigneurs invisibles (génies) et les nganga za ntóto "seigneurs terrestres".» Par trois fois, il crachera sur les mains de l’impétrant, et puis l’aidera à se relever. Celui-ci s’en ira sans avoir à serrer la main de quiconque il rencontrerait sur le chemin de retour. »
• Analyse : On remarquera dans ce rite le symbolisme du nombre. Le nombre trois réfère à makuku matatu masimba e kongo "trois pierres qui soutenaient le royaume des Bakongo". Trois est aussi le symbole d’un Dieu trinitaire, Nzambi a mpungu, Dézo, Mbángu, père, fils et saint-esprit dans la cosmogonie des Basolongo. En comparaison et chez les Bwiti de Mitsogo au Gabon, le même nombre trois développe une mystique : rythme binaire (ombres ténèbres; profane-sacré ; initiénon-initié...) ; et dans le rythme ternaire, il exprime les trois grades fondamentaux (trois corbeilles de rotin attachées ensemble pour trois candidats à l'initiation, trois piliers peints en trois couleurs.)
3.4.2. Nsingulu "malédiction"
Le nsingulu ‘malédiction’ est le contraire du nsámbu "bénédiction". Elle procure une souffrance atroce, les errements, le trouble mental et, parfois, la mort. Les causes de la malédiction sont diverses, certes, mais toutes ne conduisent pas nécessairement à ces énormités absolues comme le précise C. Griaule (1965 : 425) : « Maudire est un meurtre, c’est une prière à rebours où l’on demande la mort (la maladie ou la folie) d’un coupable. Il s’agit de livrer à l’En dehors, engloutisseur inhumain, celui qui, par ses mauvaises actions, s’est déjà mis dans cette inhumanité. La parole de malédiction n’a pas besoin d’une efficacité magique. Elle énonce un fait : le témoin ou la victime se désolidarise de l’action mauvaise, du coupable, il se renforce dans l’ordre humain et renvoie dans la mort (ou la maladie), celui qui s’est conduit inhumainement. »
Concrètement, on peut citer la désobéissance aux parents comme cause principale de cette sanction. Les outrances verbales et les actes irrévérencieux tels que porter la main sur son père, sa mère, son oncle ou son grand-père ou commettre l’inceste entraînent inévitablement la malédiction. J. M. Munzele Munzimi (2001: 186 -187) cite un exemple concret dans le Bandundu, chez les Anbuun, sur la malédiction et sa réparation : « Un conflit entre un enfant et son père surgit à la suite d’une dispute. Elle se termine par une gifle que l’enfant administre à son père. Ce dernier, fâché, maudit son fils. Celui-ci, quelques jours plus tard, est pour tel ou tel motif, renvoyé de son travail. Et depuis lors, il ne trouve plus d’emploi et ne connaît pas de succès dans tout ce qu’il entreprend.
L’enfant contacte un ancien qui sollicite une réconciliation en son nom auprès de son papa. Ce dernier accepte la proposition. Le chef du lignage de la mère est averti. Il fixe le jour et l’heure (généralement le soir.) Il convoque tous les membres de la famille tant maternelle que paternelle. Ce sont en effet les deux lignages (du père et de la mère) qui sont concernés. Le chef du lignage introduit la cérémonie et passe la parole à l’enfant.
Celui-ci expose son pardon en ces termes : ″Papa, je suis votre fils, je suis comme votre chevreau qui vous donne des coups de patte, c’est le cœur qui m’a trompé, je ne ferai plus ce que j’ai fait. Les anciens ont dit que si les mains touchent les excréments, on ne les coupe pas mais on les lave. Je ne veux pas me passer de vous, car c’est vous qui m’avez engendré et avez guidé mes premiers pas. Je vous demande pardon devant ceux qui sont partis (morts) et ceux qui sont ici présents″. Et le père prend à son tour la parole et répond :
″Toi, tu es mon fils, tu m’avais frappé, c’est vrai. C’est moi qui t’ai maudit, je l’avoue et je l’ai dit parce que tu es sorti de l’union entre ta mère et moi. Mais aujourd’hui, que tout ce que j’ai dit et fait contre toi puisse couler comme dans la rivière et s’envoler comme le vent. Je te pardonne. Que tu puisses retrouver ta chance, et ta route sera ouverte dans la joie et la sincérité″.
L’enfant remet un bouc (animal domestique très apprécié) à son père. Celui-ci le donne au chef de lignage qui en coupe la tête et laisse couler le sang par terre, au milieu de l’assemblée, comme pour donner aux ancêtres. Car ils sont toujours présents partout où le lignage se retrouve. L’aîné de la communauté prend à son tour la parole et s’adresse aux ancêtres et l’assistance ″Voilà, vous nous avez laissés ici tous ensemble. Mais aujourd’hui certains d’entre nous ont voulu s’égarer et vous étiez au courant. Vous aviez aussi protesté avec le père de l’enfant car l’enfant n’avait plus aucun succès, ni dans son travail, ni dans son foyer. Les deux viennent de se réconcilier devant nous. Daignez accepter ce pardon comme nous membres des deux lignages ici présents viennent (sic) de le faire ; pour que tout redevienne comme avant″. »
Dans son ouvrage Famille, Sexualité et Culture, A. Kashamura (1973 : 147) cite un exemple quasi similaire :
« Un enfant ne doit pas brutaliser ses parents, sinon il est maudit. L’acte de malédiction est simple : son père ou sa mère, nu, lui tourne le derrière et tape sur leur propre dos en lui disant : ″désormais tu n’es plus mon enfant″. Si l’enfant n’obtient pas la révision de cette condamnation, il n’a plus qu’à quitter sa famille et les villages où on le connaît. »
Ce rite se veut à la fois comme un moyen de ramener les égarés à la bonne voie et une façon d’imposer le respect des règles de fonctionnement de la société. Il se substitue en quelque sorte à la prison ou à un lieu de correction dans la justice moderne car il n’existe pas d’infrastructure pour interner les coupables. Si ceci est vrai, il reste que la privation de la protection de la société est une punition encore plus redoutable en tant qu’elle livre l’individu à la merci des forces invisibles, cruelles et impitoyables. Par la malédiction, les ancêtres enferment dans une prison spirituelle (invisible à l’œil nu) le damné jusqu’à ce qu’il fasse amende honorable et qu’il reconnaisse le bien-fondé des structures et de l’autorité politico-sociales.
Chapitre 4 : Religion
4.1. Croyances des Basolongo

M. L. Martin (1981) décrit les Bakongo en général comme « une ethnie profondément croyante à un être supérieur ou suprême, Nzambi a mpungu, à côté duquel ils joignent les ancêtres, bakulu, qui servent de relais entre les vivants et cet être indescriptiblement plus puissant que leurs ancêtres. » D’où la notion des deux mondes : le monde visible et le monde invisible.
4.1.2. Monde visible
C’est le monde matériel où vivent tous les êtres animés de souffle, les êtres visibles et les objets palpables.
4.1.3. Monde invisible
C’est celui des êtres spirituels par exemple, les anges, zimbasi, les ancêtres, bakulu, et l’être suprême, Dieu, Nzambi a mpungu.
. Mythe des Basolongo sur la création de l’homme et de la femme
À une époque très reculée, vivait, dans l’univers, Mahuungu "bruit du vent", Etre unique, complet, total, parfait et clos. En parfaite harmonie avec toutes les créatures, il menait une vie joyeuse et heureuse, une vie qui ne connaissait pas la souffrance et la douleur. Il possédait tous les pouvoirs et toutes les forces contraires. Il pouvait grâce à son souffle violent provoquer une tempête ou un ouragan ou encore une douce et apaisante brise. Il pouvait créer, faire naître et détruire, faire mourir. Mahuungu était un être asexué ou plutôt un hermaphrodite : il n’était ni homme, ni femme. Un jour, Mahuungu vit germer près de son habitation un arbre: connu sous l’arbre divin, ?ti a Nzambi. Cet arbre, on l’appelle aujourd’hui diya ‘’Palmier". Un autre jour, Dieu tout puissant "Nzambi a Mpungu" interdit à Mahuungu de s’en approcher et de le toucher. Mahuungu a obéi pendant quelque temps, mais un jour il ne résista plus, s’approcha du palmier et le contourna. Aussitôt, l’Etre unique et complet se scinda en deux et devint deux entités distinctes : Lambu "homme" et Munzita, "femme". Aussitôt, la souffrance s’insinua dans ses deux entités : alors le sentiment d’être contingent ou de n’être pas complet s’imposa à eux. L’homme voulut retrouver les attributs féminins qu’il avait quittés et de même la femme voulut retrouver les attributs masculins qu’elle avait perdus. Alors, ils tinrent une réunion au cours de laquelle ils décidèrent de contourner à nouveau l’arbre divin en sens inverse et dans l’espoir de retrouver l’état initial. Ils le firent, mais sans succès. Ils sont demeurés deux êtres et n’étaient plus un Etre unique comme au commencement. La souffrance, l’imperfection et le sentiment d’être incomplet s’installèrent définitivement en eux. Puis, ils expérimentèrent peu à peu le sentiment d’être incomplets. Mais en même temps grandissait en eux ce besoin d’être étroitement liés l’un à l’autre. Puis, un jour, les parties différentes de leurs deux corps s’emboîtèrent et, l’espace d’un instant, ils revinrent à l’état initial de Mahuungu.
Contents et satisfaits, ils s’attelèrent plusieurs fois à faire durer et à maintenir ce moment d’unité parfaite. De cette union naquit un autre être semblable à eux qui, sans être complet et parfait, resta le symbole de la tentative de l’homme et de la femme pour retrouver leur unité du commencement (B. Fukiau, 1969 : 111 114 ; Cl. Faïk Nzunji, 1997 : 112-113)
Dans les croyances des Basolongo, le spirituel ou l’invisible précède le visible ou le matériel. Le destin de tout homme est tracé par Nzambi a Mpungu "Dieu" grâce à qui les ancêtres peuvent révéler aux vivants les différentes techniques de survie par l'art de guérir et par la divination. L’homme a besoin de vivre en harmonie avec nitu "son corps matériel" qui est constitué de quatre éléments :
nitu "le corps, méenga "le sang", móoyo "l'âme" et le mfumu kutu "double de l’âme" [C’est l’âme sensible qui se manifeste lors des syncopes et des visions) et le zina "le nom’" qui définit la personnalité de l'individu (S. J. Van Wing, 1959)].
Les Basolongo admettent l’existence dans l’au-delà des communautés invisibles dont les habitants mènent une vie quasi semblable à celles des vivants.
Certaines de ces communautés invisibles vivent dans l’eau et sont appelées maváta mampimpita "villages invisibles (de profondeur) où l’on trouve les mamiwata "sirène", les bisimbi ou zinkita "génies". Dans la forêt, se trouvent les témo, nkúya, kinyumba "esprits vagabonds ou fantômes". Sous la terre vivent les bakulu "ancêtres" et au mazulu ou kuyilu "ciel", vit Nzambi a mpungu "Dieu" ainsi que les zimbasi "anges".
Dans cet univers des esprits hiérarchisés (esprits supérieurs et inférieurs) auxquels ils croient et pour se défendre contre un sorcier ou un voisin qui chercherait à le nuire, un Musolongo pratique le kinganga "art de guérir" par les minkisi "fétiches" ou bien recourt au kinsadisi à makaya ma nsi "guérisseur se servant de plantes médicinales".
Les Basolongo, comme d'autres sous-groupes sociaux bakongo et du Congo en général, n'ont pas attendu l’arrivée des missionnaires européens pour connaître Nzambi "Dieu" comme le note R. Nyami Mashua (2000 : 104-107) dans le discours des premiers missionnaires catholiques à leur arrivée au Congo belge en 1920 : « N’enseignez pas aux Noirs congolais la notion de Dieu, qu'ils connaissent déjà bien ; dites leur plutôt, heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. »
Même si les missionnaires ont réussi à convertir au christianisme les Basolongo, ces derniers ont maintenu par ailleurs leurs anciennes croyances. Ainsi la maladie, l’infortune, la mort ou tout manque dans l'ordre social est expliqué comme étant dû à malfaisants qui maîtrisent malheureusement les réalités fondamentales de la vie. Contrairement l'action directe ou indirecte des bandoki "sorciers", ces êtres à ce que pensent beaucoup d'africanistes, anthropologues, ethnologues, historiens et sociologues en Occident, la notion de monde matériel a une relation dialectique avec le monde invisible spirituel. Ainsi donc et loin de relever de la magie noire, du fétichisme, du paganisme ou de la superstition, le verbe (parole) le geste et l’objet ont une place particulière dans la vie sociale et les croyances des Basolongo.
4.2. Croyance en Nzambi a Mpungu "Dieu"
Les Basolongo ne possèdent pas un terme propre qui désigne un être personnel spirituel, un esprit. La notion de Nzambi "Dieu" remplit l’univers de toute la société et correspond à celle d’Etre Suprême comme l’explicite A. Doutreloux (1961 : 55- 57) dans le passage qui suit :
« (…) chez les Bakongo, au sommet de la hiérarchie des êtres, se tient Nzambi. Il est l’Etre Suprême, créateur de tout ce qui existe, Souverain justicier. Il est bon et ne peut causer de tort à personne. Cet Etre apparaît comme unique en son genre, hors des prises des esprits inférieurs, des fétiches, de la sorcellerie et des hommes. Il réside dans le monde vague et inaccessible du haut, «mu zulu ou na yulu. Tout ce qui existe, hommes, femmes, esprits inférieurs, des fétiches, nature et cosmos, vient de lui. Il est maître de la vie et de la mort, hors les cas de la sorcellerie. Il punit ceux qui transgressent ses lois, celles données jadis aux ancêtres, mais il ne semble pas qu’il récompense les bons. On ne parle pas de sa bonté mais on juge inconcevable que le mal, hormis le châtiment des méchants, puisse venir de Nzambi.»
Cette affirmation rejoint celle de Van Wing (1959) qui soutient que « chez les Kongo, Nzambi a Mpungu, Dieu, est celui qui punit l’adultère, l’inceste, l’injure » ; ou de A. Doutreloux in J. Vansina (1976 : 125 ) pour qui : « le fait de parler souvent d’un Etre Suprême, Nzambi, auquel dictons, proverbes et légendes attribuent toute espèce de caractère transcendant, ne suppose pas nécessairement que cet Etre Suprême ait une place et un rôle effectifs dans la vie quotidienne, ni même qu’on en ait une conception bien arrêtée. »
Nous pensons concrètement sur ce point précis que « Albert Doutreloux » a bien raison, car chez les Bakongo en général, Nzambi ‘Dieu’ est à la fois vague et une réalité mystérieuse. Vague parce que très souvent, quand le Mukongo parle de Dieu, il a recours aux esprits intermédiaires entre homme et Dieu, les esprits de la terre, et secondairement des cieux ou de l’atmosphère, et les ancêtres, - chefs sacrés défunts. Une réalité mystérieuse, parce que, ce Dieu qui semble t-il est en accord avec toutes les autres puissances intermédiaires ; au point qu’uriner dans l’eau ou dire des mots impropres restent prohibés, sauf en cas d’ivresse.
C’est dire qu’aux yeux des paysans basolongo comme ailleurs chez d’autres Bantu, Nzambi semble être un fait évident, suffisamment vague et mystérieux, pour que tout ce qui échappe aux prises et à la compréhension de l’homme comme la vie et la mort, l’origine des choses, la loi et les coutumes lui soient rattachées. Cependant, les autres esprits tiennent une place beaucoup plus définie.
4. 3. Culte des bakulu "ancêtres"
À ce sujet, L. Dimomfu (1984 : 1- 69) affirme que « Tout membre du clan qui meurt entre automatiquement dans le kalungu (lieu de séjour des morts : sous terre, dans les cimetières, à l’emplacement des anciens villages, dans la profondeur des forêts ou sous le lit des rivières.) Les Basolongo s’imaginent que les morts mènent une vie quasi semblable à celle des vivants. Aussi les liens qui unissent les membres d'une famille ou d’un même clan persistent-ils par delà la mort d’un homme mort,
on dira : il rentre d’où il est venu. »
En rejoignant les ancêtres, tout mort devient supérieur à toute la communauté terrestre. Les ancêtres constituent en quelque sorte l’âme et la conscience des clans. Ils garantissent l’autorité, gardent les lois claniques, assurent la prospérité du clan à tous les niveaux. C’est ce qui explique pourquoi, quand les moyens le permettent, les Basolongo décédés en ville sont conduits dans leurs villages, auprès des ancêtres, pour y être enterrés.
Selon la philosophie des Basolongo, les ancêtres, continuellement présents dans la vie quotidienne, régissent, règlent et contrôlent la vie des membres du clan. Le destin des vivants est le reflet de la puissance de leurs ancêtres et leur survie conditionne la vie des descendants. Dès lors, leur culte constitue la première des sauvegardes. Tout ce qui fortifie l’ancêtre, fortifie sa descendance, et un ancêtre négligé peut se venger du coupable. Les ancêtres répartissent les membres du clan, après la mort, entre les bons d’un côté et les mauvais de l’autre.
Les ancêtres résident sous terre, dans des villages où on trouve en abondance les femmes, le gibier et tous les biens en général. Ils n’y admettent que ceux qui respectaient leurs lois pendant leur vie. Les autres en sont écartés sans recours.
La récompense des bons et le châtiment des méchants après la mort est donc le fait des bakulu "ancêtres" et non celui de Nzambi "Dieu". C’est ainsi que les méchants écartés du village des ancêtres constituent la classe des témbo "esprits" [Lire Albert Doutreloux (1961)]. Ils disposent à leur gré de mfunu ye ngaku (des utilités et fécondités.) C’est pourquoi on dit : bakulu, bazibula ye bazibikila ye ngaku que l’on peut traduire par "Les ancêtres ouvrent et ferment à volonté la cachette aux trésors".
Ces ancêtres sont des intermédiaires entre Dieu et les vivants. Ils sont comme les saints et les anges gardiens des vivants. Mieux qu’eux, ils ont un pouvoir important de vie et de mort sur les vivants ; ils leur donnent la chance, les faveurs, les effets maléfiques, etc.
Les ancêtres entrent en contact avec les vivants. Pour y parvenir, ils recourent aux songes. Dans d’autres cas, leur message est transmis au ( x ) membre (s) du clan par les devins, les nganga ngombo. Le sommeil et particulièrement le rêve sont considérés comme une séparation de l’âme et du corps, comme un état semblable à celui des morts.
Cette opinion a été confirmée dans la vie pratique. Par exemple, la femme musolongo attribue aux rêves la valeur d’un message prémonitoire au point qu’elle ne s’étonne pas de les voir se réaliser et que, logiquement, les songes peuvent influencer son comportement. La croyance aux visions et aux prédictions oniriques est à ce point bien ancrée dans les groupes de prières néo - chrétiens ou des Eglises dites du Réveil, des pasteurs n’hésitent pas à les utiliser pour séduire les femmes, et pour manipuler certains hommes faibles d’esprits.
Van Wing (1959) note que « Chez les Bantandu, les bakulu "ancêtres" apparaissent souvent dans la hutte des ancêtres sous forme des chauves-souris.
Quand le chef les entend, il y entre et tache d’imiter leur cri. » Le chef de clan est donc le point de jonction entre le clan actuel, constitué par les vivants, et les clans idéalisés, porteurs de valeurs ultimes symbolisées par la totalité des ancêtres, puisque c’est le chef du clan qui transmet la parole de ces derniers aux vivants, et des vivants aux ancêtres. Ainsi, il y a imbrication du sacré et du
politique.
Dans la vie de tous les jours, le clan est un relais entre les vivants et les morts.
Les ancêtres habitent la case du chef de clan où ils ont une place, « le coin des ancêtres. » C’est à cet endroit qu’est déposé tout ce qui est nécessaire à leur alimentation : nourriture non pimentée, boissons, etc. Par respect pour les ancêtres et par solidarité avec eux, le Musolongo leur offre les premières bouchées et les premières gouttes de nsámba ‘vin de palme’ ou toute autre boisson qui accompagne son repas.
Il convient dès lors de noter que dans le cadre du recours à l’authenticité prôné par le feu président Mobutu à l’époque, le toast porté en l’honneur des hôtes du gouvernement zaïrois commençait toujours par le versement, par terre ou dans un récipient, de quelques gouttes de la boisson contenue dans le verre, en mémoire des bankoko ‘ancêtres’ (en langue lingala). Les paysans font de même lors des premières semailles. La femme musolongo jette une poignée de grains aux quatre coins cardinaux en l’honneur des ancêtres. Les premiers haricots cueillis sur un champ par les paysans doivent y être laissés pour honorer les ancêtres, faute de quoi ils se vengent en ordonnant aux bêtes malfaisantes de détruire les récoltes.
4. 4. Attitude magique
Pour les premiers anthropologues (Radcliffe-Brown, Pritchard, Fortune, Malinowski et Margaret Maed) ainsi que pour des chercheurs dont les travaux sont plus récents comme Buakasa et Lapika, la mort suite à une cause naturelle (la maladie) n’est pas concevable pour les Africains et pour les Bakongo en particulier. Le concept d’accident n’existe pas. D’après la mentalité des Africains, rien n’est une pure coïncidence ou un hasard car tout est soumis à une cause efficiente et à un effet magique. La maladie d’un enfant, la mort d’un homme, la stérilité d’une femme sont autant d’exemples de l’action d’un esprit malfaisant ou d’un individu qui fait usage de puissances mystérieuses pour faire du tort aux êtres vivants.
N. de Cleene (1937: 119) consigne que, dans l’esprit de l’indigène (le congolais) la maladie n’est que la conséquence de la sorcellerie. La guérison est dès lors principalement recherchée par le dépistage et l’élimination des sorciers pour neutraliser leurs maléfices ; pour cela, on fait appel à la magie que M. Kalunzu (1985 : 521- 532) définit comme une technique qui permet à l’homme d’assujettir, de gré ou de force, les puissances surnaturelles. Selon lui, il y a mentalité magique lorsque l’homme attribue le sort de sa vie et le déroulement de l’histoire à l’intervention unilatérale d’une puissance occulte, mystérieuse, provenant d’unarrière-monde plus au moins identifié.
Les sous-groupes bakongo enregistrent différentes formes d’intervention de ces puissances occultes que sont les nkisi ou minkisi ‘fétiches’ et le kindoki "sorcellerie". La mentalité magique est une vieille mentalité fort tenace et que l’on retrouve un peu partout dans l’humanité, chez les païens, les chrétiens et même chez les athées.
Chez les Basolongo, le fétichisme et la sorcellerie sont dans une connexion constante. Les rites magiques sont des actes sacrés au même titre que les cérémonies religieuses comme le pense, en parlant des rites, L. de Heusch (1991 : 67) qui écrit ceci :
« (…) le système symbolique, la religion, est d’abord une riposte intellectuelle à une angoisse existentielle ; mais l’on ne peut perdre de vue que les rites et les croyances dont se compose ce système sont enracinés dans l’ordre social. »
Le Musolongo comme tout muntu fait la différence entre le fétichisme et la sorcellerie même s’il y en a beaucoup qui pensent que les minkisi ‘fétiches’ et le kindoki "sorcellerie" sont étroitement liés par un nœud mystique. Dans son article, ″La sorcellerie et l’ordre du lemba chez les Lari″, J. Malonga (1958 : 46) note ce qui suit : « Partout en Afrique – où le décès n’est jamais considéré comme une fin naturelle de l’être – personne ne peut prétendre nier l’existence de la sorcellerie à laquelle est attribuée la cause de toutes les maladies. Selon les milieux, la sorcellerie est exploitée de plusieurs manières, toutes d’ailleurs aussi fausses les unes que les autres parce que ces informations sont fournies par des profanes. L’explication valable ne peut venir que d’un sorcier authentique. Mais lié par le secret, même au prix de tortures inhumaines, de faveurs ou de richesses : la moindre indiscrétion de sa part quant aux manœuvres occultes de la secte lui vaut irrévocablement la peine de mort décrétée par ses pairs. »
4.5. Fétichisme, amulette et talisman
Le fétiche est un objet fabriqué en bois, en ivoire, en pierre, en argile ou en métal et auquel on donne une forme anthropomorphique. Produit d’un travail, c’est un objet d’une relation nécessaire avec un simbi "génie" qui l’anime et instrument magique entre les mains des hommes, notamment des nganga "féticheurs", pour protéger ou pour nuire. Le fétiche fait partie intégrante de la culture des Basolongo.

4.6 Notion de sorcellerie
M. Augé (1985 : 1250 -1256) entend par sorcellerie : « (…) un ensemble de croyances structurées et partagées par une population donnée touchant à l’origine du malheur, de la maladie ou de la mort, et l’ensemble des pratiques de détection, de thérapie et de sanctions qui correspondent à ces croyances. »
Pour G. Buakasa (1973), « la sorcellerie est une puissance, une force et une intelligence. Une puissance et une intelligence ambivalentes parce qu’elles peuvent accroître les récoltes ou les détruire. Cette puissance ou cette intelligence est considérée comme spéciale et supérieure (ngangu za mpimpa : intelligence de nuit) parce qu’elle permet de savoir comment se présente la réalité fondamentale des choses et des êtres humains, et dès lors, d’agir sur cette réalité dans le sens de soutenir ou de perturber son ordre et la vie, ou de répandre le malheur et de stériliser la nature. Cette intelligence supra-humaine et le pouvoir qu’elle pose comme complément nécessaire permettent d’influencer le fonctionnement normal de la réalité des choses et des êtres, ou d’agir sur cette réalité, soit pour la soutenir ou la renforcer et réaliser certains désirs... afin de rendre plus agréable l’existence matérielle de tous les hommes. » Aux dires de G. Buakasa, la notion de sorcellerie, est la justification d’une double réalité des choses :
• Elle est la justification de tout événement malencontreux : maladie, mort, infortune ;
• Elle est la justification de toute réussite sociale hors norme. Cette réussite ne semble pas donc être rendue possible que grâce à une certaine force destructrice.
A. Doutreloux (1961 : 55 – 57) pour sa part souligne que :
« la sorcellerie ou la mauvaise magie est un art qui permet à un individu de manger c’est-à-dire de détruire, à des degrés divers, la substance ou la vie d’un autre homme. Pour les Bakongo, la sorcellerie est un pouvoir susceptible d’être exercé pour générer une action maléfique aux dépens de la vie ou des biens des individus. Le recours à la sorcellerie répond donc à une volonté destructrice. Suivant cette philosophie, la sorcellerie par sa seule volition a des répercussions sur la force vitale des êtres les plus faibles. »
Chez les Basolongo comme ailleurs chez d’autres Bantu, les différentes conduites attribuées aux sorciers et aux sorcières sont en opposition systématique avec la norme. Ainsi, ils opèrent la nuit ; ils sont anthropophages ; ils commettent l’inceste ; ils ont le don d’ubiquité ; ils pratiquent le vampirisme, etc. Bref, ce sont des humains anormaux.
Toute la société attribue au ndoki une intelligence spéciale, supérieure à celle des humains ordinaires. C’est cette intelligence qui lui permet de savoir comment se présente la réalité fondamentale des choses et des êtres humains. Il possède ainsi le pouvoir de se placer au niveau de cette réalité et d’influencer le cours de choses de manière néfaste. Le sorcier peut, grâce à ce pouvoir, perturber l’ordre des choses pour répandre le malheur ou modifier négativement la nature.
Le champ d’action de la sorcellerie est donc vaste et complexe. Cela dépend des causes ou des raisons qui justifient son maléfice.
4.7. Causes de la sorcellerie
Chez les Basolongo (Bakongo en général) comme chez les Dogon du Mali, les principales causes de la sorcellerie sont : la jalousie, la vengeance, la concurrence, le non-respect des obligations ou des engagements et la réciprocité. D’une manière générale, toute personne chez laquelle on perçoit des signes de rancune, de jalousie explosive, de lubricité, d’avarice, de volonté de puissance peut être accusée de ndoki selon les circonstances comme l’explique longuement G. Balandier (1984 : 161) que : « (…) la dialectique de la contestation et de la conformité du pouvoir revendiqué et du pouvoir accepté s’exprime le plus souvent dans le langage de la sorcellerie révélant indirectement une opposition cachée, quand il ne s’agit pas d’un recours direct aux pratiques de la magie d’agression. Le pouvoir politique effectif et l’influence ne sont nécessairement ou exclusivement détenus par ceux qui peuvent y prétendre selon les règles généalogiques et constitutionnelles. La sorcellerie est l'un des moyens du pouvoir, soit qu’elle renforce sa contrainte et / ou le protège contre les entreprises de contestation, soit qu’elle permette un véritable transfert sur l’accusé ou le suspect des ressentiments ou des doutes menaçant les autorités lignagères. »
Pour sa part, G. Buakasa (1973 : 274), affirme ce qui suit : « (...) le kindoki n’est pas nécessairement limitée à une région déterminée de l’espace social : elle est ou peut se retrouver dans plusieurs pratiques spécifiques. Par exemple, dans l’activité économique, politique ou juridique, etc. Dès lors, on ne peut pas comprendre le kindoki et les minkisi en se rapportant à la seule théorie contenue dans les attitudes et les comportements des sujets concernés, mais en se reportant aux rapports sociaux, et en deçà de ceux ci, au mode de vie qui les fonde. Le kindoki et le nkisi sont un mode de réalisation déguisé des conflits sociaux refoulés, un lieu où décharger l’agressivité provoquée par la frustration née des besoins ou des désirs non satisfaits, c’est-à-dire en dernière analyse, des contradictions sociales. Et par-là, un lieu de reproduction des rapports sociaux. »
4.8. Modes d’acquisition de la sorcellerie
Comment devient-on sorcier ? Quels sont les modes d’acquisition de la sorcellerie ? Les Basolongo distinguent trois modes d’acquisition de la sorcellerie :
• Elle peut être acquise par la naissance : kindoki congénital, inné, hérité d’un ancien du clan. Le ndoki peut être inconscient de la présence en lui de ce pouvoir ;
• Elle peut aussi être acquise par apprentissage (vanda kindoki.) Cet apprentissage a lieu par l’initiation d’un fétiche, nkisi, à l’issue de laquelle un contrat est conclu avec ce dernier, pour disposer d’un pouvoir de domination ;
• Elle peut enfin être acquise par contamination : quelqu’un croit manger du poisson et ce qu’il mange en a effectivement l’apparence. Mais c’est, lui dira- t on la nuit par exemple, de la chair humaine. N. A. Lubana (1990 : 212 ) précise que l’initiation à l’état de féticheur-sorcier (celui qui ensorcelle consciemment) fait parfois l’objet d’épreuves cruelles, parmi lesquelles le meurtre d’un proche parent constitue une des plus pénibles. Chez les Bakongo, personne n’avoue publiquement être sorcier. Mais lorsqu’un individu est désigné par le devin ou par la rumeur publique comme étant sorcier, il lui sera difficile, voire impossible, de prouver son innocence. La seule façon de réagir est d’émigrer ou de se réconcilier avec sa ou ses victime (s). C’est la raison pour laquelle la sorcellerie est la cause principale de la scission des clans.
Sur le plan de la recherche, il convient de poser la question suivante : quelle preuve les paysans et tous ceux qui croient en la sorcellerie possèdent-ils pour accuser un individu de sorcellerie ? Sur quoi se basent-ils pour affirmer que l’un d’entre eux possède les pouvoirs du sorcier ? Relayant cette interrogation, Lapika Dimomfu (op cit. 12) souligne que « (…) les Bakongo pensent que les sorciers (bandoki ) sont au départ des êtres humains qui ont réussi à maîtriser pour leur propre compte le pouvoir des génies, c’est à-dire tous les êtres qui appartiennent en fait au monde invisible, mais qui, par moment, font une incursion dans le monde visible. Ces êtres invisibles (les ancêtres, les dieux et autres esprits) peuvent être influencés par un homme comme ils peuvent agir pour lui. Ils peuvent être domestiqués par l’homme qui peut, par conséquent, s’en servir à ses desseins et les rendre donc favorables à lui. »
Ainsi, tout procès sur la sorcellerie et ses différents mécanismes reste secret.
Son influence sur les non-initiés fait de la sorcellerie un phénomène social important. Cette littérature consacrée à la vie magico-religieuse des Basolongo vient de souligner l’importance de ces phénomènes. Nous venons en effet de cerner la notion même de sorcellerie, les causes d’ensorcellement et les modes d’acquisition de celle-ci. Maintenant nous allons étudier les victimes et le mode d’ensorcellement.
4.9. Victimes de la sorcellerie
A. Doutreloux (1961) avait déjà constaté que le kindoki ‘sorcellerie’ régnait et règne encore autant et parallèlement du reste que le fétichisme sur la vie magique des Bakongo. Seuls, Nzambi ‘Dieu’ et les esprits supérieurs échappent aux entreprises des sorciers. Il y a plusieurs modes d’ensorcellement dont les trois suivants :
• Loka nkisi : le maléfice est jeté par l’intermédiaire d’un fétiche.
• Loka mpanda : des parents ou des grands-parents utilisent leur force vitale pour maudire, sans intermédiaire quelconque, leur enfant ou petit- enfants.
• Loka kibuti : le même pouvoir est exercé par un oncle maternel, contre un neveu ou une nièce.
Tous les membres d’un lignage ont la possibilité d’exercer les uns sur les autres le pouvoir vital. Les entreprises de sorcellerie se développent, surtout contre les collatéraux. En effet, les victimes de la sorcellerie sont généralement choisies à l’intérieur du clan parmi les enfants, les femmes et les jeunes gens. La sorcellerie est donc le pouvoir vital qu’un membre du clan peut exercer sur un autre par haine, jalousie ou par envie. Dès lors, c’est très fréquemment à la suite d’un fait de sorcellerie que se segmentent les clans bakongo. Elle est la chose la plus redoutée et la plus détestée par les Bakongo. Pour eux, elle est avant tout une réalité empirique. Jusqu’à nos jours, la science n’est pas encore parvenue à confirmer cette existence de manière expérimentale. Bref, la sorcellerie est une réalité sociologico-anthropologique vécue empiriquement par les paysans, mais non encore cernée de manière expérimentale par la science moderne.
Pour les Basolongo, il existe une démarche appropriée au monde des sorciers pour ensorceler les personnes visées.
4.10. Différentes techniques d’ensorcellement
Le sorcier provoque la maladie et la mort en employant des incantations sur des restes personnels de la victime : restes de nourriture, des excréments, des empreintes de pied dans le sable, la saleté du corps, un morceau de vêtement, les ongles, les cheveux. Il accomplit toute son œuvre pendant qu’il sommeille, suite à une décision préalable prise en étant éveillé et pleinement conscient et après avoir récité ses incantations comme l’explique le Belge J. Vansina (1966) : « Le maléfice, est lancé par l’intermédiaire d’un fétiche en utilisant la force vitale qui circule de génération en génération, surtout en ligne maternelle, mais aussi en ligne paternelle et en affectant principalement les collatéraux. » Chez les Basolongo, les ndoki zi nkéento sorcières’" recourent à une manière particulière (le rapt de l’esprit de la victime) pour provoquer la maladie et surtout la mort chez les enfants.
Tout sorcier musolongo – répétons-le - opère principalement la nuit même si la possibilité d’exercer le jour n’est pas totalement écartée. Il s’éclaire à l’aide d’un torchon attaché à ses organes génitaux. D’après les Basolongo, le ndoki ‘sorcier’ suce le sang de ses victimes. A cause de cette cruauté, il est non seulement méprisé et haï, mais surtout craint et évité. Il n’est accueilli nulle part. Le sorcier convoite et atteint principalement les jeunes filles pour les violer et leur faire des enfants la nuit, ce qui rend ces jeunes filles stériles le jour. Nous avons également appris à ce sujet précis que les hommes non-sorciers refusent d’épouser de telles filles dont l’apparence extérieure trahit leur vieillesse intérieure.
En pratique et dès que le ou les sorciers a ou ont repéré leur victime, il ou ils l’ensorcelle (nt) grâce à leurs pouvoirs spéciaux. Le succès de l’entreprise sorcière tient à la capacité du sorcier à bien maîtriser les réalités du monde invisible, faute de quoi il se fera neutraliser par un nganga-nkisi ‘féticheur’ investi par les ancêtres d’un pouvoir plus fort pour décoder les réalités du monde invisible.
L. Dimomfu (1984 : 1-69) schématise les interactions constantes de différents ordres dans la vie magico religieuse des Bakongo de la manière suivante :

Les paysans affirment que le sorcier peut tuer par le seul regard : “disu divonda”, “avoir un regard assassin”. Il peut, grâce à son œil brillant, hyptoniser sa victime au point de lui retirer toute possibilité de se mouvoir et d’annihiler sa conscience.
Pour tuer son adversaire, il suffit de recourir à une potion toxique, de l’effleurer, de faire un simple mouvement, voire de dire un seul mot. M. Augé (1985 : 250-256) fait remarquer à ce sujet ce qui suit :
« (…) les représentations de la personne, des pouvoirs qui sont censés s’exercer à partir d’elle ou sur elle, de l’hérédité, de l’entourage mystique et social, de la maladie…composent un ensemble cohérent, un système ordonné de références pour la compréhension d’un événement ; les croyances à la sorcellerie entrent dans cette configuration d’ensemble, d’une part parce qu’elles se réfèrent explicitement aux représentations de la personne et du système social, d’autre part parce qu’elles complètent ces représentations en spécifiant la nature des pouvoirs offensifs propres aux différentes instances psychologiques et en délimitant leurs sphères sociales d’influence (le clan.) »
La théorie de la sorcellerie assigne un domaine à l’action du sorcier, trace les limites sociales et géographiques de son efficacité, se prononce sur les forces respectives des individus impliqués (jeunes et vieillards, hommes et femmes, sorciers et contre sorciers) et dénombre ou décrit les faits et les pratiques et en esquisse l’étiologie sans pouvoir les prouver rationnellement. C’est pourquoi on peut dire que la théorie de la sorcellerie est interprétative. Cette théorie est également normative dans la mesure où elle permet d’expliquer la réalité vécue et dicte les règles à suivre pour ne pas être victime du sorcier ou de l’accusation de sorcellerie, chez les Basolongo, cette réalité se dévoile à l’occasion des conflits sociaux, des séparations et d’anomie.
La sorcellerie est comme une discipline qui a ses maîtres à penser, ses prolégomènes, ses lois et sa logique propre, mais une discipline ou un système qui a ses contradictions internes. Sur le plan strictement sociologique et comme nous venons de le mentionner plus haut, elle se présente, avec son interprétation, ses interrogations et ses tentatives de réponses, comme une théorie qui, à la fois, défend à sa façon sa propre existence et prescrit un ensemble de règles de conduite.
Chez les Basolongo, la sorcellerie est à la fois l’expression et la cause de beaucoup de ces conflits sociaux qui secouent les communautés. Elle constitue l’explication dernière de tout mal frappant l’individu ou le groupe. De ce fait, elle est perçue comme une plaie sociale contre laquelle les autorités coutumières, les devins, les guérisseurs, les féticheurs, les sectes religieuses et les églises chrétiennes se mobilisent.
En définitive, la sorcellerie est une valeur socioculturelle contraignante : la cohésion au sein du clan est entretenue à la suite de la crainte qu’ont les gens d’être ensorcelés lorsqu’ils cessent de se conformer à la coutume, fu kia nsi. La logique de la sorcellerie n’est pas pour autant irrationnelle. Au contraire, sa fonction est de rendre acceptable à l’esprit humain même ce qui est inintelligible et choquant comme la maladie, l’accident ou la mort.
4.11. Remèdes contre la sorcellerie
Quels remèdes apporter à la sorcellerie qui semble beaucoup influencer le comportement des Bakongo en général ? D’après G. Buakasa (1973), « les principales actions pour régler les problèmes de la sorcellerie et pour se prémunir contre les sorciers sont :
• Le respect des aînés : obéir à sa mère, à son père, à son oncle maternel pour obtenir leur protection contre le ndoki. Cela revient à honorer les anciens, les vieilles personnes, avoir confiance en elles, les prendre comme guides. Cela revient également à célébrer le culte des ancêtres, donc à se garder d’enfreindre les lois et les interdits et négliger les rites. Cela revient, en conséquence, à respecter la tradition que les ancêtres couvrent de leur autorité, et à l’origine de laquelle ils se trouvent. Les bandoki en effet profitent des situations où la loi est transgressée, où les aînés sont mécontents, où l’entente dans le village ou dans le lignage, luvila, ne règne pas.
• Recourt au nkisi pour sa défense personnelle ou celle de son groupe.
• Ne pas susciter de la jalousie : une situation trop en vue est vite menacée par les bandoki. Autrement dit, il faut être conformiste, plutôt que déviant ;
• Eviter de manger n’importe quoi de n’importe qui ou n’importe où, de peur de “manger” de la ″chair humaine″ (nsuni a muntu.) Car, chez les bandoki, celui qui mange de la chair de leurs victimes doit à son tour en offrir ;
• L’imposition, à la naissance ou lors d’une séance d’exorcisme, d’un nom dont la signification s’insère dans la lutte contre les bandoki pour combattre ceux ci, neutraliser leur action ou tromper leur vigilance.
Parmi les noms donnés aux enfants, il en existe qui éloignent la mort ou le malheur ; qui empêchent les bandoki d’agir. C’est le cas par exemple des noms d’animaux ou des matières répugnantes, noms des minkisi : Tona kio, Malulu, Nkósi, Nsánda, etc (Discernes-le, Amer, Lion, Serpent) ;
• Etre soi-même redoutable ou fort par la sorcellerie ;
• L’épreuve du poison pratiquée jadis (malheureusement interdite de nos jours par l’autorité) ;
• Le bannissement du ndoki. Il y a deux possibilités : chasser le ndoki loin de soi et loin du groupe ou le faire mourir ;
• La séparation : scission du clan, du village, du lignage, etc. ;
• La réconciliation (du sorcier avec sa victime) et la confession publique (conseillées par les principes et méthodes de l’Eglise Kimbanguiste)
• Emigrer en ville. »
Le nganga-manga ou le nganga-ngombo tout court, le grand chasseur des esprits et des objets maléfiques, est au centre de toutes les mesures proposées par Gérard Buakasa contre les sorciers.
En définitive, les problèmes de la sorcellerie en Afrique noire restent sans solution dans leur ensemble. Tous les rites « d’exorcisation » auxquels on a recours sont des solutions provisoires, fragiles et même très souvent manipulées.
Il est vrai que la sorcellerie continue à perturber le milieu ou l’univers de ceux qui se présentent comme des religieux fervents.
La crainte du sorcier est loin de disparaître chez les Basolongo: il suffit de jeter un regard dans un ouvrage datant du XIVème ou du XVème siècle et traitant des problèmes africains, notamment de la sorcellerie, pour conclure que la situation n’a pas évolué. Les époques ont certes changé, mais la croyance en la sorcellerie persiste. Bon nombre d’Africains en général et des Bakongo en particulier continuent à croire que la réussite sociale ou intellectuelle relève ou dépend des forces surnaturelles. Même ceux des Africains qui gouvernent l’Afrique moderne croient encore très fort à la sorcellerie. On a le droit de se demander si la crainte du sorcier est due à la philosophie africaine ou à la mentalité foncièrement religieuse des Africains. On peut en outre se demander si cette crainte disparaîtra un jour avec tout le brassage de cultures que subissent de plus en plus les nouvelles générations africaines. Le témoignage ci-après que nous reproduisons semble donner en substance un petit espoir en ce qui est de la réponse positive à notre dernière interrogation :
« Il était une fois, deux jeunes étudiants se fiancèrent à Kinshasa. Les obligations des études poussèrent ces amoureux passionnés à se séparer du moins pour un long moment. Albert obtint une bourse de cinq années pour des études de médecine aux Etats Unis. Une année, après, Françoise obtint-elle aussi une bourse d’études en hôtellerie pour le Japon.
Dès sa première année, elle rencontre un séduisant jeune homme, le nommé Yokomoto avec qui elle sort plusieurs fois. Consciente de sa relation de fiançailles avec Albert, elle va rompre avec ce dernier. Seulement, après sa rupture, elle se rend compte qu’elle est enceinte. Elle se refusa à tout lui avouer et chercha des solutions à ce problème. Elle ne peut pas l’annoncer à Yokomoto, moins encore à Albert. Puis, elle se décida à se confier à des religieuses. Celles-ci la prièrent de garder l’enfant avec la promesse de s’en occuper dès son accouchement. Elle accepta cette généreuse offre.
Neuf mois plupart, elle accoucha d’un beau petit bébé. Puis sa vie reprit le train habituel sans le moindre soupçon. Seulement à l’accouchement, les sœurs avaient eu le soin de noter les coordonnées de Françoise au cas où le besoin se ferait un jour sentir.
Ses deux ans furent couronnés de succès. Elle obtient son diplôme et rentre au pays où elle trouve du travail à l’hôtel Regina, comme directrice gérante. Deux ans plus tard, Albert rentre avec un brillant diplôme de médecin. Leurs retrouvailles furent fébriles au point qu’ils finirent par se marier la même année.
Albert obtint à son tour le poste de médecin en chef à l’hôpital central. Le couple est très heureux, évolué et comblé de joie. Ils s’aiment avec passion.
Les années se succèdent, mais le couple n’eut aucun enfant. Albert fut pensionné à l’âge de septante ans et mourut, suite à une tenace tumeur trois ans après des soins suivis de ses confrères.
Alors, Françoise devrait poursuivre son chemin de la vie seule, dans une énorme villa dans la zone résidentielle de Mbinza. De l’autre côté des horizons, Yokomoto Junior achève de brillantes études de Relations internationales et obtient un poste d’ambassadeur au Congo-Brazzaville.
Légèrement après la mise en poste, il eut les informations sur sa mère biologique. Un bon matin, il décida de faire un tour à Kinshasa. Il retrouva sans difficulté l’adresse de Françoise. Son chauffeur sonne devant l’énorme portail d’entrée de la résidence de Françoise. Elle vient personnellement leur ouvrir et les invite à entrer.
Après avoir échangé quelques mots, Françoise demande à ses hôtes le mobile de leur visite. Yokomoto Junior prend la parole et dit : avez-vous été en formation au Japon entre les années 1963 à 1965 ?
Oui, répondit-elle avec hésitation. Ensuite, il poursuivit avec les détails précis sur elle et son histoire pendant sa formation au Japon. Françoise comprit tout de suite où il voulait en venir. Elle lui avoua sans comprendre que l’homme qui l’interrogeait était bel et bien ce fils qu’elle avait abandonné. Elle s’est mise à pleurer, pleurer, mais Yokomoto Junior l’arrêta et lui dit : “je suis cet enfant que vous avez abandonné. Je voulais seulement savoir quel type de femme vous êtes.” A ces mots, elle s’est mise à crier, mon fils ! Mon fils! Mais, Junior lui dit : non ! Et je m’en vais !
Françoise en tant que Mukongo se mit à hurler, attend, attend, je suis tout de même ta mère. Les deux visiteurs prirent le chemin du retour pour Brazzaville.
Une semaine plus tard, Françoise se décida à son tour d’aller rejoindre l’ambassadeur du Japon à Brazzaville. Elle se renseigna dès sa traversée du bateau et se fit conduire par taxi à la résidence privée de Yokomoto Junior. Elle sonne à la porte, un gardien se pointe et lui parle en Japonais; elle ne comprend rien du tout. Puis, elle se met à crier : “je veux voir l’ambassadeur lui-même”. “Je suis sa mère”. Grâce au tapage, la femme de l’ambassadeur sort en tenue de chambre pour en savoir davantage. Mais elle non plus, ne comprend rien.
Comme la femme traînait à revenir, le mari va à son tour vers la porte et ordonne que l'on puisse la laisser entrer dans la parcelle pour l’écouter.
Soudain, Françoise se mit à exposer son problème. Yokomoto Junior resta stricte et la pria de rentrer chez elle. A ces mots, elle se mit à maudire Yokomoto Junior.
“Elle retira son pagne, puis, s’inclina du haut vers le bas en montrant son derrière à son fils et dit : ″Yokomoto, vo mono ngudiaku, ki ku zolele kungwila kó, singúlu va ntóto ye ku zúlú, ngéye kutomi, zingu kiaku kiawónsóno.″ (Yokomoto, je suis ta mère, comme tu t’obstines à ne pas m’obéir, tu es maudit sur terre comme au ciel, tu ne seras jamais heureux toute ta vie.) Après ce rite, elle partit en claquant la porte pour Kinshasa où elle habitait. Yokomoto qui ne comprit rien de toute la scène s’est renseigné du geste spectaculaire dont ils étaient témoins. On lui apprendra quelques jours plus tard qu’il était maudit à jamais. Ceci dit, il se mit à rire aux larmes. Il apprendra par la suite qu’au courant de la même année, Françoise était morte. Evidemment, rien n’avait changé dans sa vie. »
Sur le plan de la recherche, il y a lieu de se poser trois questions :
a) pourquoi le rite de la malédiction n’avait-elle pas fonctionné dans ce cas, alors que généralement il marche ?
b) Pourquoi Yokomoto Junior avait-il ri après avoir appris le vrai sens de la scène faite par Françoise, sa mère biologique ?
c) faut-il être 100 % Mukongo pour qu’un tel rite somme toute lié à la croyance devienne opératoire?
4.12. Conclusion
À l’instar des Balega et d’autres groupes sociaux (ethnies) en Afrique noire, la manipulation de la parole en pays basolongo est une chose qui s’apprend auprès des anciens, bambuta. La construction du monde socioculturel chez les Basolongo repose sur la tradition orale, les récits et les légendes. Par ailleurs, toute la vie de la société clanique est une vie du verbe renforcé par des composantes didactiques d’inter-communications tels que le rythme, le proverbe, la devinette, le conte, le chant, le symbole et la rumeur publique (F. Bezy, 1971).
Source : Le Káandu chez les Basolongo du Bas-Congo (RDC) Par Nathalis Lembe-Masiala
Date de dernière mise à jour : Thursday, 10 October 2019
Ajouter un commentaire