L’Afrique perd plus de 7000 milliards FCFA par an à cause du paludisme

[Diamniadio, Sénégal] "Le paludisme à lui seul devrait priver le continent de 12 milliards de dollars (environ 7 000 milliards de FCFA) par an, en perte de productivité, en investissements et en coûts de santé associés".
Ainsi s’exprimait Mariama Cissé, représentante de l’Union africaine, à l’occasion de la septième conférence panafricaine de l’Initiative multilatérale sur le paludisme [Multilaterial Initiative on Malaria, MIM], ouverte ce dimanche à Diamniadio, à une quarantaine de kilomètres de Dakar au Sénégal.
Mariama Cissé a dès lors invité les dirigeants africains à "aborder la question de la santé avec audace, pour atteindre les aspirations ambitieuses pour le développement socioéconomique, la croissance économique inclusive et l’agenda de transformation structurelle de l’Afrique d’ici à 2063."
“Si nous avons l’ambition d’éradiquer le paludisme, il faudra accepter de faire beaucoup plus et de façon plus vigoureuse, de façon plus dynamique et de façon plus économique”
Magda Robalo, représentante région Afrique, l’OMS
Selon le rapport 2017 de l’OMS sur le paludisme, 91 pays ont signalé un total de 216 millions de cas de paludisme en 2016, soit une augmentation de 5 millions de cas par rapport à l'année précédente.
Le nombre global de décès dus au paludisme a atteint 445 000 morts, à peu près l'équivalent du nombre signalé en 2015.
La région Afrique de l'OMS continue de représenter environ 90% des cas de paludisme et des décès à l'échelle mondiale.
L’OMS précise en outre que quinze pays - dont quatorze d’Afrique subsaharienne - portent 80% de la charge mondiale du paludisme.
Au regard du relâchement, Mariama Cissé pense que les pays africains doivent renouveler leurs engagements pour une Afrique exempte de paludisme, d’ici à 2030.
Question de rester en conformité avec le cadre catalytique de lutte contre le sida, la tuberculose et l’élimination du paludisme, adopté par les chefs d’Etats et de gouvernements, lors du sommet de l’Union Africaine, en juin 2016.
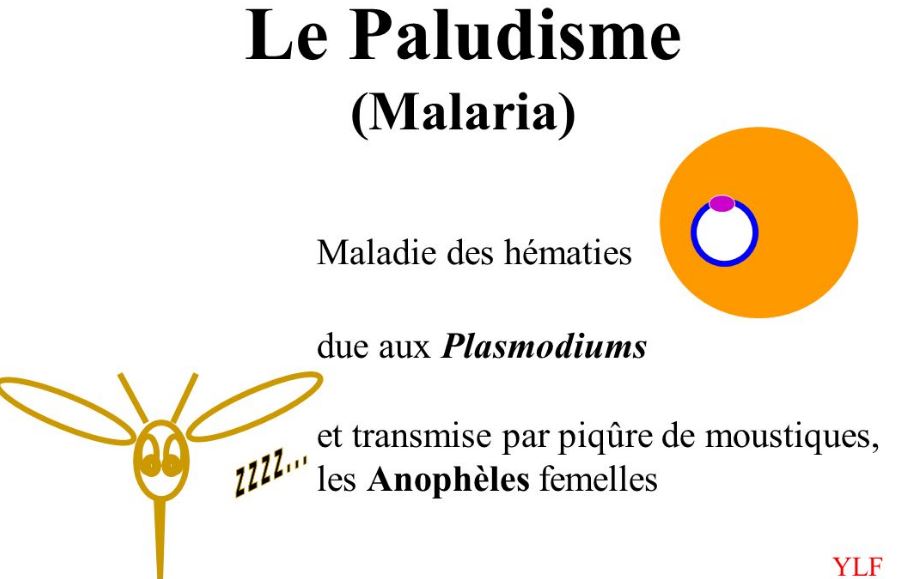
Appel à la mobilisation
"Notre génération peut le faire. Je suis convaincue que nous pouvons vaincre le paludisme de notre vivant", se convainc pour sa part Magda Robalo, représentante de la région Afrique de l’OMS.
Dans un discours aux accents d’appel à la mobilisation, la responsable onusienne a énuméré les progrès réalisés dans la lutte contre le paludisme, tout en notant les contre-performances de ces dernières années.
Outre l’augmentation du nombre de cas de paludisme, elle a évoqué la baisse, depuis 2014, du financement de la lutte contre le paludisme, en particulier en provenance de sources nationales.
"Si nous avons l’ambition d’éradiquer le paludisme, il faudra accepter de faire beaucoup plus et de façon plus vigoureuse, de façon plus dynamique et de façon plus économique", a-t-elle poursuivi.
Mariama Cissé estime pour cela que l’énorme boom économique des pays africains offre une opportunité d’améliorer les prestations de services dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, des secteurs dont dépend la santé des populations.
Magda Robalo a par ailleurs insisté sur l’importance de la recherche dans la lutte contre le paludisme, estimant que la reconnaissance à l’échelle internationale du rôle des chercheurs a enclenché une dynamique importante en faveur d’une collaboration accrue entre les institutions de recherche, les décideurs et les personnes chargées de la mise en œuvre des programmes de lutte.
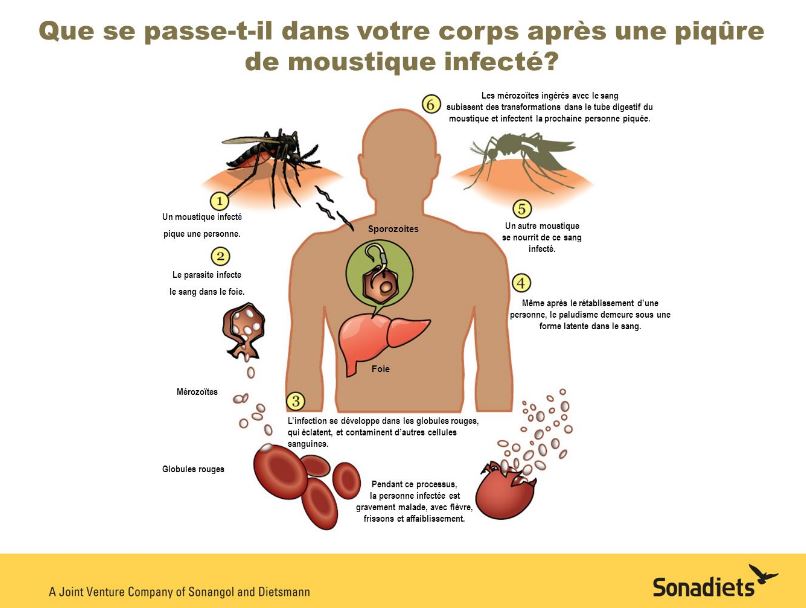
Recherche
Elle a, à cet égard, salué les collaborations entre chercheurs spécialisés dans la prévention et le contrôle, qui ont permis la mise au point du vaccin RTS,S, un nouvel outil de prévention du paludisme chez les enfants, considéré comme "une nouvelle frontière" à explorer dans la lutte contre la pandémie.
Harold Varmus, Prix Nobel de médecine en 1989, a aussi salué dans un exposé, les contributions des chercheurs africains dans la lutte contre le paludisme, citant l’exemple du Malien Ogobara Doumbo, directeur du Centre de formation et de recherche sur le paludisme au Mali.
Pour sa part, Rose Leke, présidente du secrétariat du MIM, a rappelé le chemin parcouru depuis la première réunion de l’organisation, en 1997, à Dakar, expliquant qu’elle a permis d’impulser une nouvelle dynamique à la lutte contre le paludisme, à l’échelle mondiale, avec une mobilisation sans précédent des ressources intellectuelles et financières, ainsi qu’un appui politique conséquent.
Pendant cinq jours, les experts venus du monde entier, vont réfléchir à la situation épidémiologique sur le continent, ainsi qu’aux défis qui restent à relever pour une éradication totale du paludisme.
(Ecofin Hebdo)

