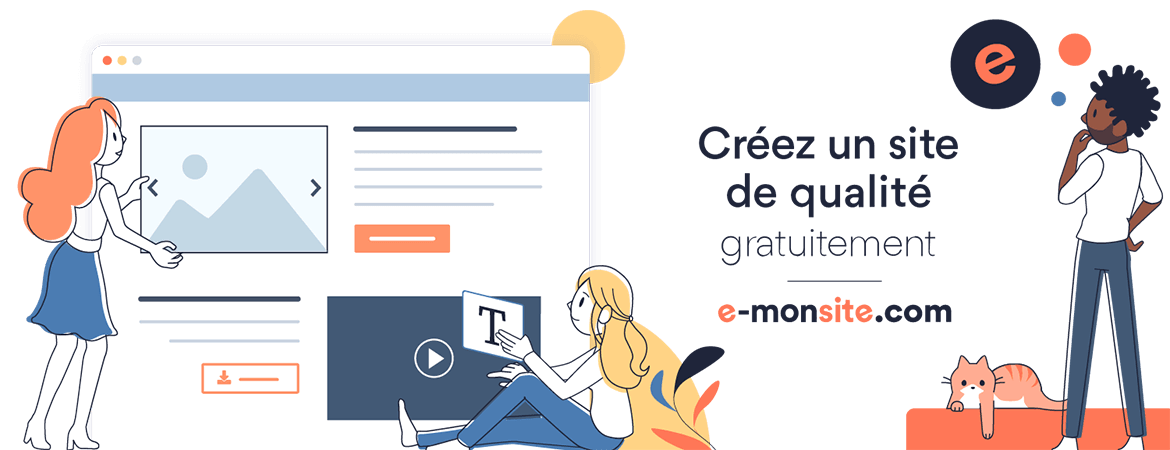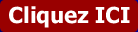Congo : le salut par les plantes
Le 07/09/2020

La République démocratique du Congo, qui compte plus de 60 millions d’habitants, est l’un des pays les plus pauvres et les plus désorganisés du continent noir. La majorité des gens n’y mangent qu’un seul vrai repas par jour. Dans cet État immense – le troisième d’Afrique pour ce qui est de la superficie, après le Nigeria et l’Algérie – au relief accidenté, parcouru par de nombreux cours d’eau, se trouvent la moitié des forêts tropicales africaines. Cela en fait un des pays les plus riches au monde en plantes médicinales et autres « superplantes ». Pourtant, l’Afrique n’a encore que 7 % des parts de ce marché, dominé par l’Asie.
Les plantes qui poussent si aisément en RDC valent leur pesant d’or : alors qu’un kilo de romarin se vend environ un dollar, par exemple, un kilo d’artémisine (substance active issue de l’armoise et utilisée en médecine chinoise depuis 2 000 ans) en vaut 780 ! « Les Congolais ont de l’or vert entre les mains. Quelqu’un doit leur enseigner les règles du jeu de l’économie de marché ! » dit Carole Robert.
Cette Québécoise de 53 ans, infirmière de formation, a vite orienté sa carrière vers le commerce international. Elle a notamment présidé pendant six ans le conseil d’administration du World Trade Centre Montréal et a été membre du conseil d’administration de Montréal International. C’est pendant son MBA à HEC Montréal, entrepris en 2002, à 44 ans, qu’elle s’intéresse à l’énorme potentiel du marché des plantes médicinales. Elle choisit la RDC en raison de sa richesse en la matière.

Carole Robert aurait pu se contenter de fonder une entreprise – PharmAfrican, née en 2008 à Lévis, encore embryonnaire, qui vendra des licences de fabrication. (L’entreprise participe actuellement à un programme de recherche avec l’Institut des nutraceutiques et des aliments fonctionnels, de l’Université Laval, concernant les propriétés de deux plantes africaines.) Mais Carole Robert voulait davantage. Elle a donc aussi mis sur pied la Fondation BDA, qui forme les agriculteurs à une production industrielle répondant aux normes du marché international. À terme, leur entreprise fera la culture des plantes et en assurera la transformation ainsi que la vente sur les marchés du pays et à l’étranger.
Carole Robert s’inspire de la « blended value », une approche, mieux connue aux États-Unis et en Europe, où les investisseurs, les entreprises et les organismes sans but lucratif poursuivent des objectifs à la fois économiques et sociaux. Autrement dit, elle veut faire du bien tout en faisant de l’argent ! « Il y a quelque chose de malsain dans le modèle donneur-receveur, dit Carole Robert, une grande femme volubile au regard perçant. Si on le perpétue, on sera au même point dans 50 ans. » Les Africains, dit-elle, doivent créer leur propre richesse.
« Attention ! Vous marchez dessus ! » Justin Kahenga, ingénieur agronome de 32 ans, ne peut retenir son rire tandis que, sous un soleil de plomb, j’arpente son champ, à 35 km de Lubumbashi, capitale du Katanga, riche province minière du Sud-Est. Les plantes médicinales poussent naturellement sur son terrain, où se balancent nonchalamment de hautes graminées.
Justin Kahenga, étudiant de BDA, cultivera peut-être un jour du moringa, petit arbre particulièrement riche en vitamines, minéraux et protéines, de l’Aloe vera, plante très prisée dans les cosmétiques, ainsi que de l’armoise, efficace dans le traitement de la malaria.
Le sous-sol de la province a beau receler 10 % des réserves mondiales de cuivre et 30 % des réserves de cobalt, le village de Justin Kahenga n’a toujours pas l’électricité. Les fils qui apportent l’énergie aux grandes exploitations minières passent au-dessus des villages sans s’arrêter. Avec les profits de la vente des plantes, l’ingénieur agronome et son associé, Jules Mutamba, veulent brancher leur village, mais aussi construire une école et une église. Actuellement, les enfants doivent faire cinq kilomètres à pied pour aller à l’école dans le village voisin…
Justin Kahenga fréquente l’école-entreprise de la Fondation, en banlieue de Kinshasa. C’est une avocate à la Cour pénale internationale, Carine Bapita, qui a prêté le terrain. Un séchoir est présentement en construction. Quant aux locaux, la Fondation utilise pour l’instant ceux des Jésuites, d’où les étudiants sont en communication plusieurs fois par semaine avec Carole Robert et Anne-Pascale Richardson, conseillère scientifique à la Fondation, au moyen de l'internet.
Marie Quinty